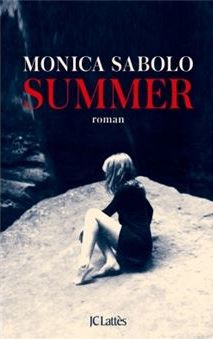Après un grand silence qui m’a fait battre le cœur pour toute la vie, je me suis réveillé. J’ai touché mon visage, mon crâne, pour me rassurer. Vérifier si j’étais moi. J’étais perdu dans mon pyjama, perdu de partout. (p. 13)
Voici les premières phrases de La fête des mères de Richard Morgiève, elles vous saisissent l’âme comme la Gnossienne numéro 1 d’Eric Satie.
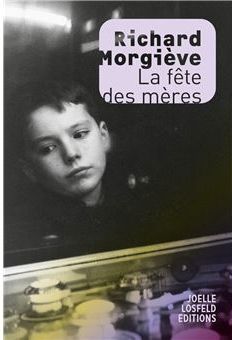 Si l’écriture intense est bien celle de l’écrivain, l’histoire ne lui appartient pas, ce que l’auteur explique à la fin du roman. L’homme en question, que Richard Morgiève prénomme Jacques, tient à ce que celui-ci raconte son histoire, lui et personne d’autre. Il a eu raison. Je pense que personne n’aurait pu rendre aussi bien cette terrible famille et la façon dont une mère peut saboter ses enfants, personne n’aurait pu raconter les soubresauts de la vie, les chaos et les douleurs, les éclairs d’amour, les coups du destin comme Richard Morgiève.
Si l’écriture intense est bien celle de l’écrivain, l’histoire ne lui appartient pas, ce que l’auteur explique à la fin du roman. L’homme en question, que Richard Morgiève prénomme Jacques, tient à ce que celui-ci raconte son histoire, lui et personne d’autre. Il a eu raison. Je pense que personne n’aurait pu rendre aussi bien cette terrible famille et la façon dont une mère peut saboter ses enfants, personne n’aurait pu raconter les soubresauts de la vie, les chaos et les douleurs, les éclairs d’amour, les coups du destin comme Richard Morgiève.
J’ai été Jacques Bauchot pendant onze moi. Le Haricot a été subjugué par La fête des mères, il l’a lu trois fois de suite: c’était exactement ça, c’était lui, c’était son histoire. (p. 417)
Cette fête des mères n’a rien à voir avec une célébration familiale attendrissante et un peu convenue. La mère de Jacques, le narrateur, étend son pouvoir maléfique sur toute la maisonnée, un peu à la manière de celle de Hervé Bazin dans Vipère au poing. Mais dans ce roman, les enfants surnommaient leur mère Folcoche et l’affrontaient ensemble. Le personnage était plus simple, il était plus facile pour ses enfants de la haïr et ainsi de se protéger. La mère de Jacques est tout autre, un mélange de folie et de séduction, et les sévices se mêlent à la perversité. Elle reste Maman pour tous ses enfants, et le désastre est total.
Je me serais tué pour elle, elle était mieux qu’une reine. (p. 84)
Richard Morgiève
Joëlle Losfeld Éditions, juin 2023, 432 p., 22€
ISBN : 9 782073 027573