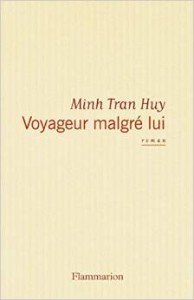Le Repas inoubliable est terminé, consommé ; les convives repus ou frustrés ne sont pas près de l’oublier. Et vous, chers lecteurs ? Je vous précise que la nouvelle a pris du volume, la dernière partie ayant allongé le texte. Que voulez-vous, une fois l’écrivain lâché le texte court, court, et les lecteurs frissonnent, je n’ose dire plus.
Le Repas inoubliable est terminé, consommé ; les convives repus ou frustrés ne sont pas près de l’oublier. Et vous, chers lecteurs ? Je vous précise que la nouvelle a pris du volume, la dernière partie ayant allongé le texte. Que voulez-vous, une fois l’écrivain lâché le texte court, court, et les lecteurs frissonnent, je n’ose dire plus.
C’est un travail d’écrivain dont il s’agit, vous l’aurez compris.
Le meilleur usage de l’écriture, c’est la vie dans toute sa diversité, toutes ses vibrations et toutes ses douleurs. Il ne me serait pas venu à l’idée de pousser la porte de la salle de bains ou de la chambre lorsque j’ai écrit la biographie de cette magnifique personne qu’était Louis Favre, pas plus que pour les nouvelles d’Après la guerre qui sont quasi terminées. Textes de douleur où parfois l’atmosphère est si pesante que je sors happer un peu d’air et de soleil.
Mais là, avec ce repas érotico-littéraire, les sensations et le désir courent au fil des phrases, les phantasmes se libèrent et deviennent actes par la magie de l’écriture. Un écrivain est un être vivant, qu’on se le dise, et il transforme les vibrations sensuelles en mots, phrases, textes que le lecteur à son tour recrée dans son imaginaire et dans sa vie.
Comment publier ce Repas inoubliable si loin de ce que j’écris d’habitude ? Tout d’abord il doit se trouver dans la rubrique érotisme d’Amazon. Je ne suis pas sûre que les textes strictement littéraires abondent dans cette rubrique. Le temps où Anaïs Nin écrivait des nouvelles érotiques à la page avec Henry Miller pour un commanditaire qui réclamait « moins de poésie » et plus de sexe explicite ne me semble pas révolu.
J’ai choisi le pseudonyme transparent de Droolyn Hantée, beau personnage de la nouvelle. Ce nom étrange et beau vient d’un rêve de mon mari. Une nuit il a rêvé qu’il n’arrivait pas à me rejoindre, il avait perdu ses papiers et une confusion terrible régnait dans l’endroit où il se trouvait : Guerre ? Attentat ? Il me cherchait et il cherchait ses papiers quand une scène étrange l’arrêta : une jeune femme penchée sur le sol ramassait des papiers, de petits rectangles qui étaient des cartes d’identité. Mon mari chercha la sienne et la retrouva. Il demanda le nom de la personne qui ramassait toutes ces identités perdues. Elle s’appelait Drouline Anthée.
Drouline Anthée, il était sûr de l’orthographe. Euphoniquement cela m’a immédiatement séduite mais j’ai eu envie de transformer la graphie, cette Drouline me semblait naïve, un peu fade ; elle est devenue Droolyn, mélange entre le Drood de Dan Simmons, personnage horrifique et fascinant et l’icône sexuelle Marilyn Monroe. Hantée lui convenait mieux vu le personnage.
Droolyn Hantée publie donc Un Repas inoubliable ce vendredi chez Plumitive Éditions, uniquement sous forme numérique. Si les lecteurs (et lectrices!) sont au rendez-vous, Droolyn fourmille d’idées plus titillantes les unes que les autres.