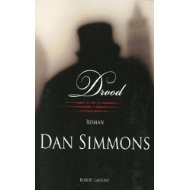 Lecteur, toi qui as été fasciné par Hypérion, tu risques fort d’être surpris par Drood, roman victorien. Je parie que, agacé, tu as rejeté le livre au bout de dix pages avant de le reprendre (c’est quand même un livre de Dan Simmons !) et de te retrouver fasciné une fois la première centaine de pages passée.
Lecteur, toi qui as été fasciné par Hypérion, tu risques fort d’être surpris par Drood, roman victorien. Je parie que, agacé, tu as rejeté le livre au bout de dix pages avant de le reprendre (c’est quand même un livre de Dan Simmons !) et de te retrouver fasciné une fois la première centaine de pages passée.
Résumons l’argument : constatant que la biographie de Charles Dickens qu’il vient de lire fait l’impasse sur les cinq dernières années de sa vie, de 1865 à 1870, Dan Simmons entreprend de les reconstituer en utilisant le roman laissé inachevé par Dickens, Le Mystère d’Edwin Drood et en utilisant comme narrateur du roman Wilkie Collins, le collègue de Dickens.
Cela donne une mise en abyme du roman de Dickens devenant l’argument de celui de Simmons, un mélange de roman d’horreur, de polar et de fantastique mâtiné de concurrence littéraire entre Dickens et Collins.
Vous l’aurez compris : bien qu’il affirme faire quelque chose de totalement nouveau pour se renouveler, une prise de risques, Dan Simmons utilise (admirablement) les vieilles recettes qui ont fait son succès.
Tout y est. De l’intrigue à tiroirs, des descriptions atroces de scarabée enfoncés dans le corps ou de viscères installées comme des guirlandes de Noël, de résurrection d’un culte égyptien avec Drood comme gourou gratiné, des effets miroirs destinés à égarer le lecteur, des tranches de culture servies bien saignantes, nous sommes en territoire connu.
Ne manque apparemment que la science-fiction. Mais si on regarde d’un peu plus près, on s’aperçoit que ses grands thèmes sont là : le contrôle des esprits et la quête de l’immortalité. Comme dans Hypérion, à cela près que nous sommes plongés dans les bas-fonds de Londres au XIXème, avec des descriptions terribles d’un capitalisme inhumain mais aussi les fumeries d’opium, les catacombes et les cimetières.
Rien de vraiment risqué, non ?
Du Dan Simmons au temps de Dickens, avec citations clins d’œil à l’appui.
C’était une magnifique idée de choisir comme espace temporel le moment où Charles Dickens est rescapé d’un terrible accident de chemin de fer de Londres et celui où il meurt, très exactement cinq ans plus tard, jour pour jour et à une heure près.
C’était une autre magnifique idée de choisir comme narrateur Wilkie Collins un narrateur écrivain qui a réellement existé. J’avoue que j’ai longtemps cru que c’était une invention de Simmons tant le portrait est chargé, mais la lecture de la note page 871 m’a indiqué mon erreur. Aucune importance : même si le personnage avait été inventé, l’auteur nous peint de la plus réjouissante des façons les rivalités et jalousies entre écrivains, les affections ambiguës, les craintes de se faire voler une idée, etc. Cela permet aussi à Simmons de nous donner une véritable leçon d’écriture : Dickens et Collins travaillent ensemble, l’un progresse dans l’œuvre la plus puissante de son siècle, l’autre fonde le roman policier tel que nous le connaissons, l’un est reconnu comme un génie, l’autre comme un honnête romancier, le temps de l’un est compté, celui de l’autre lui permettra de retomber dans l’oubli.
Une leçon de créativité et de littérature, donc.
Mais d’où vient ce sentiment d’irritation et de frustration qui gêne la lecture comme de la buée sur les lunettes ? La fin peut-être, un peu bâclée, trop attendue et bavarde, un comble pour un roman si long.
C’est là que le bât blesse : un roman si long. Un roman trop long où on a envie de dire « coupez ! ». Pourtant le lecteur français s’est précipité sur le dernier Dan Simmons, comme il l’a fait pour le dernier Stephen King. Puisqu’il s’agit d’un auteur américain à succès, le pavé de huit ou neuf cents pages ne lui fait pas peur, aux éditeurs non plus…
Jetez un œil sur les productions des écrivains français : épaisses comme un sandwich SNCF, aurait dit le chanteur Renaud. Les éditeurs scandent : « Coupez ! Coupez ! Plus c’est court, plus nous vendrons ! » Est-ce le syndrome Stéphane Hessel ? Bientôt nous lirons des livres aussi épais qu’un Haï Ku. Entre le maxi burger et la feuille de salade sans sauce, pas de milieu ?
