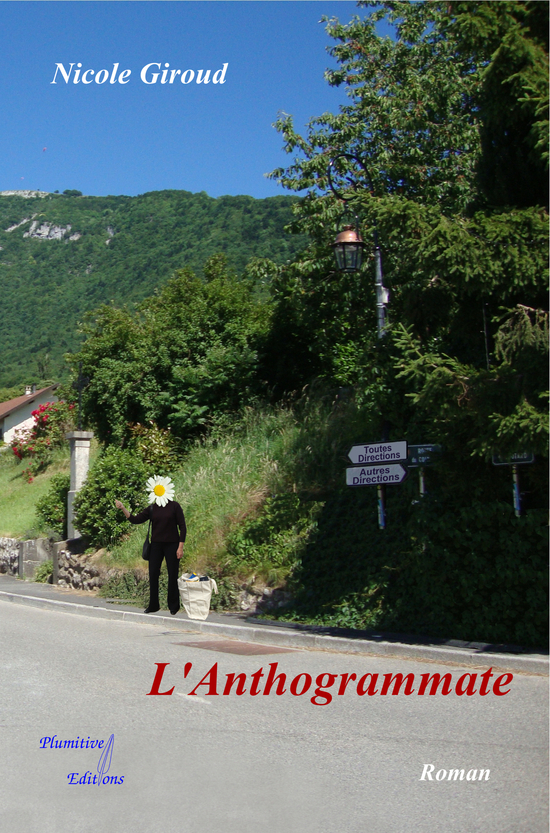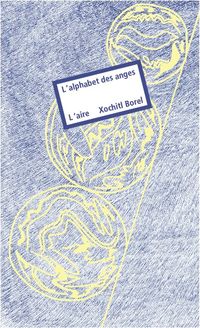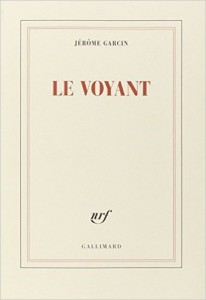Vous vous souvenez que je m’étais arrêtée à la sixième version de Fragments l’abrégé de Fragments de vie avant désintégration.
Pourquoi un titre pareil, un truc à décourager le lecteur le plus motivé et à faire fuir les autres pire qu’un Doberman baveux sur une plage de Méditerranée ?
À cause d’un avion de ligne indien, le Kangchenjunga, qui a explosé en plein vol sur le Mont Blanc en 1966. Sur le glacier des Bossons on n’a retrouvé que sept corps intacts sur les cent dix-sept personnes qui se trouvaient à bord. Parmi ces sept corps, celui d’une Indienne nue, vêtue de ses seuls bijoux. Quarante-cinq ans plus tard, je suis allée à une conférence donnée près de chez moi par un homme qui s’annonçait comme le découvreur des restes du Kangchenjunga et du Malabar Princess. Il a raconté ses découvertes sur le glacier des Bossons et une exposition de ses trophées a suivi, avec des éléments très choquants que je ne pouvais laisser sombrer dans l’oubli.
Voici l’origine de ce roman : le choc ressenti par les scalps de victimes présentés dans des vitrines, le cynisme inconscient de celui qui les avait trouvés et les exhibait. Ensuite j’ai cherché des détails sur ces deux catastrophes si troublantes : deux avions civils indiens qui s’écrasent au même endroit à seize ans de distance alors que jamais aucun autre avion civil ne s’est abîmé sur le massif du Mont-Blanc. J’ai découvert les éléments de cette histoire arrivée à une heure de chez moi, pleine de mystères et d’horreurs. De quoi écrire une dizaine de romans, Henri Troyat a ouvert la voie avec la première catastrophe indienne, celle du Malabar Princess, en écrivant La neige en deuil, je m’intéresse à la suivante, survenue seize ans plus tard, celle du Kangchenjunga. J’ai ressenti de la stupeur face à tout ce que la région de Chamonix essaie de cacher, à savoir la gestion honteuse des corps des victimes lors de ces deux catastrophes.
J’ai inventé des personnages, bien sûr, comme la fille de cette Indienne réellement retrouvée nue et intacte sur le glacier des Bossons et la vie même de cette femme, l’enchaînement qui l’a conduite à mourir si loin de chez elle. Le reste a suivi, les allers retours entre le Bombay des années soixante et Chamonix. J’ai dû rajouter le personnage de l’écrivain à la quatrième ou cinquième version pour alléger l’histoire, celui-ci a pris de l’importance au fil du temps.
Je ne vais pas vous raconter ce mélange d’éléments parfaitement véridiques et de recréation romanesque, je voulais juste vous expliquer le contexte de ce titre bizarre, Fragments de vie avant désintégration. J’ai bien sûr été effondrée lorsque j’ai entendu parler du roman Constellation d’Adrien Bosc alors que j’en étais à ma quatrième version. Heureusement nos propos ne se rencontrent absolument pas.
Il faut cependant que je change de titre, c’est évident, et j’ai besoin de votre aide parce que cela fait plusieurs années que pour moi le livre porte ce titre et je peine à lui en trouver un autre.
J’ai pensé à des horreurs : un titre racoleur style Indienne nue sur le Mont Blanc, classique, La vie interrompue, Le sari rose avec les oiseaux, mystérieux La danseuse du Kangchenjunga…
J’attends vos propositions. J’enverrai avec plaisir une version électronique du roman aux internautes qui auront fourni les titres les plus originaux. La primeur, plusieurs mois avant la publication.
J’attends avec impatience vos suggestions.