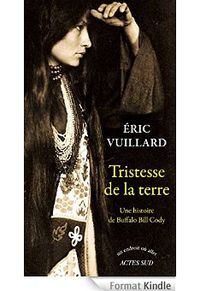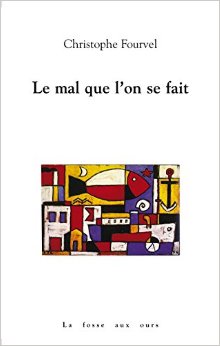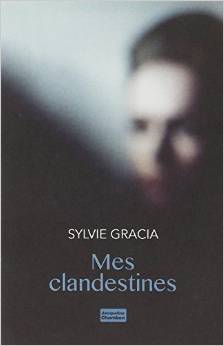 Clandestin : personne embarquée à l’insu de l’équipage et qui reste cachée durant toute la durée du voyage. Le beau titre Mes clandestines me surprend un peu, elles sont si peu cachées, ces femmes que Sylvie Gracia regarde avec une tendre acuité. Les « clandestines » dont il est question dans ce livre, ce sont les femmes qui accompagnent ou ont accompagné l’auteure dans sa vie. Amies très chères ou relations de passage, elles sont nombreuses: jeunes ou très vieilles, rivale, cousine ou relation de travail, rencontrées dans le métro, la rue ou sur Facebook. Relations de hasard et souvent de nécessité qui vont participer à un autoportrait de l’auteur, « Autoportrait biaisé », écrit Sylvie Gracia. Biaisé certes, impudique sûrement.
Clandestin : personne embarquée à l’insu de l’équipage et qui reste cachée durant toute la durée du voyage. Le beau titre Mes clandestines me surprend un peu, elles sont si peu cachées, ces femmes que Sylvie Gracia regarde avec une tendre acuité. Les « clandestines » dont il est question dans ce livre, ce sont les femmes qui accompagnent ou ont accompagné l’auteure dans sa vie. Amies très chères ou relations de passage, elles sont nombreuses: jeunes ou très vieilles, rivale, cousine ou relation de travail, rencontrées dans le métro, la rue ou sur Facebook. Relations de hasard et souvent de nécessité qui vont participer à un autoportrait de l’auteur, « Autoportrait biaisé », écrit Sylvie Gracia. Biaisé certes, impudique sûrement.
Tant de temps il m’avait fallu pour conquérir mes propres ciels, savoir un peu vivre. Est-ce pour cela que j’avance de biais toujours, muette dans la vie, impudique et tranchante dans l’écriture ?
Autant le dire tout de suite, l’autofiction m’insupporte. Le livre brisé de Serge Doubrovsky a suscité tant de déshabillages complaisants chargés de masquer sous couvert de littérature l’indigence de la pensée depuis un quart de siècle ! J’étais méfiante et j’ai eu de la difficulté les vingt premières pages, je n’aimais pas :
Ce crime de traquer dans chaque histoire de femme une part de moi-même. Dans chaque miroir un effet grossissant.
Le moi féminin, pire, utérin. J’ai failli renoncer. Mais je me suis fait piéger par l’acuité du regard, l’écriture, l’art du portrait, l’empathie pour toutes les femmes miroir certes, mais aimées, mais comprises. La magnifique Mathilde, par exemple, plus de quatre-vingt-dix ans, « Et toujours des mots fripouille balancés comme des coups de cymbales », Mathilde et sa lutte contre les pertes inexorables du très grand âge, portrait bouleversant d’une femme qui veut mourir debout :
Tant de noms et de visages ont sombré dans l’oubli. Ce n’est pas la mémoire qui trahit, c’est la vie qui a été dense, par couches s’accumulant et se neutralisant. (…) Les temps anciens résonnent plus encore maintenant qu’elle a du mal à faire deux choses à la fois. (…) Un bout de carton apparaît et disparaît dans l’appartement, parfois posé dans les toilettes, parfois pendu à la porte d’entrée. Raccrocher le téléphone est-il écrit dessus en lettres rouges et cursives.
Raccrocher.
Superbe, n’est-ce pas ?
Cette écriture qui oscille entre le rugueux et le précieux, l’élémentaire et le chantourné, cette écriture qui parfois irrite et souvent bouleverse, au plus près de ces femmes dans leur diversité et leur présence troublante. Femmes.
Annie Ernaux, l’écrivain tutélaire, sa grandiose universalité du moi comme une ombre maternelle au-dessus de Sylvie Gracia. L’ombre maternelle, celle qui a été mise à distance, fantôme douloureux qu’il faut pourtant convoquer à la fin du livre.
« Et vous, pourquoi me lisez-vous ? » demande l’auteur. Pour l’immersion dans la leçon d’écriture. Pour le regard. Pour ces petits morceaux de soi dans le grand collage (J’en ai pris beaucoup, rejeté d’autres qui m’ont semblé artificiels). Pour quelques femmes magnifiques, fantômes de ma propre vie, fantômes sans doute de la vôtre, à vous de choisir celles qui vous ont accompagnée.
Un livre féminin, un territoire exclusif où les hommes n’apparaissent qu’à contre-jour et rarement à leur avantage, un auto-portrait qui s’approche du grand modèle tout en défendant son propre carré.