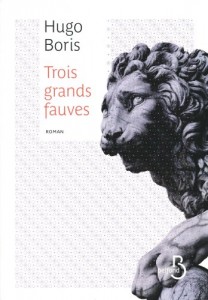 Les trois grands fauves dont nous parle Hugo Boris, ce sont Danton, Hugo et Churchill.
Les trois grands fauves dont nous parle Hugo Boris, ce sont Danton, Hugo et Churchill.
Ils apparaissent successivement dans ce qui pourrait paraître une brève biographie de chacun d’eux, le fil qui les relie étant plus que mince à mon avis, seule la nécessité de trouver un fil entre ces forces de la nature si disparates ayant justifié l’artifice.
Un homme politique français qui excelle dans l’une des pires périodes de l’histoire de la France, un écrivain français dont la stature écrasante se suffit à elle-même et un homme politique anglais qui excelle dans l’une des pires périodes de l’histoire de l’Angleterre. Trois forces de la nature reliées par un fil quelque part entre la grosse ficelle et l’improbable navrant d’un feuilletoniste en panne d’imagination.
Quelle idée d’avoir songé à relier ces trois fauves par de si navrants artifices alors que la force de la démonstration se suffisait à elle-même dans les troublantes similitudes entre les monstres de vie que nous présente Hugo Boris? Leur perpétuelle mise en danger, leur besoin de tester la force de leur volonté sur les autres êtres vivants , de dominer l’Histoire et les êtres, quitte à les écraser, n’était-ce pas suffisant?
L’admirable cruauté qui se dégage de ce texte, – (« roman »: vraiment? ) – , son écriture frappée au sceau des plus grands portraitiste justifient la lecture de cet opus malgré ses faiblesses.
Jugez par vous-même dans ce portrait que dresse le grand Victor de ses enfants, en particulier son fils aîné :
« Dans sa vitalité triomphante, le mutisme de sa seconde fille l’épuise, la passivité de ses fils le désespère. Il sait bien que la meilleure d’entre eux s’est noyée. (…)
Mais, des trois, c’est le gros Charles qui reste le plus pénible à regarder. Il dort trop, travaille peu, gaspille ses heures à jouer au billard et au nain jaune, a toujours des airs de passer par là. Sa nonchalance lui rappelle celle de sa femme, Adèle. Victor tente inutilement de faire passer en lui un peu de sa volonté. Charles s’engoue et se dégoûte tout aussi vite. La moindre de ses ardeurs se décourage en vingt-quatre heures. Comme son père, il est doué pour la peinture, mais ne sait pas faire les choses à plein. Comme lui, il versifie, mais ne sait pas s’obstiner. Ses mouvements même semble courts et avortés. On dirait qu’il ne tend jamais le bras tout à fait, qu’il ne marche qu’à pas comptés, incapable du moindre geste définitif. Victor songe qu’il aurait peut-être dû le faire soldat finalement au lieu de lui acheter un remplaçant. Depuis toujours, cet enfant vit sur lui. Ce pleure-misère lui prend cent francs par mois et se plaint encore d’être dans la gêne. A Paris, on lui a rapporté qu’il faisait commerce des lettres de son père, qu’il les jouait même au bésigue comme un brocanteur. Si ce fainéant insistait lourdement pour que son père joigne quelques dessins à ses courriers, c’est qu’ils étaient plus faciles à placer. A Jersey, il est oisif jusque dans sa conversation ! »
J’arrête là cette féroce et réjouissante méchanceté. Il y a du La Bruyère dans cette écriture, une précision dans la vision, une cruauté assumée. L’ogre dévore ses enfants en dieu souverain, comme Danton dévore la vitalité de ceux qui l’entourent avant de finir sur l’échafaud. Ces deux portraits séduisent totalement, emportent l’adhésion.
Celui de sir Winston Churchill me retient. D’abord celui-là n’est pas de la même eau que les autres: entre son enfance de mal-aimé solitaire et les eaux noires de la dépression, rien de jouissif dans le portrait; contrairement aux deux précédents , triomphants de vitalité jusqu’à la fin de leur vie, le dernier grand fauve suscite l’émotion et la pitié.
Nicole Giroud
Papiers d'Arpèges – Notes de rires et de larmes
