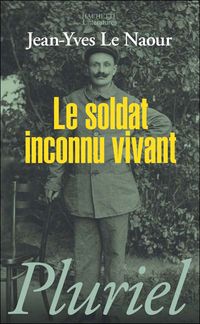 On parle beaucoup du soldat inconnu au moment des commémorations de la guerre 14-18, mais avez-vous entendu parler du soldat inconnu vivant ? Il s’agit de la plus grande énigme de l’entre-deux-guerres. Un soldat retrouvé le 1er février 1918 sur les quais de la gare des Brotteaux à Lyon. Il marmonne un nom, Anthelme Mangin, mais d’une manière confuse. Il ne sait pas qui il est. Il devient «Le fils de toutes les mères qui n’ont pas retrouvé leur fils.»
On parle beaucoup du soldat inconnu au moment des commémorations de la guerre 14-18, mais avez-vous entendu parler du soldat inconnu vivant ? Il s’agit de la plus grande énigme de l’entre-deux-guerres. Un soldat retrouvé le 1er février 1918 sur les quais de la gare des Brotteaux à Lyon. Il marmonne un nom, Anthelme Mangin, mais d’une manière confuse. Il ne sait pas qui il est. Il devient «Le fils de toutes les mères qui n’ont pas retrouvé leur fils.»
Des centaines de familles vont le réclamer, et certaines vont se déchirer pendant vingt ans, à grand renfort d’avocats et d’articles de presse. La France se passionne pour cette affaire pratiquement jusqu’à la mort du malheureux, en 1942, dans un hôpital psychiatrique.
L’historien Jean-Yves Le Naour restitue minutieusement le contexte de l’époque, avec ses 350 000 disparus qui empêchent le deuil des familles et entretiennent la haine envers les Allemands qui doivent cacher ces soldats quelque part. Il restitue factuellement, à grand renfort d’archives, l’impossibilité de tourner la page de centaines de milliers de familles, les aspects politiques et sociaux. Certains soldats rentrent en 1919 et même plus tard, leur « veuve » s’est remariée, a parfois des enfants. Certains autres, libérés des camps de travail allemands qui tiennent une administration plutôt rigoureuse, en profitent pour ne pas réintégrer le foyer familial qui avait sans doute moins d’attrait que la famille recréée en Allemagne ou une liberté retrouvée.
Ce soldat atteint de troubles mentaux provoqués par la guerre va être interné à Rodez, et l’invraisemblable commence. Certaines familles reconnaissent absolument un fils, un frère, un mari. Se greffent parfois des intérêts financiers, car la pension accordée aux familles par l’état est bien supérieure pour un soldat prisonnier puis revenu malade que pour un soldat mort au front. Certaines familles imaginent un véritable pactole, ce qui incite à l’affection et à l’entêtement.
Ce livre restitue en filigrane les immenses difficultés face auxquelles le gouvernement de l’après-guerre se trouve confronté. Le ministère de la Guerre supprime son service de renseignements aux familles en juillet 1919 et le Bulletin de l’Union des familles de disparus en août. Le cas Anthelme Mangin va réveiller les passions, et ainsi révéler qu’il ne suffit pas de supprimer des organismes officiels pour annuler le traumatisme de cette guerre. En 1922 sa photo paraît dans tous les journaux, et les ennuis commencent pour le directeur de l’asile, le docteur Fenayrou. Voici un extrait de sa lettre au préfet du 26 mars 1926 pour justifier son retard dans les réponses aux familles :
La présente lettre est la 366e que j’ai rédigée depuis la fin février au sujet du malade Mangin, le plus grand nombre d’entre elles ayant nécessité des recherches sur le malade et des examens minutieux d’écritures et de photographies, j’ai, en outre, reçu la visite de 40 familles venues à l’asile pour voir ce malade.
Le brave homme n’est pas au bout de ses peines : il va être accusé par les familles de maltraiter son malade, traîné dans la boue par les journaux. Le docteur Fenayrou tient à la tranquillité de son malade, au demeurant doux et obéissant. Les familles ne trouvent pas qu’une différence de taille d’une dizaine de centimètres entre leur disparu et Mangin soit un problème, par exemple, d’autres s’entêtent, même si l’emplacement du corps de leur disparu a été retrouvé. Les expertises se succèdent au rythme des procès, certains brillants avocats triomphent en dépit de la fragilité de leurs preuves, avant de nouveaux procès, de nouvelles expertises.
Je vous résume ces vingt ans où le malheureux soldat a été examiné sous toutes les coutures ou pire. Le docteur Fenayrou prend sa retraite, en septembre 1934, et sa remplaçante utilise une méthode nouvelle et assez habituelle : elle injecte 2 cm³ de térébenthine dans la cuisse d’Anthelme Mangin le 12 janvier 1935. Le but étant de provoquer une forte fièvre et d’interroger ensuite le malade. Cette pratique avait en quelque sorte remplacé la saignée pour faire « sortir le mal »…
Une famille se distingue du lot, il s’agit des Monjoin qui réclamaient seulement la pension des soldats morts au front pour Octave Monjoin, leur fils et frère. Ses caractérisques physiques sont celles de l’aliéné de Rodez, et des recherches en Allemagne prouvent qu’il était interné, et qu’il a été libéré avec d’autres prisonniers au moment où il a été retrouvé. On l’envoie à Saint-Maur-sur-Indre, son village natal présumé, le 27 septembre 1933. Il reconnaît l’église, s’étonne de la forme du clocher refait en son absence, trouve le chemin de la maison familiale. Las, les procès continuent, avec leur lot d’examens. Le 8 mars 1939 la cour d’appel de Montpellier confirme le jugement de Rodez, le soldat inconnu vivant est bien Octave Monjoin. « Est-ce bien fini ? » demande Pierre Monjoin pratiquement sur son lit de mort. Hélas non. Le père et le frère du soldat mourront avant de connaître la fin de l’histoire.
Octave Monjoin n’a jamais retrouvé son identité, le travail de la Cour de cassation a été bouleversé par la guerre. Octave se retrouve à l’asile du Vaucluse et connaît le sort de tant d’aliénés, il meurt sans doute de faim, comme 40 à 50 000 malades. On l’enterre dans une fosse commune, jusqu’à ce qu’un marchant de bois de Reims lise un article le concernant en 1944 et décide de le rendre à sa terre natale.
En 1948 on l’exhume de la fosse commune et Saint-Maur-sur-Indre lui organise des funérailles grandioses, du 2 au 4 avril, avec les anciens combattants des deux guerres, des représentants de multiples associations. Un culte unique de la patrie, avant l’oubli général. À découvrir en détail dans l’excellent livre de Jean-Yves Le Naour.
Jean-Yves Le Naour
Fayard/Pluriel, août 2008, 222 p., 8,10€
ISBN : 978-2012794641
