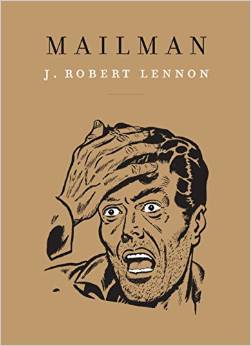 Mailman est un facteur américain comme nous le précise le titre du premier chapitre de la première partie de ce pavé de 669 pages. Celui-ci nous raconte les aventures drolatiques, obsessionnelles et pathétiques d’Albert Lippincott que durant tout le roman le narrateur n’appellera que Mailman tellement la fonction lui donne son identité.
Mailman est un facteur américain comme nous le précise le titre du premier chapitre de la première partie de ce pavé de 669 pages. Celui-ci nous raconte les aventures drolatiques, obsessionnelles et pathétiques d’Albert Lippincott que durant tout le roman le narrateur n’appellera que Mailman tellement la fonction lui donne son identité.
Albert, fils d’un professeur d’université et d’une chanteuse ratée, frère cadet de Gillian la sœur un peu perverse avec qui il entretient dès l’enfance des relations troubles, est né dans une famille où l’amour et la communication ne sont pas servis à tous les repas.
Il commence de brillantes études de physique avant de connaître un accès délirant où il est convaincu d’avoir compris la théorie universelle : tout ce qui est petit est le reflet du grand ; suite à quoi il agresse le professeur qui est l’étoile montante de l’université en essayant de lui mordre un œil. Pendant son séjour à l’hôpital psychiatrique il tombe amoureux de Lénore son infirmière et l’épouse. Suite à son épisode délirant, il ne peut plus poursuivre ses études et devient facteur dans la petite ville de Nestor.
Le livre commence des années plus tard quand Mailman est divorcé de Lénore mais toujours facteur à Nestor. Un facteur un peu particulier qui subtilise du courrier pour le lire et le photocopier avant de le remettre à ses destinataires. La machine se grippe lorsque Jared Sprain un jeune artiste se suicide avant que Mailman ait eu le temps de lui rendre sa dernière lettre.
Tout s’enchaîne alors : les ennuis avec une locataire haineuse qui a vu Albert mettre la lettre de Jared dans la boîte et le dénonce à sa hiérarchie, les ennuis avec son chef, les ennuis avec les chats que lui imposent les femmes de sa vie, ex ou défunte…
Nous sommes dans un film des frères Cohen : un héros pathétique et miteux déclenche des fous-rire avec ses galères, ses joies minuscules et ses obsessions ; nous sommes dans La journée de la marmotte avec le ballet de Volvos ornées de tutus, les majorettes et la reine des produits laitiers sur son char de la fête de Nestor. Ensuite viennent les nettoyeurs :
Arrivés dans une camionnette, les cantonniers de la ville entreprennent de démonter la tribune. Vêtus de gilets et de casquettes orange portant l’inscription SUPERÉQUIPE 2000, une vingtaine d’adultes handicapés moteurs et mentaux sont dirigés vers la grand-rue ; ils sont équipés de sacs-poubelle en plastique et de bâtons munis de pinces métalliques. Après s’être déployés d’un trottoir à l’autre, ils entament leur lente progression en direction du lac, leurs pinces raclant le sol.
Mailman a gagné lors d’un concours de la radio locale un petit appareil photo et il s’en sert désormais pour saisir la vie, les choses minuscules de la vie : le bâton d’une majorette haut dans le ciel, les handicapés, sa sœur, toute la vie qu’il essaie de capter à défaut de pouvoir s’y intégrer. Cela nous renvoie par effet de miroir à cet œil qu’il voulait mordre : désormais le petit objet de plastique bon marché remplace cette forme de pouvoir dédié au regard.
Le lecteur est pris dans les aventures de Mailman, son esprit délirant qui fait des allers-retours entre passé et présent. Les descriptions magnifiques de tous petits faits d’une tout aussi petite ville américaine ne suffisent cependant pas à éviter l’ennui : trop de détails étouffants. On sait que cela correspond à l’esprit délirant d’Albert se noyant dans les détails pourtant il est difficile de ne pas sentir son attention vaciller dans la première partie du roman. Un conseil : plutôt que d’abandonner ce livre magnifique mais boursouflé de trop de détails, laissez glisser votre regard jusqu’à ce qu’un autre épisode vous accroche.
Avec l’engagement de Mailman dans les Corps de la Paix, une association humanitaire pour apporter les lumières de l’Amérique partout où on a besoin d’elle, l’intérêt revient. La description précise et cruelle de la formation des bénévoles, ainsi que celle de la petite ville du Khazakstan où atterrit Albert sont des pépites.
Après cet épisode les démêlés de Mailman avec sa hiérarchie s’aggravent et vous avez de nouveau quelques pages de trop dans l’interrogatoire musclé que subit Mailman. Mais lorsque celui-ci décide de fuir plus question de lire en diagonale : la tension est permanente. Albert va très mal, une grosseur au ventre le fait terriblement souffrir et nous voyons son état physique se délabrer. Cette fuite qui ressemble à un retour en arrière : d’abord voir sa sœur à New York puis ses parents en Floride, c’est à la fois une forme de retour sur soi et une façon de boucler la boucle.
Poignant. Sa sœur est une actrice ratée qui supplie pour n’importe quel petit rôle, ses parents sont dans un état de dégradation avancée. Et lui :
Son visage est là, c’est bien lui, oui : l’image la plus familière du monde, celle qui devrait lui apporter un peu de réconfort alors que tout le reste part en sucette. Il n’en est rien, hélas. (…) C’est son visage, d’accord, mais pas celui auquel il est habitué. Comme s’il ressemblait à quelqu’un d’autre que lui. À son père. Pas seulement parce qu’il fait plus vieux, mais parce qu’il est, comme son père, égaré sur le chemin de sa propre vie.
Le pathétique de la grande vieillesse et du désarroi extrême, et toujours des scènes à la cocasserie dérangeante comme le repas d’anniversaire du père d’Albert au restaurant avec vieillards lubriques ou tragiques, conversations navrantes et tickets de réduction pour repas avant 17 heures.
Rien de ce qu’on envoie n’a de valeur tant que ce n’est pas arrivé à bon port.
C’est le fardeau du facteur, celui de tout être vivant dont la vie prend sens au moment de sa mort.
Où que votre vie finisse, elle y est toute écrivait Montaigne. Celle d’Albert Lippincott dit Mailman se termine au bord d’un marécage donnant sur l’océan dans une Amérique où
Les vieux pleins de fric rétrécissent, rapetissent, perdent même certains de leurs membres, tandis que leurs voitures grossissent.
Une Amérique dont l’auteur, J. Robert Lennon, nous livre des tableaux si précis et si cruels que le rire nerveux s’étrangle pour laisser place au malaise et à la tristesse.
Ce livre, je l’ai pris d’instinct : les couvertures inimitables des éditions Monsieur Toussaint Louverture me semblaient l’assurance d’une découverte. Après Karoo et malgré quelques réticences dues à la longueur du texte, je n’ai pas été déçue.
