La nouvelle série ésotérique de l’auteur japonais Haruki Mirakami, après le succès mondial de IQ84, comprend pour l’instant deux tomes dont les sous-titres devraient nous intriguer autant que le titre.
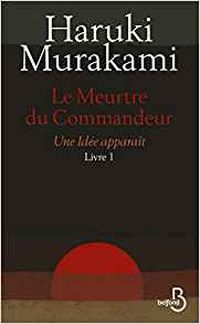 Dans le premier tome, nous faisons connaissance du narrateur dont nous ne connaîtrons jamais le nom et qui est un peintre spécialisé dans le portrait. Sa femme vient de lui apprendre qu’elle veut divorcer. Il entame alors une errance en voiture avant de se fixer dans la demeure d’un très grand peintre spécialisé dans une technique japonaise traditionnelle, Tomohiko Amada. Ce dernier vient d’être admis dans une maison de retraite, et son fils, ami du narrateur, demande à celui-ci d’habiter la maison. Dans le grenier de cette demeure isolée en pleine montagne, le peintre en panne d’inspiration trouve un tableau étrange doté d’une puissante force d’évocation intitulé Le meurtre du Commandeur. C’est le chef d’œuvre caché du vieux peintre muré dans sa démence. Pourquoi avoir caché un tableau d’une intensité pareille où les personnages ont l’air issus de l’opéra de Mozart, Don Juan ? La scène est d’une violence énigmatique : un homme jeune blesse à mort un vieil homme, le sang coule à flots sous les yeux d’une jeune femme qui semble Donna Anna et d’un homme du peuple, le valet Leporello. Dans un coin du tableau, un homme observe la scène.
Dans le premier tome, nous faisons connaissance du narrateur dont nous ne connaîtrons jamais le nom et qui est un peintre spécialisé dans le portrait. Sa femme vient de lui apprendre qu’elle veut divorcer. Il entame alors une errance en voiture avant de se fixer dans la demeure d’un très grand peintre spécialisé dans une technique japonaise traditionnelle, Tomohiko Amada. Ce dernier vient d’être admis dans une maison de retraite, et son fils, ami du narrateur, demande à celui-ci d’habiter la maison. Dans le grenier de cette demeure isolée en pleine montagne, le peintre en panne d’inspiration trouve un tableau étrange doté d’une puissante force d’évocation intitulé Le meurtre du Commandeur. C’est le chef d’œuvre caché du vieux peintre muré dans sa démence. Pourquoi avoir caché un tableau d’une intensité pareille où les personnages ont l’air issus de l’opéra de Mozart, Don Juan ? La scène est d’une violence énigmatique : un homme jeune blesse à mort un vieil homme, le sang coule à flots sous les yeux d’une jeune femme qui semble Donna Anna et d’un homme du peuple, le valet Leporello. Dans un coin du tableau, un homme observe la scène.
Le peintre reçoit une proposition qu’il ne peut refuser : faire le portrait d’un homme richissime, Wataru Menshiki, dont le nom signifie absence de couleur. Et en effet, cet homme si parfait, au goût si parfait, à la mise si parfaite, résiste à l’expression graphique. À ce moment-là d’étranges événements surgissent, qui continuent dans le tome 2 avec la disparition de la jeune fille dont le peintre fait le portrait.
Nous nous trouvons dans un univers où tout se mélange : la peinture traditionnelle japonaise et la musique classique occidentale, la façon dont l’art permet de conjurer la mort et le temps qui passe, les représentations symboliques de la mort… Il faut ajouter à ce catalogue déjà très riche les Idées platoniciennes évidentes dès le sous-titre du premier tome, et reprises sous forme de métaphore dans le tome 2. Seulement ici, l’Idée dont il est question est représentée par le petit personnage en bas du tableau, un individu truculent de 60 centimètres de haut à l’étrange parler.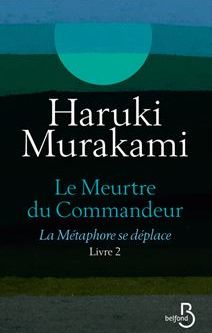
Cette adaptation de la philosophie grecque à la sauce japonaise peut surprendre, pourtant elle s’intègre parfaitement à l’univers de l’auteur. En effet, dans ce roman comme dans IQ84 la réalité est difficile à déterminer : qu’est-ce qui appartient vraiment au réel ? Qu’est-ce que cela signifie, être soi ? Comment déterminer la réalité ?
Il n’est pas innocent que le narrateur anonyme soit peintre et essaie de restituer la vérité de ses modèles plutôt que leur apparence.
Ce narrateur a trente-six ans et une fragilité qui l’a constitué, à savoir la mort de sa petite sœur bien-aimée à l’âge de 12 ans.
Telle qu’elle était là, on aurait dit qu’elle dormait paisiblement. Et que si l’on avait légèrement fait bouger son corps, elle se serait aussitôt levée. Mais c’était une illusion. On aurait eu beau l’appeler, la secouer tant et plus, plus jamais elle ne se réveillerait.
Quant à moi, je ne voulais pas que le corps frêle de ma petite sœur soit ainsi enfourné dans une boîte aussi exiguë. Il aurait dû être allongé dans un espace infiniment plus vaste. Par exemple au milieu d’une prairie. Et nous aurions dû aller la voir, sans dire un mot, nous frayant un chemin à travers de hauts herbages touffus. Le vent aurait soufflé en une douce brise sur les champs, et aux alentours, les oiseaux et les insectes auraient chanté ensemble de leur voix sans apprêt. Les rudes senteurs des fleurs sauvages auraient flotté dans l’air en même temps que les pollens. Le soleil une fois couché, d’innombrables étoiles argentées se seraient incrustées sur la voûte céleste. Le matin, un soleil neuf aurait fait scintiller comme des joyaux les gouttes de rosée sur les feuilles des herbes tout autour.
Mais dans la réalité, elle avait été placée dans un cercueil minuscule, dérisoire. Et les décorations alentour n’étaient que de funestes fleurs blanches, coupées avec des ciseaux, mises dans des vases. Ce qui éclairait la pièce étriquée, c’était la lumière de néons, comme dépourvue de couleur. D’un petit haut-parleur dissimulé au plafond, était diffusée une musique artificielle d’orgue. (p. 154-155)
C’est sans doute un des plus beaux passages du roman qui ne brille pas par son style. La mort de la petite sœur est l’événement jamais dépassé, revécu à travers d’autres personnes. La femme du narrateur, par exemple, l’a séduit parce qu’elle avait le même regard que la petite disparue, et sa demande de divorce est une mort symbolique du lien que le narrateur ne peut accepter, d’où son errance. Elle est ensuite relayée par une des élèves dont le narrateur va faire le portrait et qui a treize ans. À la fin du tome 2, on se rend compte que la petite fille du narrateur va prendre le relais de cet éternel retour.
Les Idées platoniciennes concernent les archétypes humains les plus fondamentaux, comme le Bien et le Beau, elles ont plus de réalité que les multiples représentations du réel qui nous égarent et faussent notre jugement.
Dans notre vie, il est fréquent de ne pas pouvoir discerner la frontière entre le réel et l’irréel. Et il me semble que cette frontière est toujours mouvante. Comme une frontière entre deux pays qui se déplacerait à son gré selon l’humeur du jour. Il faut faire très attention à ces mouvements. Sinon, on finit par ne plus savoir de quel côté on se trouve. (p. 278)
Pour le philosophe grec la réalité authentique relève d’une autre dimension que celle de la réalité apparente, et ce roman est la pleine expression de la difficulté de savoir quelle est la position du narrateur. Se trouve-t-il dans le tableau du grand maître dont il occupe la demeure ? Rêve-t-il, et alors sa descente aux enfers pour essayer de sauver la jeune Marye n’est-elle que la résurgence du souvenir de la grotte où sa petite sœur s’était égarée et a rencontré la mort ? Où se trouve-t-il ? Dans quelle dimension ? Est-il l’instrument du passage d’une réalité à une autre ?
Dans le silence des bois, je pouvais presque percevoir jusqu’au bruit de l’écoulement du temps, du passage de la vie. Un humain s’en allait, un autre arrivait. Un sentiment s’en allait, un autre arrivait. Une image s’en allait, une autre arrivait. Et moi aussi, je me désintégrais petit à petit dans l’accumulation de chaque moment, de chaque jour, avant de me régénérer. Rien ne demeurerait au même endroit. Et le temps se perdrait. Un instant après l’autre, le temps s’écroulait puis disparaissait derrière moi, comme du sable mort. Assis devant la fosse, l’oreille aux aguets, je ne faisais qu’écouter le temps mourir. (p. 301)
Murakami convoque les grands mythes de l’humanité, navigue sur le fleuve qui sépare le séjour des morts et des vivants, traverse la rive avec le gardien des enfers. Remontée à travers le temps, souffrance et angoisse, qu’il est dur de mourir ! La métaphore de l’agonie est superbe, mais l’art peut sauver l’homme de la mort de l’oubli :
Mais le souvenir subsiste. Le souvenir peut réchauffer le temps. Et puis – si on y réussit – l’art peut conserver à tout jamais le souvenir en lui donnant une forme. Comme Van Gogh qui a réussi à faire survivre jusqu’à nous ce facteur inconnu d’un coin de campagne en l’inscrivant dans notre mémoire collective.
En même temps son narrateur-héros se montre très humain, avec des préoccupations charnelles parfois un peu surprenantes et très crues. Les obsessions sexuelles et la nourriture le ramènent au ras du quotidien. Il trouvera la raison pour laquelle le vieux peintre n’a jamais montré son chef-d’œuvre, mais cela éclaire-t-il pour autant tous les mystères ?
Nous vivons tous, les uns et les autres, lestés de secrets qu’il nous est impossible de révéler.
Ces deux tomes m’ont laissé une impression mitigée. J’ai trouvé que les détails triviaux servaient à enraciner le roman dans le réel, certes, mais que leur abondance et leur répétition lassaient, tout comme nombre de dialogues insipides donnant l’impression d’un pisse-copie payé à la page. C’est cependant une marque du talent de l’auteur que, malgré l’irritation devant tant de bavardages, je n’ai pas quitté ces mille pages écrites ou traduites assez platement dans l’ensemble avant le point final.
Haruki Murakami
traduit du japonais par Hélène Morita et Tomoko Oono
Belfond, octobre 2018, 456 p., 23,90 €
ISBN : 978-2-7144-7838-2
Haruki Murakami
traduit du japonais par Hélène Morita et Tomoko Oono
Belfond, octobre 2018, 480 p., 23,90 €
ISBN : 978-2-7144-7839-9

Lorsqu’une amie m’a fait découvrir l’univers de Murakami, dans « Kafka sur le rivage », j’ai tout de suite été totalement séduit. Notamment par cet irrationnel dans le rationnel, ou l’étrange devient réalité. Où le réel se fait étrange. Il ne cesse de déranger nos schémas de pensée, nous force à regarder ailleurs en même temps qu’en nous-mêmes.
1Q84 m’a procuré des moments de délices…
La présentation que tu fais de meurtre du commandeur me donne le désir d’aller me baigner de nouveau là-bas…
Quant au style, je ne sais pas si on peut porter une appréciation, dans la mesure où il s’agit d’une traduction. Et je dois dire que parfois celle-ci m’a semblé un peu bâclée. C’est un travail de tâcherones, par un travail d’artiste qui sait traduire… dommage !
Merci Alain pour ce bel éclairage de l’univers de Murakami. Il faut en effet se laisser immerger dans un monde où les repères n’existent plus ou se sont déplacés, où les réalités s’effleurent, se mêlent ou se combattent.
Le monde de la traduction est très divers: il est très difficile d’en vivre, nombre d’enseignants de langue utilisent cela comme hobby et pourrissent sans doute le marché des traducteurs dont c’est le métier et qui sont payés à la page. N’empêche, quand on traduit un auteur mondialement connu, on doit se couler dans son expression comme dans son propre lit.
Je pense que c’est le genre de roman dans lequel il faut accepter de s’immerger sans résistance pour l’apprécier, abandonner notre raisonnement habituel et suivre le flot… Mais que de recoins, dirait-on!