Le Saloon des derniers mots doux est une ballade en prose dont les personnages flottent dans le temps ; leur légende et leur vie réelle correspondent rarement. En écrivant cet ouvrage, j’avais en tête le grand réalisateur John Ford : il est connu pour avoir déclaré qu’à choisir entre la légende et la réalité, mieux vaut écrire la légende. C’est donc ce que j’ai fait.
Voilà ce qu’écrit Larry McMurty avant de commencer son roman, Le saloon des derniers mots doux. Je vous avoue avoir choisi ce roman uniquement pour son titre poétique, énigmatique et incongru. Un saloon, pour moi, c’est le Far West, le lieu des pianos de bastringue et des bagarres, pas celui des mots doux. J’ai pris le livre.
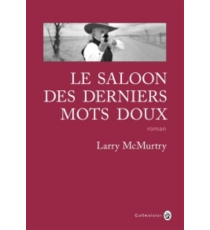 Cela démarre comme dans un western, avec un chapeau qui tournoie dans la poussière et des cowboys. Du genre fatigué, les héros de l’Ouest, et ils donnent dès le départ un sacré coup dans la légende :
Cela démarre comme dans un western, avec un chapeau qui tournoie dans la poussière et des cowboys. Du genre fatigué, les héros de l’Ouest, et ils donnent dès le départ un sacré coup dans la légende :
— Il est où, ton six-coups ?
— Il est peut-être derrière le bar, répondit Wyatt. Il est trop lourd pour que je le trimballe partout. Si je vois du grabuge quelque part, je peux généralement emprunter une arme à la Wells Fargo ou à quelqu’un d’autre.
— Bat Masterson affirme que t’es le meilleur tireur de l’Ouest, ajouta Doc. Il dit que tu peux atteindre un coyote à plus de quatre cents mètres.
— Bon sang, je verrais jamais un foutu coyote à cette distance, à moins qu’ils le peignent en rouge. Bat devrait me laisser le soin de vanter mes exploits s’il est pas capable de le faire de façon crédible.
Tout est dit. Ils sont tous là, les héros légendaires, Wyatt Earp et Doc Holliday, dont nous venons de saisir un moment de brillante conversation, Charlie Goodnight et Buffalo Bill. Une bande de bras cassés peu reluisants, mauvais tireurs, mauvais maris ou malades… Bien sûr qu’il y a les Indiens et une délicieuse de séquence de torture des scalpés du jour, des éleveurs bêtes, sales et méchants, une tempête de sable, un train, une bagarre, mais…
Les Indiens remercient Goodnight de leur laisser prendre la viande des bêtes tombées des falaises suite à la tempête de sable. Les enfants « n’aiment que les entrailles » et les vieilles Comanches apprécient les ris de veau ; le troupeau déchaîné est conduit par un bœuf placide, véritable animal de compagnie ; la bagarre, c’est vraiment parce qu’on ne peut pas faire autrement.
Un Ouest décalé, aux héros épuisés et devenus presque mutiques.
— Il paraît que Mackenzie est devenu fou la veille de son mariage et qu’il est mort dans un asile à New York, dit Goodnight.
— Oui, on s’est battu trop férocement contre lui, répondit Quanah. [le Comanche]
— Je parle rarement autant en une semaine, dit Goodnight avant de s’éloigner.
Seules les femmes tirent leur épingle du jeu dans cette histoire. Qu’elles fassent rêver, comme la mystérieuse San Saba, qu’elles soient courageuses comme la barmaid Jessie, ou Nelly la journaliste qui conclura cette histoire.
« Une œuvre habilement menée, drôle et subversive. une comédie postmoderne » a écrit la célèbre Joyce Carol Oates au sujet de ce roman. Je me demande si nous avons lu le même livre, car l’humour décalé, un peu triste de Larry McMurtry ne m’a pas fait rire. Il m’a fait songer à Tristesse de la terre, d’Eric Vuillard qui parle aussi de ce moment de l’histoire américaine et partage la même déréliction pour cet Ouest fondateur reconverti en spectacle pour touristes et planche à billets verts.
Qu’est-ce qui transforme certains faits en légende, et que deviennent les hommes qui ont participé, parfois involontairement, à la construire ? C’est ce dont nous parle ce livre moins léger qu’il n’y paraît, sous ses faux airs de script pour le cinéma de John Ford.

Un peu perplexe… San Saba est aussi le nom d’un camp nazi dans la région de Venise, une ancienne rizière je crois. Ma belle-mère y a été torturée… Ensuite, Quanah, le beau Quanah Parker, j’en suis très jalousement possessive, ayant toujours eu un « boentje » (un crush en bruxellois) pour lui. A cause de sa mère Cynthia Ann, au point que je l’ai mis dans mon second roman…
Je suis un peu étonnée aussi de l’avis de Joyce Carol Oates mais… je constate que nous avons une toute autre conception du roman et du récit en Europe. Et de l’humour. Moi je n’arrivais jamais à rire des films « comiques » américains (ni français d’ailleurs en général, l’humour belge était très différent aussi… ) et trouvais en général leurs films « à fond » très exagérés… (pour mon goût, qui n’est pas la référence 🙂 )
Edmée,
Quel message!
J’ignorais que San Saba fût un camp nazi en Italie, je me suis contentée de citer le nom du (beau) personnage. Et cette passion pour Quanah Parker, mazette! Quelle fougue! Un « boentje » en plus, je suis éblouie.Votre second roman, dites-vous, il faudra que j’aille lire.
Pour tout vous dire, je me suis demandé si Joyce Carol Oates avait lu le livre, elle fait tant de choses et écrit de si épais romans, où trouverait-elle le temps de lire les livres qu’elle doit critiquer? De ce côté de l’Atlantique c’est même une consigne dans certains grands journaux: pour faire une bonne critique, ne pas lire le livre. Je surprends souvent certains critiques très renommés en flagrant délit de grossières erreurs et de gros baratin. Devos se serait réjoui!
Quant au « goût belge », une pointe de surréalisme et de dérision ne ferait pas de mal à certains Français.