Voici un roman dont la petite musique entêtante vous atteindra au cœur et vous poursuivra longtemps, et dont le beau titre un peu mystérieux – Sans compter la neige – trouvera de multiples implications.
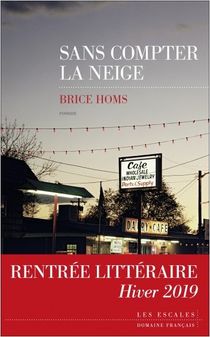 On pourrait dire très grossièrement que nous nous trouvons devant un énième roman d’apprentissage : Russell Fontenot va être père et rejoint la maman à la maternité en se remémorant son enfance avec le vieux comme il appelle son père, et ses années universitaires. Du classique ? Très vite on se rend compte qu’on se trouve au-delà des clichés de la découverte de l’amour et des désillusions.
On pourrait dire très grossièrement que nous nous trouvons devant un énième roman d’apprentissage : Russell Fontenot va être père et rejoint la maman à la maternité en se remémorant son enfance avec le vieux comme il appelle son père, et ses années universitaires. Du classique ? Très vite on se rend compte qu’on se trouve au-delà des clichés de la découverte de l’amour et des désillusions.
Ce beau roman dense est un peu comme un mille-feuilles gonflé d’amertume, de tristesse, d’amour et d’amitié.
Deux personnages s’imposent d’emblée dès le début du roman. Le père tout d’abord, Courville Fontenot, évoqué dès les premières lignes du texte à travers la destruction de son garage par son fils Russell, le narrateur héros du texte. Puis la femme de l’histoire : Jennie téléphone à trois heures. Le bébé s’annonce et Russell quitte son travail. Le roman sera rythmé par l’avancée du jeune homme en direction de la maternité, longue route semée d’embûches comme autant de stations accompagnant la privation des repères familiers : la perte du portable et la neige qui efface tout, mettant Russell face à lui-même et aux fantômes du passé.
Un personnage lumineux, douloureux et un peu fou domine très vite le récit : il s’agit de Koz, le compagnon de chambre de Russell à l’université. Koz, abrégé de son nom, Koz le brillant étudiant drogué à tout ce qui peut se trouver sur le marché, le jeune homme fascinant à qui personne ne résiste et qui s’occupe de groupes de rock. Son prénom, Adam, il ne l’utilise jamais. L’amitié improbable entre le brillant jeune homme riche et le boursier d’origine cajun est le phare de ce roman sur l’Amérique :
Frenchy, fais-moi couler une Bud, STP !
Pour ceux qui ne le sauraient pas les étudiants de l’université de Virginie se surnomment eux-mêmes avec fierté les Wahoos, du nom d’un poisson qui, selon la légende, peut boire trois fois son poids. […]
Frenchy, fais-moi couler une Bud, STP !
Trois jours sur sept, c’est là que je passais mes soirées avec eux, mais de l’autre côté du bar, où je gagnais l’argent de poche auquel ma bourse universitaire ne pourvoyait pas. […] Voilà ta bière, mec, et ne m’appelle plus Frenchy ! Je m’appelle Russell. Russell A. Fontenot ! (p. 56)
Moi, j’étais de leur côté à eux, mais en bas de l’échelle et j’avais droit à ce mélange de condescendance et de mépris qu’on sert ici à ceux qui ne font pas partie du cercle des élus ! Frenchy, fais-toi couler une Bud, s’il te plaît ! (Wahoo mâle). Frenchy, dis-moi un truc sexy en français ! (Wahoo femelle bourrée). (p. 57)
Russell est en marge de cette société d’enfants gâtés, il ne se trouve pas à l’université de Virginie grâce à l’argent de ses parents. Les autres, après leur phase de mini révolte assaisonnée d’alcool, de drogue et de sexe, rentreront dans le rang. Pas Koz, et c’est sans doute la raison pour laquelle les deux jeunes gens sont amis. La première fêlure vient pourtant, et c’est bien sûr une femme qui en sera la cause : Jennie, la fille libre, celle dont Russel tombe très vite amoureux.
Ce roman est plein de magnifiques portraits, et les femmes sont gâtées, que ce soit Jennie, Chilli la chanteuse brisée par l’inceste de son enfance, mais qui relève la tête, Erin la jeune boiteuse, ou les caissières de supermarché. Oui, les femmes sont choyées par Brice Homs. Quelles qu’elles soient, il leur distille chaleur, compréhension et amour :
La voix de Chilli s’est mise à surfer dessus, jetant ses vagues de mots sur les notes exaspérées. Chilli faisait courir ses mains le long de son ventre, comme pour se hisser plus haut. Sa voix juste et pure dansait aussi, comme tout son corps, sur chaque vibration de l’air, et la salle entière était en lévitation. Le groupe a joué les trois premières chansons d’un trait et il se dégageait de tout ça une ferveur qui vous prenait aux tripes comme un truc religieux. Quand le dernier morceau a été fini, Chilli a laissé retomber ses bras comme une athlète en fin de course, la tête légèrement inclinée sur l’épaule et elle a dit d’une voix épuisée : j’espère que vous avez mal au cul, parce que je viens de vous la mettre bien profond. L’assemblée de machos tatoués a braillé que oui d’une seule voix. Chilli les avait en son pouvoir. Et Koz jubilait… (p. 91)
Les hommes sont vus plus cruellement. Le père de Jennie, par exemple, l’écrivain qui cultive son look :
Le père de Jennie ressemblait plus à un émule grisonnant de Schwartzenegger qu’à l’image à la Woody Allen que l’on se fait d’un intellectuel new-yorkais, fût-il exilé dans le Montana. […] Son torse était bombé par des muscles travaillés à la machine, des épaules en trapèze et une cage thoracique de chanteur d’opéra. […] Un type à plusieurs étages comme une fusée de la Nasa, la poudre en bas, les organes dans les étages intermédiaires et le satellite en haut, bourré d’intelligence et de technologie de pointe, une machine parfaitement rodée à scruter le monde et les gens, tout ça planqué derrière de petits yeux bruns, incroyablement perçants. Un mâle américain dans la force de l’âge, massif et imposant, avec ce restant d’Europe, anachronique et soigné, dans sa culture. Bref, une veste en cachemire sur une chemise de bûcheron. (p. 99-100)
Réjouissant, non ? Et tous les portraits sont de cet acabit, un mélange de cruauté précise ou de tendresse triste, comme sa description des personnes qui hantent les supermarchés, la nuit.
Je passais comme ça une bonne heure, chaque soir, à traîner entre les rayons, au milieu des travailleurs de nuit, majoritairement noirs ou hispaniques, des insomniaques, des mères de famille à la tête hérissée de bigoudis, enfin seules quelques instants, loin de leur chiée de mômes et de leur mari déprimé, faisant leurs courses quand le supermarché est désert pour ne pas être vues en train de donner les coupons de nourriture de l’aide sociale en passant à la caisse.
Je les voyais glisser, ces femmes lasses, déjà usées, posant dans le caddie un emballage avec une hésitation coupable, juste trahie par une milliseconde de retard, celle qui désigne l’objet dont on n’a pas besoin mais qu’on prend quand même parce qu’on PEUT l’acheter sans recompter dix fois son budget. Le truc en trop dont on ne fera rien, mais qu’on achète parce que ça au moins, on peut se le permettre et que ce luxe-là revigore, d’une petite dose d’excitation inattendue, salutaire, qui vous fait dire que vous êtes libre, que vous ne devriez pas mais que vous le faites quand même et que juste ça, ça veut dire que vous n’êtes pas mort ni vaincu. (p. 108-109)
Le supermarché vu comme un concentré de l’Amérique dans ce roman sans marqueurs temporels à part les moments précis égrenés sur le trajet de Russell vers la maternité comme autant de stations, ces heures dans la neige et la nuit où tout peut arriver, comme de prendre un auto stoppeur aveugle et de ne pas s’en rendre compte.
Ce voyage vers cette nouvelle vie est un retour vers le passé, bien sûr, mais tant d’éléments universels se mêlent dans ce très beau texte ! La paternité, la filiation, la difficulté de pardonner, de se pardonner, de s’aimer ; la douleur de grandir, aussi, et d’abandonner certains aspects de soi-même. L’avancée de Russell dans la neige et dans son passé abolit l’espace et le temps, tout se mêle en une symphonie nostalgique.
Ce roman est d’une telle richesse sous son apparente limpidité ! Un vrai mille-feuille, je vous dis… L’importance du nom, la puissance de ce qu’il transmet ou transgresse, la rage de vivre et les déchirements, les différences sociales, les enfants gâtés et les oubliés de l’Amérique, et la jeunesse enfuie.
Quand je repense à Koz, je ne vois rien d’autre que la jeunesse. Certaines personnes sont comme ça. Certaines personnes sont la jeunesse ; elles n’existeraient pas en dehors. Et elles sont toutes de douleur et de rage parce qu’au fond, la jeunesse est douloureuse et dure. C’est pour ça qu’il faut que la jeunesse meure. C’est pour ça qu’il faut que l’homme naisse. (p. 171-172)
Ce qu’il est advenu de Koz et de son tragique secret, je vous laisse le découvrir dans ce très beau roman dont la musique va vous emporter. Pourquoi ai-je pensé à Créole Belle ? C’est comme si « le grand dérangement », la déportation massive des Cajuns, imprégnait ces romans de sa nostalgie, et provoquait en sourdine cette musique déchirante que partagent James Lee Burke et Brice Homs. Ce dernier possède un avantage sur l’Américain : il n’est pas traduit et sa superbe écriture illumine son texte. À lire, si ce n’est déjà fait, pour plonger dans vos propres renoncements ou faire un voyage dans une Amérique intemporelle.

Un magnifique voyage, je l’ai dévoré !