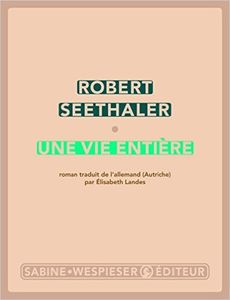On a beaucoup parlé de ces coups de folie qui frappent de jeunes hommes et qui n’ont rien à voir avec un embrigadement religieux ; très récemment c’est dans un train suisse que ce délire a frappé, conduisant à la mort d’une passagère et celle de l’auteur de l’attentat. Les Allemands nomment ce phénomène amok d’après la nouvelle de Stephan Zweig qui décrit très bien le phénomène. Ce mot est familier de nos voisins allemands, ils l’utilisent pour caractériser certains comportements très contemporains, comme la conduite automobile dangereuse ou les tireurs pris d’un coup de folie. Amok est quasiment passé dans la langue commune, loin de son origine malaise transmise par les Hollandais et qui peut être traduit par « rage incontrôlable ».
On a beaucoup parlé de ces coups de folie qui frappent de jeunes hommes et qui n’ont rien à voir avec un embrigadement religieux ; très récemment c’est dans un train suisse que ce délire a frappé, conduisant à la mort d’une passagère et celle de l’auteur de l’attentat. Les Allemands nomment ce phénomène amok d’après la nouvelle de Stephan Zweig qui décrit très bien le phénomène. Ce mot est familier de nos voisins allemands, ils l’utilisent pour caractériser certains comportements très contemporains, comme la conduite automobile dangereuse ou les tireurs pris d’un coup de folie. Amok est quasiment passé dans la langue commune, loin de son origine malaise transmise par les Hollandais et qui peut être traduit par « rage incontrôlable ».
J’ai retrouvé la mention de ce phénomène dans le Nouveau Larousse Illustré de 1898, page 259 du tome I, héritage précieux d’un arrière-grand-père :
Amok : État pathologique particulier aux Malais, caractérisé par des hallucinations visuelles avec impulsion homicide et suivi d’un profond abattement.
Les amoks paraissent être des fanatiques qui se sont excités au moyen d’un breuvage, ils font vœu de courir devant eux en tuant tous les gens qu’ils rencontreront. A Java et dans d’autres îles malaises, les hommes de la police sont armés de fourches spéciales pour arrêter ces fous ou ces malfaiteurs, que l’on abat ordinairement sur place.
La longue nouvelle de Stefan Zweig raconte magnifiquement ce coup de folie, même si dans le cas précis il n’y a pas vraiment de massacre… On sait dès le départ que l’histoire racontée va être tragique.
C’est plus que de l’ivresse… c’est une folie furieuse, une sorte de rage canine, mais humaine… un accès de monomanie meurtrière et insensée qui ne peut se comparer à aucune autre intoxication alcoolique… J’en ai moi-même étudié quelques cas pendant mon séjour – il est bien connu que pour autrui on est toujours perspicace et très objectif – mais sans jamais pouvoir mettre en lumière l’effrayant secret de son origine… C’est plus ou moins lié au climat, à cette atmosphère lourde et oppressante qui pèse sur les nerfs comme un orage, jusqu’à ce que ce soit eux qui éclatent… Donc l’amok… oui, l’amok se présente ainsi : un Malais, n’importe quel être tout simple, tout gentil, est en train d’écluser sa mixture… il est assis là tranquille, abruti, inerte… comme je l’étais chez moi… et soudain il bondit, saisit un poignard et se précipite dans la rue, où il court, tout droit, toujours tout droit… sans savoir vers où… Tout ce qu’il trouve sur son chemin, homme ou bête, il le poignarde d’un coup de kriss, et le sang qui coule l’excite encore davantage… Il court, l’écume aux lèvres, et hurle frénétiquement… mais il court, court, court, sans plus regarder ni à droite ni à gauche, court juste avec son cri perçant et son kriss sanglant, toujours tout droit devant lui, vers nulle part… Les gens dans les villages savent qu’aucune force au monde ne peut arrêter un amok… alors ils crient très fort pour donner l’alerte quand il approche : « Amok ! Amok ! » et tout le monde s’enfuit… mais lui court sans rien entendre, court sans rien voir, poignarde tout ce qu’il rencontre… jusqu’à ce qu’on l’abatte d’une balle comme un chien enragé ou que, tout écumant, il s’effondre de lui-même…
Celui qui décrit si bien l’amok restera anonyme. Cet individu fébrile se confie au narrateur, nuit après nuit, dans l’espace clos du bateau qui les ramène en Europe. Ce cadre littéraire semble un peu convenu au départ, mais on se laisse très vite saisir par cette folie en marche. Le narrateur devient amok après une situation très particulière, un cocktail détonant qui nous trouble par son actualité. L’homme, médecin contraint à l’exil dans les colonies suite à un scandale, sait que son horizon personnel et professionnel est bouché. Un soir, alors qu’il se trouve dans son cocktail habituel d’alcool, d’ennui et de solitude, surgit une femme qui a besoin de lui pour un avortement. Flambée de désir ; le médecin propose un échange sexuel à la place de l’argent qu’elle lui offre et qui l’humilie. La femme lui jette son mépris à la figure et le mélange explose : le narrateur devient amok. La fureur prend les commandes et bien des vies vont être détruites, à commencer par celle du narrateur.
Cette nouvelle est parue en 1922, entre les deux guerres dont la folie meurtrière de masse n’a rien à envier à la démence provoquée par l’alcool, l’ennui dans la chaleur humide d’une nuit malaise. Si cette notion d’amok est si commune en Allemagne et pas dans notre pays, peut-être devrions-nous l’ajouter à notre répertoire psychiatrique usuel. Il faudrait également nous interroger sur ce qui pousse de jeunes hommes et parfois des adolescents (l’amok ne touche que les hommes) à basculer dans cette forme de suicide. Frustrations, humiliations, et un rien peut mettre le feu aux poudres. Dans une école ou un train, un avion ou une rue bondée, le coup de folie de celui qui trouve alors une forme de célébrité et de reconnaissance sociale n’épargne personne. Notre société provoquerait-elle autant de désespérance que le colonialisme ?
Lisez ou relisez cette nouvelle, comme les romans de Stefan Zweig d’ailleurs (voir cette chronique sur Le Monde d’hier).
Stefan Zweig
Trad. de l’allemand (Autriche) par Bernard Lortholary
Gallimard, septembre 2013, 144 p., 3,50€
ISBN : 9782070454075