Ce roman d’anticipation se situe dans un futur indéterminé, mais certains éléments comme le pillage des océans ou l’esclavage moderne existent déjà, rendant cette uchronie très proche.
 La docteure Ha N’guyen, biologiste marine de grande réputation, a accepté de travailler pour la toute puissante multinationale DIANIMA, spécialisée en intelligence artificielle, qui vient de racheter l’archipel de Côn Ðáo au Vietnam. Elle se retrouve quasi prisonnière sur l’île principale en compagnie d’Evrim, l’androïde asexué. Est-ce pour le protéger ? Avec celui-ci la patronne de DIANIMA a réussi à créer un robot tellement supérieur aux hommes que la population exige sa destruction.
La docteure Ha N’guyen, biologiste marine de grande réputation, a accepté de travailler pour la toute puissante multinationale DIANIMA, spécialisée en intelligence artificielle, qui vient de racheter l’archipel de Côn Ðáo au Vietnam. Elle se retrouve quasi prisonnière sur l’île principale en compagnie d’Evrim, l’androïde asexué. Est-ce pour le protéger ? Avec celui-ci la patronne de DIANIMA a réussi à créer un robot tellement supérieur aux hommes que la population exige sa destruction.
Ha et Evrim sont protégés et surveillés par Atlantsetseg, la responsable de la sécurité de l’archipel. Est-elle totalement humaine, cette ancienne combattante criblée de cicatrice qui se régénère dans un élément liquide ? Impossible de le savoir. Elle communique par l’intermédiaire d’un traducteur automatique et dirige une armée de drones.
Il y a un mystère à Côn Ðáo qui a été vidé de ses habitants par DIAMINA. Très vite Ha va découvrir pourquoi elle a été engagée, elle que les pieuvres fascinent par leur intelligence exceptionnelle, chaque tentacule étant doué d’intelligence, indépendamment du cerveau central. La seule chose qui a empêché les pieuvres d’évoluer, c’est leur vie très courte et le manque d’altruisme de l’animal.
Mais si cet obstacle avait été levé dans l’archipel ? Si la forme d’intelligence la plus étrangère ne se trouvait pas sur Mars mais sous la mer, cet espace qui occupe les deux tiers de notre planète ? Comment alors réussir à comprendre, admettre et tenter de communiquer avec l’altérité la plus radicale qui soit ? Lorsque l’espèce découverte possède une intelligence qui n’a rien à voir avec la nôtre, comment entrer en contact et essayer de se comprendre ? Et qu’est-ce que la communication, la conscience, le langage ? Avant de tenter de définir l’Autre, ne faudrait-il pas être au clair avec le concept d’Humanité ?
Evrim sourit.
À ce moment, Ha comprit. Voilà pourquoi le monde ne fabriquerait plus d’IA humanoïde. Le sourire était parfait. Sincère, naturel. Pleinement humain.
Et justement, à cause de cela, ce sourire évoquait l’ombre de votre propre mort. L’existence d’Evrim impliquait la vôtre. Elle démontrait aussi que vous n’étiez rien de plus qu’une machine – un ensemble d’impulsions préprogrammées qui se répétaient à l’infini. […]
Un journaliste avait demandé un jour à Mínervudóttir-Chan :
« Qu’est-ce qui caractérise un androïde ? Pourquoi se donner tant de mal pour qu’il ait l’air humain, alors que créer un véritable humain est pratiquement gratuit ? »
Elle avait répondu : « L’humanité possède une particularité, à la fois superbe et terrible : nous accomplissons toujours ce que nous sommes capables de faire. » (p.53-54)
Evrim concentre cette question centrale d’humanité. Evrim est une intelligence artificielle, pourtant il éprouve le doute et la souffrance, ce qui, d’un point de vue de lecteur est plutôt troublant. Il est un être conscient. Alors est-il vivant ? Humain ? Un troisième type de créature ?
« Je pense, donc je doute d’exister », dit Ha.
Evrim leva les yeux vers elle.
« C’est une maxime classique et une énigme, continua Ha. Le langage ne nous permet pas seulement de décrire le monde tel qu’il est. Il ouvre également un monde sur des choses qui ne sont pas là. Il nous donne le pouvoir de spéculer. Puisque nous sommes des êtres créatifs qui utilisent le langage, nous réfléchissons mieux en prenant des choses comme exemples ; nous pouvons résoudre des problèmes plus complexes. Nous sommes capables d’imaginer comment des choses pourraient être, auraient pu être ; ou ce que ces choses pourraient devenir. La clé de notre créativité consiste à imaginer ce qui n’est pas. Les animaux dépourvus de langage n’ont pas cette possibilité. Grâce à ce pouvoir, nous sommes beaucoup plus libres d’agir d’une nouvelle manière, d’innover, d’inventer, de considérer notre situation sous des angles bien différents et de trouver de nouvelles solutions. Mais nous pouvons aussi produire d’innombrables absurdités, fort éloignées de la vérité. (p.292)
Le roman aurait pu virer à un huis-clos lassant si toute l’action se déroulait sur l’archipel de Côn Ðáo. Mais deux autres histoires se greffent sur la recherche de communication avec les pieuvres. Elles ont trait à l’intelligence artificielle.
La première met en scène Rustem, un hacker spécialisé dans l’effraction des esprits, qui se trouve à Astrakhan, en Russie. Il est engagé par une organisation inconnue pour pénétrer le cerveau d’Evrim. Son contact est un abglanz – mot allemand qui signifie reflet, trace ou copie –, dont il ne voit jamais vraiment le visage :
Lorsqu’il arriva dans son alcôve, elle se trouvait attablée devant une assiette d’esturgeon grillé. L’abglanz affichait un visage toutes les demi-secondes environ, si rapidement que l’oeil ne parvenait pas à distinguer des traits avant le changement suivant. Des hommes, des femmes, des visages non-binaires, éphémères et convaincants. Certains étaient très beaux, d’autres plutôt communs, d’autres horribles. S’agissait-il de véritables personnes ou d’images générées par ordinateur ? (p.43)
La deuxième histoire se passe sur Le loup des mers, un bateau-usine pirate dédié à la pêche industrielle qui ravage les océans. Cette réalité de notre époque est perfectionnée dans le roman : le navire est commandé par une IA, et les pêcheurs sont des esclaves capturés ici et là. Une vie humaine d’épuisement parallèle à l’épuisement des stocks de poissons. Nous suivons Eiko et son ami Son dans cette hallucinante épopée marine.
Les deux histoires secondaires se mêlent à la principale, on ne voit pas les liens entre les trois, mais elles se tissent pourtant dans une tension qui ne lâche plus le lecteur, une fois le début un peu déroutant assimilé.
Un homme pouvant pénétrer dans le cerveau d’autres hommes et provoquer leur mort, une IA programmée pour faire le plus de profit possible et capable de tuer elle aussi, cela est un futur dystopique certes, mais qui nous fait frémir parce qu’il ne nous semble pas impossible.
Je ne vous raconterai pas le dénouement du roman, qui n’est à mon avis pas la meilleure part de ce texte foisonnant. C’est comme si l’auteur s’était laissé dépasser par ses héros, à moins qu’il ait eu envie de respirer et de conclure par un accès d’optimisme.
Si la fin m’a un peu déçue, il en est tout autrement de l’onomastique des prénoms des principaux personnages. Rien, dans ce roman foisonnant (plus de 400 pages) n’est laissé au hasard. Chaque prénom des personnages principaux correspond à son caractère ou à ce qui va lui arriver. Le prénom de Ha signifie « travailleuse, déterminée et stricte », celui d’Evrim « évolution » ou « progression », quant à celui d’Atlantsetseg c’est un mot-valise composé de l’Atlantide, le continent englouti et du nom d’un district dans une province de Mongolie.
Les personnages secondaires sont tout aussi bien dotés : Eiko porte un prénom japonais qui signifie « enfant de la longévité » quant à Rustem, le hacker meurtrier, la signification de son prénom (personne bienveillante et calme) prend tout son sens à la fin du roman.
De la même façon les noms des différentes parties de La montagne dans la mer renvoient à des notions parfois ardues mais très précises que l’on peut grossièrement résumer ainsi :
I Les qualia (philosophie contemporaine) sont les qualités ressenties de nos expériences conscientes.
II Le concept d’Umwelt vient de l’éthologie pour décrire le caractère déterminé des stimuli environnementaux auxquels un animal réagit.
III La notion de sémiosphère est un mot valise entre la sémiotique et le mot sphère. Tous les êtres vivants sont intimement liés les uns aux autres.
IV L’autopoïèse (terme de biologie) est la propriété qu’ont les organismes vivants de générer eux-mêmes leur organisation structurale et fonctionnelle, en interaction permanente avec leur environnement.
Dans ce roman d’une richesse incroyable, la notion d’humanité est fondamentale. Au fond, qu’est-ce qui nous caractérise ? L’intelligence, le langage, l’écriture ? Que signifie être un être humain ?
Chaque nouvelle chose que nous construisons transforme nos existences et entraîne des conséquences. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher d’inventer, n’est-ce pas ? Nous sommes obligés de le faire, c’est gravé dans notre ADN. L’homme est l’animal technologique par excellence. (p.311)
La notion de conscience revient comme un leitmotiv, elle est si difficile à déterminer. Quant à une intelligence radicalement autre, le contact semble presque insurmontable.
Je crois qu’il leur sera impossible de nous comprendre. Ils verront tout ce que nous leur disons à travers le prisme de leurs croyances personnelles à notre égard – et ces croyances constitueront un autre obstacle à notre communication en déformant tout ce que nous pourrons leur dire. (p.390)
Ce roman-monde pose plus de questions qu’il n’en résout, mais les questions qu’il pose, un jour ou l’autre nous nous les poserons.
La Montagne dans la merRay Nayler
traduit de l’anglais par Henry-Luc Planchat
Le Bélial’, septembre 2024, 448 p., 24,90€
ISBN : 978-2-38163-149-3
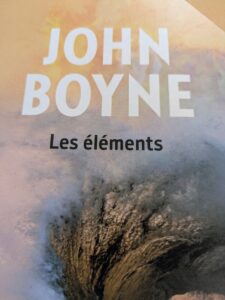 Dans son roman Les éléments John Boyne reprend la théorie de l’antiquité selon que la matière de l’univers était composée de quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. Cela lui permet de mettre en scène quatre personnages qui se croisent ou s’affrontent autour de la thématique de l’abus sexuel et de tout ce qui peut en dériver.
Dans son roman Les éléments John Boyne reprend la théorie de l’antiquité selon que la matière de l’univers était composée de quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air. Cela lui permet de mettre en scène quatre personnages qui se croisent ou s’affrontent autour de la thématique de l’abus sexuel et de tout ce qui peut en dériver.
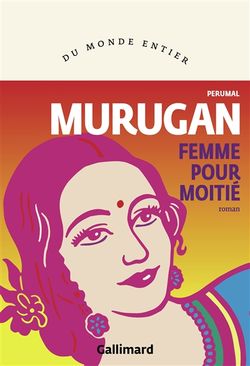 Dans la campagne du Tamil Nadu, Ponna et Kali, s’aiment passionnément. Une seule ombre à la vie de ce couple de paysans : bien que mariés depuis douze ans, ils n’ont pas d’enfant. Cela ne gêne pas Kali, mais il en va autrement chez Ponna qui vit très douloureusement les pressions et avanies de la part de leur entourage social et familial. Le couple se rend dans tous les temples où les dieux pourraient exaucer son vœu de maternité, en vain.
Dans la campagne du Tamil Nadu, Ponna et Kali, s’aiment passionnément. Une seule ombre à la vie de ce couple de paysans : bien que mariés depuis douze ans, ils n’ont pas d’enfant. Cela ne gêne pas Kali, mais il en va autrement chez Ponna qui vit très douloureusement les pressions et avanies de la part de leur entourage social et familial. Le couple se rend dans tous les temples où les dieux pourraient exaucer son vœu de maternité, en vain. La docteure Ha N’guyen, biologiste marine de grande réputation, a accepté de travailler pour la toute puissante multinationale DIANIMA, spécialisée en intelligence artificielle, qui vient de racheter l’archipel de Côn
La docteure Ha N’guyen, biologiste marine de grande réputation, a accepté de travailler pour la toute puissante multinationale DIANIMA, spécialisée en intelligence artificielle, qui vient de racheter l’archipel de Côn 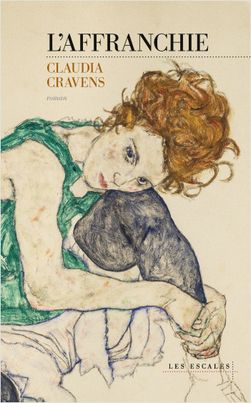 Bridget a seize ans, elle est rousse, belle et plutôt insolente. Elle vient de perdre son père, et marche dans la prairie jusqu’à ce qu’elle atteigne une petite ville de l’Ouest où elle se retrouvera bientôt pensionnaire dans le bordel de la ville, le Buffalo Queen.
Bridget a seize ans, elle est rousse, belle et plutôt insolente. Elle vient de perdre son père, et marche dans la prairie jusqu’à ce qu’elle atteigne une petite ville de l’Ouest où elle se retrouvera bientôt pensionnaire dans le bordel de la ville, le Buffalo Queen.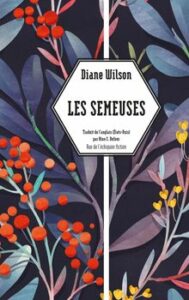 Le superbe premier roman de l’autrice amérindienne Diane Wilson, best-seller aux États-Unis en 2022, nous est parvenu deux ans plus tard avec la belle traduction de Nino S. Dufour aux éditions Rue de l’échiquier. Celui-ci commence par un poème et finit par une prière, et entre ceux-ci trois femmes appartenant à des époques différentes nous transmettent la tragédie de l’oppression coloniale américaine et la force de l’espoir des Amérindiennes.
Le superbe premier roman de l’autrice amérindienne Diane Wilson, best-seller aux États-Unis en 2022, nous est parvenu deux ans plus tard avec la belle traduction de Nino S. Dufour aux éditions Rue de l’échiquier. Celui-ci commence par un poème et finit par une prière, et entre ceux-ci trois femmes appartenant à des époques différentes nous transmettent la tragédie de l’oppression coloniale américaine et la force de l’espoir des Amérindiennes.