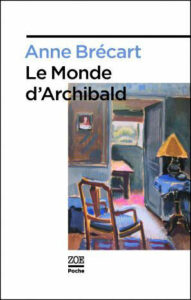
J’aime la littérature suisse romande, surtout celle des pays entre Vaud et Genève, imprégnée d’un calvinisme ravageur dont Jacques Chessex nous avait donné une violente image dans ses écrits.
« Une imprécation habite le paysage depuis longtemps. Personne ne peut se soustraire à l’œil scrutateur de Dieu qui nous poursuit et nous force à nous interroger sur ce mal en nous », écrit Anne Brécart dans Le Monde d’Archibald.
Le Monde d’Archibald, est le troisième roman de cet écrivain qui prend son temps: depuis Les Années de verre, publié en 1997, Angle mort en 2002, Le Monde d’Archibald arrive en 2009, aux éditions Zoé comme les précédents.
Moi aussi j’aime prendre mon temps, laisser mes lectures à la décantation : Le Monde d’Archibald possède un bouquet amer avec des notes sucrées, quelque chose de râpeux et de doux qui vous laisse un souvenir sur la langue et dans l’âme, une sorte de nostalgie et de douleur que l’on peine à oublier.
En Suisse romande comme ailleurs, il existe deux sortes d’écrivains : ceux qui ont de l’imagination et ceux qui utilisent leur vie et (ou) celle des autres pour créer une œuvre, Anne Brécart appartient à la deuxième catégorie.
Elle creuse ses douleurs, ses souvenirs, un peu à la manière d’Annie Ernaux, c’est la seule comparaison pertinente qui me vient à l’esprit, mais pourtant la différence saute aux yeux, même dans les passages crus de l’initiation sexuelle de la narratrice subsiste une pudeur, une distanciation que l’on ne trouve pas dans l’œuvre d’Annie Ernaux, et cela tient je crois à ce pays si particulier.
En quelques mots voici la trame du livre: la narratrice évoque ses vacances d’enfant dans la somptueuse maison de famille un rien décatie de son oncle maternel quelque part au bord d’un lac en Suisse romande. Elle y revient chaque année, grandit, découvre la mort et le sexe, de plus en plus fascinée par son oncle Archibald, perdant magnifique et seigneur du lieu.
Personnellement je déteste les souvenirs d’enfance nostalgiques de bourgeois complaisants vis à vis d’eux-mêmes. La tante de la narratrice qui a comme fait d’arme à son actif d’avoir conduit la Bentley familiale dans les rues de Lausanne me laisse parfaitement froide.
Où est l’intérêt de ce roman, me direz-vous ?
D’abord dans l’écriture qui ressemble au pays qu’elle décrit : Anne Brécart traque l’adjectif et l’adverbe, hait les points de suspension et d’exclamation. Seuls quelques points d’interrogation subsistent, sauvés par leur propos, les questions participent à la douleur, n’est-ce pas !
Pour le reste, on dirait que tout ce qui vit et pourrait déranger l’ordonnancement des choses, – les émotions, les incertitudes, les éclats de tout ordre –, a été évacué. Chut ! On ne dérange pas, on ne mêle pas la vie triviale à ce qui est une œuvre d’art. Quelle contradiction, pourtant, que cette maison qui attend les enfants pour les vacances et d’où aucun cri ou dispute d’enfant ne sort ! Une maison de souvenirs d’enfance ou une maison de souvenirs qui accueille des enfants, un bloc de passé figé dans lequel les enfants ne sont que des figurants.
Nous avons affaire à une lutte contre le temps et la mort. L’oncle Archibald, le frère aîné de la mère de la narratrice, règne sur ce monde exténué qu’il porte à bout de bras. La rigidité des rites qu’il impose à sa famille (comme le repas de midi ou le thé de quatre heures dans les tasses évanescentes) fait partie de ses activités-remparts dérisoires contre la mort, tout comme les blasons des familles disparues qu’il dessine avant de les coller dans un livre. La narratrice lui prête un grand pouvoir : « Il savait arrêter le temps, il était capable de rendre présent le passé ».
Mais ce n’est qu’une illusion, la mort est là, omniprésente.
Celle de François, le cousin de la narratrice, mort à seize ans, celle d’Olympe, la femme d’Archibald, mort difficile à laquelle participe la narratrice, témoin de cette lutte entre la vie et la mort. « Pour elle, la mort n’est pas un simple et tranquille évanouissement, une disparition sereine, mais une lutte d’une rare violence. Couchée sur son lit, elle semble se heurter contre une paroi invisible qui la renvoie douloureusement dans le monde des vivants, passant ses journées dans un exténuant aller et retour entre l’au-delà et la vie ».
Celle de l’enfance, avec la relation sexuelle entre la narratrice adolescente et Idriss, l’ouvrier Kosovar chargé par Archibald de maintenir la vie de la ferme. Leurre contre leurre, fausse vie de ferme, faux ouvrier et vrai réfugié, fausse relation où il n’est jamais question d’amour, même pas de plaisir.
La mort est partout. Dans cette maison aux rideaux fanés qui laisse passer les vents coulis, dans les relations du vieil homme avec ses filles, dans cette volonté désespérée de maintenir ce qui a été.
La narratrice fascinée en oublie de vivre : elle reste en dehors, comme lors de cette manifestation d’étudiants à laquelle se joignent tous ses camarades : « Elle regarde mais ne se joint pas à eux, n’est-elle pas retenue par une différence qui l’empêche de se mêler au mouvement, à l’exaltation ? Eux trouvent un sens à leur vie dans la cause commune. Crier d’une seule voix leur donne le sentiment d’exister. Elle, au contraire, a une existence si fragile qu’elle a l’impression de se dissoudre dans la foule. Quelque chose comme une fatigue la retient près de la fenêtre, observatrice immobile. »
Pour finir, le vieil homme choisit de mourir, et sa mort entraîne bientôt celle de la maison. « […] le mot « perte » s’est déployé en moi comme un gigantesque parachute noir ».
D’où vient que le plexus se serre dès le premier chapitre ? D’où vient que l’on sent au plus profond de soi le déracinement, l’éloignement, la difficulté de vivre et de laisser mourir ?
Le combat d’Olympe contre la mort, la douleur de la vie nous le rend si proche, nous l’avons vécu, nous allons le connaître. Et la difficulté d’avancer et de trouver notre propre parcours, le besoin de se raccrocher à ce et ceux que nous connaissons : « La permanence n’est qu’une question d’habitude, il est si difficile d’envisager le monde comme une surprise ».
Ce livre nous ramène aux questions existentielles fondamentales : non, nous ne pouvons pas retenir le temps, mais l’écriture magnifique d’Anne Brécart nous donne à de nombreux moments un sentiment d’éternité, dans le pays sévère de ses souvenirs d’enfance.
