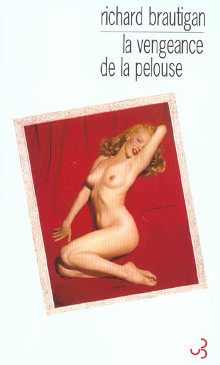 Il est difficile de mettre dans une catégorie définie ces textes datés des années 1962 à 1970 où Richard Brautigan, 35 ans, qui a connu la célébrité avec La pêche à la truite en Amérique en 1967, s’interroge sur son enfance et relate certains épisodes de celle-ci.
Il est difficile de mettre dans une catégorie définie ces textes datés des années 1962 à 1970 où Richard Brautigan, 35 ans, qui a connu la célébrité avec La pêche à la truite en Amérique en 1967, s’interroge sur son enfance et relate certains épisodes de celle-ci.
J’ai examiné des petits bouts de mon enfance. Ce sont des morceaux d’une vie lointaine qui n’ont ni forme ni sens. Des choses qui se sont produites comme des poussières.
Des poussières ? De la poudre magique, du ravissement doré soufflé sur les adultes qui efface les amertumes des années accumulées, de minuscules fragments d’éternité. Je suis restée sous le choc et le charme de cette écriture où comparaisons et métaphores suscitent surprise et ravissement.
En se servant de ses os comme des voiles d’un navire, la vieille femme sortit dans la rue. (p.59)
Le sol est couvert d’une couche de neige si épaisse qu’on dirait qu’il vient de toucher sa pension du gouvernement et qu’il savoure à l’avance une retraite longue et joyeuse. (p.104)
Ses vêtements flasques et qui ne ressemblaient à rien l’enveloppaient comme le drapeau d’un pays vaincu et il donnait l’impression de n’avoir jamais de sa vie reçu d’autre courrier que des factures. (p.124)
Le recueil commence par la nouvelle qui donne son titre au recueil, un joyau cruel et désopilant où l’on rit aussi fort que dans une nouvelle de l’Australien Kenneth Cook. Pourtant c’est un autre univers, plus tendre, avec une douceur intemporelle loin des héros pittoresques de l’Australien. Ces textes font éprouver au lecteur un sentiment d’éternité, comme des souvenirs resurgis dans un chaos de réminiscences, sans aucune chronologie, avec des fragments égarés d’adolescence et de vie adulte.
La vengeance de la pelouse est la seule nouvelle du recueil où l’on rit franchement. L’univers de Richard Brautigan ne rappelle en rien le vert paradis que nous vantent d’autres écrivains, il nous décrit une Amérique de pauvres, d’assistés, où les enfants savent dès l’école que toutes les places ne se valent pas ; pourtant jamais le misérabilisme ne pointe son nez.
Voici le portrait d’une femme qui pourrait être celui de la mère de l’auteur :
Elle, c’était une de ces femmes éternellement fragiles, à l’approche de la quarantaine, celles qui, autrefois très jolies, étaient l’objet de beaucoup d’attentions dans les auberges et les tavernes, et dont la vie, maintenant qu’elles sont à la charge de l’Aide sociale, tourne autour de ce jour du mois où elles reçoivent leur chèque.
Le mot chèque est le seul mot sacré dans leur vie. C’est pourquoi elles réussissent toujours à l’utiliser au moins trois ou quatre fois dans la conversation, quel qu’en soit le sujet. (p.28)
Marylou a quitté son mari Bernard Brautigan alors qu’elle était enceinte et n’a même pas prévenu celui-ci qu’il avait un fils. Elle enchaîne amants et maris (une fois avant même d’être divorcée du précédent) ; amants et maris cogneurs, aide sociale toute sa vie, deux autres filles de deux pères différents. Certains textes du recueil racontent l’adolescent de seize ans qui part à la chasse en stop, mais il ne précise pas que la famille attendait la viande pour pouvoir manger. Une Amérique de déclassés, de vaincus par la vie avant même de s’être battus.
Richard Brautigan s’est suicidé en 1984, à l’âge de quarante-neuf ans.
Ce recueil d’instantanés de vie est un pur bonheur de lecture ; il laisse au lecteur, durablement impressionné dans sa mémoire, un mélange de nostalgie, de grâce et de légèreté. Éblouissant.
Marie-Chritine Agosto a traduit ce texte avec une poésie, une sensibilité et une fluidité qui forcent l’admiration.
