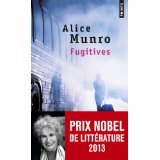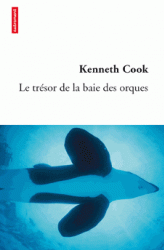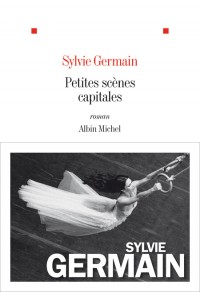 Lili Liliane, enfant sans mère, apprend à l’école qu’elle s’appelle Barbara. Une erreur, lui dit son père. Et si c’était toute sa vie qui était une erreur ? Avant il y avait quoi ? demande Lili à sa grand-mère qui lui montre le bébé dans les bras de sa mère. Avant il y avait quoi ? avant ce bébé, avant la création de la vie ? Et après, il y a quoi ? « Ce grelot de questions s’agite par moments dans ses pensées, sonnaillant dans le vide. Puis le grelot finit par se taire, fatigué de tintinnabuler en rond, en vain ».
Lili Liliane, enfant sans mère, apprend à l’école qu’elle s’appelle Barbara. Une erreur, lui dit son père. Et si c’était toute sa vie qui était une erreur ? Avant il y avait quoi ? demande Lili à sa grand-mère qui lui montre le bébé dans les bras de sa mère. Avant il y avait quoi ? avant ce bébé, avant la création de la vie ? Et après, il y a quoi ? « Ce grelot de questions s’agite par moments dans ses pensées, sonnaillant dans le vide. Puis le grelot finit par se taire, fatigué de tintinnabuler en rond, en vain ».
Entre ces deux interrogations la vie de Lili-Barbara s’écoule en séquences, impressions qui ponctuent sa vie, de la solitude à deux avec son père à la famille recomposée, jalousie, concurrence dans le cœur des parents, drame qui éclate la famille, vie d’adulte et les mêmes sentiments, jalousie et concurrence, et enfin une maturité pas vraiment apaisée.
Roman est-il écrit sous le titre, roman, vraiment ? Ce condensé de vie comme une épure, avec sa période de formation, ses drames et ses incertitudes, est-ce un roman ?
Nous suivons Lili-Barbara de la petite enfance à la vieillesse, trajet à sauts de puce, trajet d’impressions et d’essence même de la vie. La sienne, celle des gens qui l’entourent, famille, amours, leur fragilité et leurs errements, les accidents de la vie, l’amour, le vieillissement, la mort. Mais tout cela est un peu désincarné, à l’image de Lili qui est une petite fille puis une femme sans grand relief. C’est peut-être la trouvaille : une héroïne qui n’en est pas une sur laquelle n’importe qui peut coller sa propre identité sans être gêné par un personnage envahissant.
Ce qui est important dans ce livre, c’est l’écriture. Somptueuse :
« La voix des oiseaux. Les voix de brume et de rouille des oiseaux écroués. Elles bercent ses siestes et ses nuits. Elles ne l’effraient pas, elles l’apaisent au contraire. Parmi ces voix étranges et familières, elle aime particulièrement celles des paons, grise et rugueuse, et les hululements des rapaces nocturnes qui lui font l’effet de longs rubans de sons soyeux ondoyant dans le noir. Elles remplacent la voix inconnue de sa mère, sa voix manquante et désirée.
La voix des grands oiseaux captifs ; jamais un chant, mais des appels hagards lancés vers un dehors qui leur est refusé, vers un ailleurs inaccessible. Elle écoute ces appels aux accents de colère mêlée d’imploration certains expriment une telle douceur qu’elle en est affligeante et lui donne envie de pleurer. Elle voudrait pouvoir leur répondre, leur faire signe tout au moins, et elle essaie parfois, debout dans son lit, les mains ouvertes autour de la bouche. oi ououh… On an héon on…
Ils ne l’entendent pas. Pas davantage que sa mère. Sa voix ne porte pas bien loin, elle n’atteint ni les oiseaux ni les morts ».
« Et que ce passe-t-il après ? Après on va où, on devient quoi ? La question de sa petite enfance devant la photographie de sa mère avec elle nouveau-née s’est depuis longtemps retournée en elle, la stupeur de l’après l’a emporté sur celle de l’avant, et le vertige devant l’absence de réponse est beaucoup plus puissant. Avant, qu’importe au fond, on est embarqué, les dés sont jetés, mais après, que se passe-t-il après ?
Peau noire du temps, chair si vive, sensitive, des mortels, peau noir glacé, noir brûlant, des questions, chair tremblée des réponses qui toujours demeurent incertaines ».
Sylvie Germain affirme son statut de créateur, n’hésite ni devant la préciosité : orbe lacté, palimpseste nu, épiphanique, cristaux micacés comme une congère grêlée par le soleil, ou le terme rare : trémuler, thyrses. Les mots qui se heurtent pour rendre l’impression dans sa netteté absolue, une allègre brutalité, mesure du temps catastrophée, les allitérations : sauvages soliloques, les néologismes : elle s’affronte, elle s’à-paume, elle s’à-ventre au mystère de sa trace, ignescent quand igné ne rend pas exactement l’impression, et que dire de le sang houlait dans tous les sens brasillant dans l’écume, cette étreinte dilatante !
L’écrivain joue de son immense palette pour nous rendre la vie dans ses sensations obscures ou lumineuses, au travers des petits cailloux qui jalonnent l’existence de Lili-Barbara avec une puissance d’écriture rarement égalée.