 Cela fait six mois que ça dure, les frissons et la culpabilité du mensonge, l’érotisme puissant de l’illégitimité.
Cela fait six mois que ça dure, les frissons et la culpabilité du mensonge, l’érotisme puissant de l’illégitimité.
Leurs mains se frôlent.
Ils n’en peuvent plus de l’odeur du jasmin en fleur et des palais obscurs, ils n’en peuvent plus de cette excitation qu’ils peinent à masquer aux autres, de ce bonheur qui les roule comme des galets dans une vague d’érotisme insensé. Oui, insensé.
C’est arrivé comme ça, la rencontre par hasard dans une conférence, et le coup de foudre, il n’y a pas d’autre mot. Et depuis six mois les rencontres clandestines, Je vais voir une amie à Genève, les hôtels romantiques, – il a toujours eu la délicatesse de choisir des hôtels romantiques. Mais très vite ils ont eu peur de rencontrer quelqu’un de leur connaissance, et une nuit ne leur suffisait plus. C’est lui qui a pensé aux voyages organisés, Une semaine rien qu’à nous, ce n’est pas mal, non ?
C’est devenu un rite : ils se donnent rendez-vous à l’aéroport de Genève, elle arrive de Suisse allemande, lui de Neuchâtel, il est Suisse allemand, elle est Suisse romande. Leurs destinées croisées les attendrissent : c’est le destin, ils devaient se rencontrer.
Ils rejoignent le groupe. Il a réservé une chambre pour deux personnes, elle une chambre individuelle qu’elle n’occupera pas.
Le bonheur de cette chambre interdite, leurs yeux brillent, bonheur insolent, entente évidente, ils essaient d’être discrets mais ils attirent la jalousie des autres, ceux qui partagent la même chambre par habitude, la jalousie et la suspicion. Un couple légitime ???
Pour l’heure ils se trouvent à Vérone, la ville des amants tragiques, ruisselante de chaleur et de touristes.
Ils se sont isolés sur une petite place silencieuse où de temps à autre une femme en noir voûtée comme un pardon s’avance avec un cabas en plastique. Pas de touristes.
Le silence et la chaleur, l’ombre maigre d’un jeune arbre qui peine en ce mois de juin. Les grandes dalles grises qui pavent la place reflètent une lumière dure, il est midi et demie et ils sont là, sur leur banc vert, à jouir de leur présence mutuelle.
Deux amoureux, à controverser sans cesse sur les mérites et l’acoustique du théâtre d’Ephèse ou celui d’Orange, la beauté du Colisée et celle des arènes de Nîmes, avec des « Chéri je ne suis pas d’accord » et des réponses tendres et murmurées. Ils aiment se disputer, faire assaut de culture pour éviter de marivauder bêtement mais c’est la séduction en marche, la roucoulade et la parade, le bonheur animal. C’est aussi une façon de reporter à plus tard ce qui les préoccupe : quand préviendront-ils leurs familles respectives ?
Sur la place de Bra, après s’être fait prendre en photo à côté d’un soldat romain devant les arènes, les autres touristes de leur groupe attendent leur plat du jour.
La guide leur a souri, complice et attendrie : s’ils étaient à 14 heures 30 devant le café, elle ne voyait aucun inconvénient à ce qu’ils ne mangent pas avec eux.
Ils ont trouvé cette petite place, regardé le trajet sur le plan de l’office du tourisme que la guide leur a fourni et ils soupirent d’aise et de bonheur. Seuls pour une heure et demie, seuls avec le sentiment puissant qui les submerge.
Vérone, la ville de Roméo et Juliette, la très vieille ville de Vérone réduite pour beaucoup aux très jeunes amants inventés par Shakespeare ou plutôt aux films qui leur ont raconté l’histoire.
Ils ont dû suivre le groupe, ce matin, la place des Seigneurs au touche-touche, impossible de respirer, impossible d’admirer, la guide avec son parapluie rose tout devant, le flot, les bousculades sous les arcades avant de finir par tourner dans une petite rue aux murs couverts de graffitis, la cour de la maison de Juliette, et dans un coin, quand ils réussissent à avancer, une petite statue en bronze sous un arbre, Juliette impuissante contre les abus lubriques des touristes.
Sur le balcon, une jeune fille salue la foule. Elle est vraiment très jolie, la municipalité a vraiment bien fait les choses en choisissant cette figurante ! mais voilà que la jeune fille aux cheveux longs rentre dans le bâtiment, remplacée par un quinquagénaire obèse qui salue à son tour, bientôt remplacé par son alter ego féminin. Aussi obèse et laide, salutations, ils en ont assez vu, se coulent dans le courant inverse.
– Tu as vu ? Pauvre petite Juliette, elle est devenue verte, seuls les seins sont d’un beau brillant doré tellement ils sont caressés, ils brillent comme un sous neuf…
Il rit doucement. Il aime son impertinence subtile, son humour un peu décalé, sa finesse. Il la regarde, ému, et lui prend la main pour la serrer.
Ils se taisent. Comme il fait chaud, les pierres comme des braises, la lumière au zénith, le ciel implacable et cette odeur de jasmin, d’où vient-elle ?
– Comme on est bien ! La température idéale dans l’endroit idéal… Chéri, j’ai repéré en marchant un endroit où l’on vend des salades.
– Je l’ai vu. Nous irons tout à l’heure, profitons encore un peu… C’est une si belle ville ! Si mal récompensée de sa beauté par les gens qui passent trop vite…
– Nous aussi, nous passons trop vite. J’aurais aimé que nous restions une semaine, tout seuls, sans le groupe.
– Tu sais bien que c’est impossible… Nous avons déjà eu de la chance de trouver ce circuit, et la guide est compréhensive. Il faut trouver le moment favorable, c’est compliqué. Nous avons le temps.
– Bien sûr, tout notre temps.
Elle soupire mais elle comprend.
Elle revient à la charge :
– Tu crois vraiment que nous arriverons à les tromper longtemps ?
Ils doivent ruser pour se retrouver, leur famille s’étonne des deux côtés :
– Un voyage organisé ? Encore ! Mais tu as toujours dit que tu détestais les troupeaux de moutons incultes qui avalent des sites au pas de course, tu te rappelles ?
– Oui, oui, mais ce voyage en Italie me tente, je n’ai pas le temps d’organiser…
Elle sait bien qu’il a raison. Elle aussi a peur du séisme que cela risque de provoquer, les enfants sont si conformistes ! Elle anticipe leur regard sidéré, elle redoute leurs rires. A quatre-vingt quatre ans, leur mère veuve depuis vingt ans a retrouvé l’amour ! Un veuf de quatre-vingt sept ans vous imaginez un peu ? Son cœur se serre, battements d’oiseaux noirs, il a compris son angoisse, il lui serre la main.
– Nous avons tout notre temps, ne t’inquiète pas ma chérie. Pour l’instant nous sommes à Vérone, la ville des amoureux.
– Oui, nous avons le temps…
Comme il fait chaud, comme ils sont bien ! Il regarde sa montre : presque quatorze heures, ils n’ont pas mangé, il faut aller trouver le marchand de salades avant de rejoindre le groupe.
 Voilà la saison de la rentrée littéraire, comme le Beaujolais nouveau ou la saison du blanc, et une obscure lassitude me saisit devant la quête toujours recommencée du roman qu’il ne faut surtout pas rater avant qu’il ait obtenu un prix. Je me suis tournée vers deux auteures du Sud des Etats-Unis, mortes toutes les deux depuis belle lurette.
Voilà la saison de la rentrée littéraire, comme le Beaujolais nouveau ou la saison du blanc, et une obscure lassitude me saisit devant la quête toujours recommencée du roman qu’il ne faut surtout pas rater avant qu’il ait obtenu un prix. Je me suis tournée vers deux auteures du Sud des Etats-Unis, mortes toutes les deux depuis belle lurette.
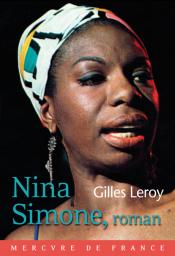

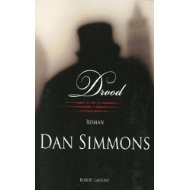
 La voix éraillée de Philippe Léotard
La voix éraillée de Philippe Léotard