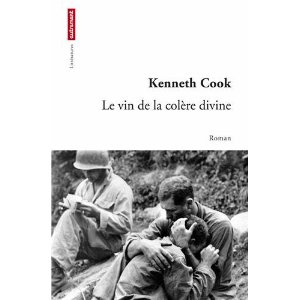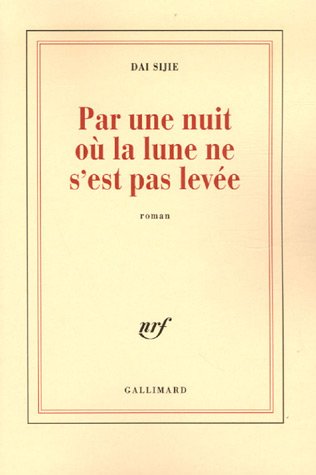 Par une nuit où la lune ne s’est pas levée nous conte la quête subtile et envoûtante d’un manuscrit sur rouleau de soie et nous piège dans un fascinant jeu de boîtes gigognes. « Appelons-le relique mutilée, ce petit bout de texte sacré écrit dans une langue déjà disparue sur un rouleau de soie qui, victime d’une violente crise de folie, fut déchiré en deux non par des mains, ni un poignard ou des ciseaux, mais bel et bien par les dents d’un empereur enragé ».
Par une nuit où la lune ne s’est pas levée nous conte la quête subtile et envoûtante d’un manuscrit sur rouleau de soie et nous piège dans un fascinant jeu de boîtes gigognes. « Appelons-le relique mutilée, ce petit bout de texte sacré écrit dans une langue déjà disparue sur un rouleau de soie qui, victime d’une violente crise de folie, fut déchiré en deux non par des mains, ni un poignard ou des ciseaux, mais bel et bien par les dents d’un empereur enragé ».
Commence l’histoire de ce texte et la raison pour laquelle il a été déchiré en deux par le dernier empereur de Chine, Pu Yi à travers la narration sinueuse d’un vieil érudit donnant la parole à… Pu Yi lui-même.
« Les péripéties de ce rouleau mutilé, bien que très captivantes, seraient restées éloignées de moi d’une distance insurmontable, entre ciel et terre, si je n’avais rencontré Tûmchouq quelques mois auparavant dans une certaine rue de la Petite-Inde. »
Tout s’emboîte parfaitement, une narration en entraîne une autre, la recherche de ce texte sacré déchiré en deux sert de fil conducteur à ce roman fascinant de l’auteur de Balzac et la Petite Tailleuse chinoise.
La jeune narratrice française est venue en Chine pour une thèse de doctorat, elle a fait connaissance de Tûmchouq, le jeune marchand de légume, dont elle est tombée amoureuse. Celui-ci porte le nom d’une langue disparue et il cherche la deuxième moitié du rouleau déchiré ; quête intime, – la recherche du père inconnu –, quête historique, – l’histoire de la Chine ancienne et celle de Mao –, quête spirituelle avec le bouddhisme.
Tûmchouq s’avère être le fils du grand sinologue Paul d’Ampère, et il est déchiré entre ses identités chinoise et française. L’érudition de l’auteur concerne aussi bien l’histoire de la Chine impériale que l’histoire du bouddhisme, et le roman est écrit dans une trame si serrée que j’ai cru que le sinologue Paul d’Ampère avait existé…
Ce texte déchiré écrit dans une langue disparue pleine de douceur ne serait-il pas la jeunesse passée de la narratrice, les blessures impossibles à guérir, le paradis perdu de ce que nous ne possédons ni ne comprenons plus ?
« Le jour se levait à peine, le chemin de sable minutieusement balayé, sans une feuille morte, scintillait sous mes pieds nus, et chacun de mes pas, je le sentais, était un acte de méditation. Avec son sable et ses quelques pierres posées çà et là comme au milieu des cendres éteintes, unies, finies, refroidies des passions, sans une seule étincelle de braise risquant de se rallumer, le petit sentier ressemblait à la vie de qui l’empruntait. Peut-être son créateur voulait-il ainsi nous rappeler que nos empreintes disparaîtraient tels les beaux jours de notre vie, au premier coup de vent, sans laisser la moindre trace. »

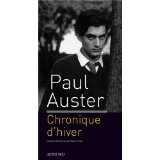

 Une conférence, pour moi, est toujours un événement conflictuel. La tension pendant que je prépare mes notes, les attentes que je suppose chez les personnes qui feront l’effort de se déplacer pour entendre parler de Louis Favre, ma crainte de ne pas savoir faire passer à quel point cet homme était exceptionnel par son envergure morale : ce n’est pas un moment de plaisir mais toujours un stress. Je continue pourtant, car ce qui est important vient après la conférence…
Une conférence, pour moi, est toujours un événement conflictuel. La tension pendant que je prépare mes notes, les attentes que je suppose chez les personnes qui feront l’effort de se déplacer pour entendre parler de Louis Favre, ma crainte de ne pas savoir faire passer à quel point cet homme était exceptionnel par son envergure morale : ce n’est pas un moment de plaisir mais toujours un stress. Je continue pourtant, car ce qui est important vient après la conférence…