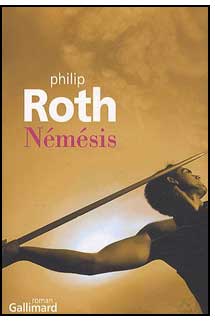Je peux crier ma peur devant le dieu Soleil, prier la déesse Nuit, sangloter dans la forêt, me boucher les oreilles pour ne pas entendre les tambours : je ne pourrai échapper au destin que les chiffres m’ont assigné.
Lorsque je suis né le Gardien des Jours a longuement scruté le livre du destin. Mes parents se taisaient, mes frères aussi.
– Il est né le jour 20 du couteau de silex : le dernier jour du mois qui est aussi le premier du mois suivant. Jour fondateur, jour de passeur, a conclu le prêtre avant de tendre la main pour recevoir son dû.
Tout petit je savais déjà que je ne serais pas paysan toute ma vie : on me demandait moins de travail dans les champs et on me fouettait moins fort que les autres.
Mais j’ai oublié, dans la monotonie des jours et des sacrifices auxquels nous étions tous obligés d’assister, que j’étais né sous le signe du couteau de silex.
Un jour après l’autre, les treize mois de tsolk’in et les dix-huit mois de l’ha’b, qui suit la course du soleil. Planter le maïs, creuser les canaux d’irrigation, danser pendant les fêtes puisque c’est notre rôle, à nous les paysans, placés sous le signe du maïs, maîtres et serviteurs de la fertilité, gages de la nourriture de l’Empire et de sa stabilité.
Un jour après l’autre, et la mort de mes parents, et le choix de ma femme, la date du mariage décidée par Celui qui compte les jours.
Une nouvelle maison, deux nattes neuves et un coffre, les vêtements du mariage et ceux des champs, et chaque matin le soleil qui accepte de se lever après le son déchirant des conques dans lesquelles soufflent les prêtres.
Le tsolk’in et l’ha’b vont bientôt se rejoindre ; les deux calendriers vont terminer leur course par le même jour plein de menaces pour l’ordre du monde. Dans tout l’Empire les hommes se mettent à compter les jours, les fêtes en l’honneur du Dieu Soleil se multiplient. Nous connaissons la cruauté des Dieux et la violence du passage du temps : et si, cette fois, c’était le Cinquième Soleil et la disparition de notre univers ?
J’ai dansé à la dernière fête du Soleil, comme j’ai dansé ! Tout le jour sans m’arrêter, avec le regard des prêtres rivé sur ceux qui s’arrêtaient d’épuisement. J’ai dansé, dansé, avec les pieds qui saignent et l’esprit qui s’évade, les martèlements des tambours à la place de ceux de mon cœur. Nous n’étions plus que deux sur l’aire de danse et nous nous sommes écroulés en même temps, au moment où le dieu Soleil est apparu à l’horizon.
On m’a porté jusqu’à ma maison, posé sur ma natte. J’ai dormi presque deux jours, ma femme m’a réveillé avec de l’eau fraîche.
La cérémonie du Feu Nouveau aura lieu dans un Winal, Dieu Soleil ne se lèvera plus que vingt fois, les doigts des hommes s’agitent de terreur, comptent et recomptent en écoutant les conques supplier le soleil.
Il se murmure qu’une grande activité règne parmi les prêtres et qu’ils consultent tous les actes de naissance.
Partout dans l’Empire c’est une agitation sans pareille : les potiers, les tisserands, les coupeurs de joncs et les tresseurs de nattes travaillent nuit et jour. La grande cérémonie où le monde basculera dans un autre Temps approche.
Les consignes sont impératives : le dernier Soleil il faudra tout purifier dans nos maisons et détruire tout ce qui fait le quotidien de notre vie.
Nous allons casser toute notre vaisselle et la jeter dans le lac, nous allons brûler nos coffres, nos nattes, nos vieux vêtements. Nous allons nettoyer la maison vide, elle sera prête pour un nouveau cycle de temps.
Alors nous éteindrons tous les feux, nous traquerons la moindre étincelle pour l’écraser sous le talon.
Le noir partout dans l’Empire, noir sur les arbres et les cités, et les millions d’étoiles qui attendent.
Nous aurons supprimé la source de vie.
Le noir et le silence. Cela a toujours été ainsi, et nous attendons avec crainte ce terrible moment que nul ne connaît.
Personne ne peut raconter ce moment où l’humanité est plongée dans le noir et se tait. Ce moment de peur où l’on se demande si le soleil voudra bien se lever à nouveau, si le Temps recommencera.
Les prêtres sont venus jusqu’à ma maison, trois Soleils avant la fin du Temps.
Je suis l’élu du sacrifice moi qui ai dansé si longtemps à la dernière fête du soleil, je suis celui qui est né le dernier jour du mois et le premier du mois suivant du couteau de silex, le signe du sacrifice, je suis celui qui va mourir pour faire renaître le Temps.
Ils m’ont révélé le secret de la cérémonie : peu avant minuit, on m’attachera sur la table du sacrifice et on m’arrachera le cœur avec le couteau de silex. On remplira le trou d’une étrange mixture poisseuse avant que le grand prêtre approche son bâton à feu ; il fera jaillir la première flamme du feu nouveau sur ma poitrine.
On m’arrachera le cœur et le cycle du temps recommencera, la source de vie reprendra son cours et toute chose connaîtra de nouveau la lumière.
Ce premier feu au creux de ma poitrine. Et les Messagers penchés sur moi, leur torche qui flambe, leur procession lumineuse dans la nuit jusqu’aux temples les plus reculés de l’Empire.
Ils viendront tous prendre le feu et rallumer le foyer, ma femme dans la procession, tête baissée. Elle ne pleurera pas. Elle n’aura prévu qu’une seule natte neuve, la communauté lui offrira un très beau coffre et des vêtements de lin blanc.
Petit à petit, dans tout l’Empire, des processions de lumière, des points brillants et mouvants par milliers, les maisons qui se remplissent de meubles et de vêtements neufs, la vie qui reprend, une impression de pureté, le premier moment d’un nouveau cycle de vie, ce moment que personne ne connaîtra de nouveau, enfant ou adulte.
Et le soleil, rassuré par ce monde nouveau, aura envie de se lever et de reprendre sa course.
Je peux crier ma peur devant le dieu Soleil, prier la déesse Nuit, je ne m’enfoncerai pas dans l’obscurité de la forêt. Chacun me porte, me sourit, me surveille. Ma femme la première.
Plus que quatre Soleils.
Je les entends, les tambours de la procession, la marche entre deux rangées de prêtres avec les voisins et mes frères qui me sourient, ma femme qui regarde le sol.
Il n’y aura pas de Cinquième Soleil.
 Bonjour à tous!
Bonjour à tous!