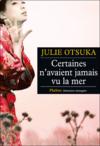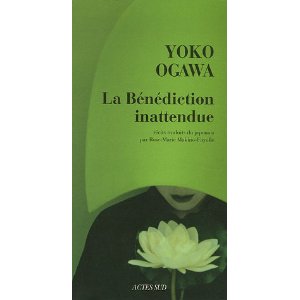 Mélange de fantastique et de rouerie, de vertige métaphysique et de sensations triviales, cette Bénédiction inattendue de la japonaise Yoko Ogawa nous plonge au cœur de la création romanesque d’une manière à la fois exotique, vertigineuse et intime.
Mélange de fantastique et de rouerie, de vertige métaphysique et de sensations triviales, cette Bénédiction inattendue de la japonaise Yoko Ogawa nous plonge au cœur de la création romanesque d’une manière à la fois exotique, vertigineuse et intime.
Tout coule de source dans les récits indépendants qui composent ce livre et nous ne voyons rien venir : nous ressortons de ce livre éblouis comme dans ces numéros de close-up où le magicien se trouve à côté de nous et nous mystifie de la plus belle des manières.
Cela fait longtemps que je n’ai pas ressenti une telle jubilation.
Le premier récit – Le Royaume des disparus – nous présente la narratrice : « En pleine nuit, lorsque je suis en train d’écrire mes romans dans ma chambre qui est aussi mon bureau, il m’arrive parfois de me trouver incroyablement arrogante, stupide et ridicule ».
Le ton est donné. La narratrice – dont nous ne connaîtrons jamais l’identité – est plutôt jeune (aucune précision, seulement un faisceau d’indices), écrivain, elle vit seule avec son bébé et son chien Apollo. Précision étrange : le petit garçon n’a « qu’un seul ami, un escargot en peluche ». Elle confond la respiration de son fils avec celle de son chien…
Et elle ne s’aime pas beaucoup, pleine de doutes et d’angoisse, perdue dans la forêt hostile du roman à construire, tombant dans une grotte humide et sombre, aspirée dans le monde des disparus.
En moins de trois pages nous sommes tombés dans un piège dont nous refuserons de sortir, fascinés par cet entrelacs de souvenirs réels ou fantasmés, incapables de démêler réel et fiction, délicieusement piégés par cette écriture si fluide et si perverse qui nous enfonce dans des méandres incroyables. Jamais le lecteur n’arrive à savoir ce qui appartient à la vie de la narratrice, à ses souvenirs, ses peurs, ses fantasmes. Coincé dans une mise en abîme vertigineuse, manipulé, la chute éblouissante laisse le lecteur pantelant.
Je vous donne un exemple avec le deuxième chapitre intitulé Plagiat.
« Mon premier roman accepté par une revue littéraire, mon premier roman qui m’a rapporté de l’argent, le premier roman de ma vie qui m’a offert une petite place rien qu’à moi dans ce monde sans but, était un plagiat ».
Là-dessus, aucun remords ou gêne, l’auteur raconte.
Cela se passait à un moment difficile de sa vie, après la mort de son jeune frère tabassé à mort par un groupe de délinquants juste avant ses vingt-et-un ans. Histoire familiale douloureuse, difficulté de n’être que la sœur aînée d’un cadet champion de sport, objet de toute l’attention maternelle. L’enterrement de celui-ci scelle l’impossible réconciliation familiale. L’auteur s’enfonce dans la déprime et ne peut plus écrire.
Peu de temps après la narratrice est victime d’un très grave accident : le conducteur d’une camionnette de boulangerie industrielle s’est endormi au volant et a bifurqué sur le trottoir où marchait la narratrice. Opérations, rééducation à l’hôpital.
Dans le train qui la mène à l’hôpital elle fait la connaissance d’une jeune femme très belle et tous les mardis les deux femmes font une partie du trajet ensemble avant de se séparer. Un jour la belle jeune femme raconte son histoire : elle rend visite à son jeune frère, ex-champion de natation, de dos crawlé plus exactement. Celui-ci, à la veille de son départ pour les Jeux Olympiques juniors, n’a plus pu baisser son bras gauche : « Exactement comme s’il s’était arrêté dans son élan juste avant de pénétrer dans l’eau ». Le bras noircit mais ne redescend jamais.
Collusion de vécus : les deux femmes ont chacune à leur manière été l’enfant que l’on ne regardait pas, chacune a regardé vivre l’enfant chéri de la famille, le champion de sport à la trajectoire foudroyée par un événement imprévu, mystérieux et un peu stupide.
Mise en abîme, poupées gigogne, tous les éléments de la narration depuis les Mille et une nuits.
La narratrice, apaisée par ce double de sa propre histoire, retrouve l’usage des mots et écrit l’histoire de ce jeune garçon sous le titre de Backstroke, c’est-à-dire « dos crawlé ». Celui-ci devient son premier livre publié et la narratrice ne revoit pas la jeune femme du train. Sept ans plus tard, suite à l’opération destinée à enlever les derniers boulons dans son genou, la narratrice se rend dans le même hôpital mais bifurque dans l’aile psychiatrique où se trouvait le frère de la jeune femme.
« Soudain j’ai remarqué quelque chose sur la table basse. Un mince livre de poche en anglais : « Backstroke », y avait-il écrit.
Un vieux livre à la couverture usée, aux couleurs passées. L’auteur en était une femme née en 1901 dont je n’avais jamais entendu parler, au sujet de laquelle on ne donnait pas beaucoup de détails. Un nom compliqué à écrire, impossible à prononcer. Je me suis assise sur le sofa, et j’ai commencé à lire la première page. C’était l’histoire d’un frère cadet champion de natation s’approchant progressivement de la mort à partir de son bras gauche. Là se trouvait le récit que j’avais écrit, celui qu’elle m’avait raconté. Le livre avait beau être en lambeaux, le récit n’avait rien perdu de son attrait.
J’ai refermé le livre, l’ai posé sur la table. Il baignait dans la tiédeur du soleil. Mon fils a ouvert les yeux, a commencé à s’agiter. J’ai placé son escargot en peluche près de son visage ».
Tout simplement éblouissant.
Tout fonctionne en écho : la camionnette de la boulangerie qui a failli tuer la narratrice et l’envoie pour trois mois à l’hôpital se retrouve plus loin avec un apprenti boulanger qui offre toujours trois petits pains à la jeune fille qui garde la narratrice, ce jeune homme timide finissant par se suicider. Tout se retrouve en cascades, des lettres ou du stylo, des mots perdus ou retrouvés, des souvenirs ou des regrets.
« Je ne sais pas pourquoi, lorsque j’écris un roman, j’ai l’impression de me trouver dans un atelier d’horlogerie.
Un atelier d’horlogerie ?
Je regarde autour de moi en me posant la question. Mais il y a bien là un atelier en briques sagement blotti au fond d’une sombre forêt.
Un établi, dans une morne pièce rectangulaire. Par la fenêtre, on ne voit rien d’autre que le vert des arbres enchevêtrés. Le sol carrelé est très froid.
Je suis seule, assise sur un tabouret, en train de fabriquer une montre depuis des jours et des jours. Le socle en acier inoxydable que j’ai pourtant dépoussiéré avec soin est parsemé de grains de sable, de pellicules, de cérumen et de postillons. Pour éviter d’introduire des impuretés, je fais très attention à l’extrémité de mes doigts.
Je dois fabriquer une montre parfaitement équilibrée, qui n’ait pas le moindre défaut. Je remonte le ressort, serre des vis, insère l’axe. J’enlève l’excès d’huile avec de la benzine, observe à la loupe pour voir si certains éléments ne sont pas abîmés.
Bientôt, je sens que le monde est entre mes mains. Le monde palpite au creux de ma paume. Alors que mon corps si faible est rejeté dans un coin à l’écart du monde.
Le ressort produit une force motrice régulière, les roues dentées de l’engrenage s’emboîtent l’une dans l’autre, la grande et la petite aiguille arpentent les graduations.
Cet espace, ce contour et cette éternité calculés. Comme c’est beau ! Je me figure souvent l’objet terminé, plongée dans l’extase.
Et pourtant, ce qui est maintenant devant mes yeux, inachevé, est laid. Il y a des distorsions, des relâchements irréparables. Je démonte tout et recommence à zéro. (…)
Je me remets au travail. Des rognures d’ongles, des pellicules, des cils et des bouts de peau se dispersent à nouveau, qui salissent mon univers ».
Peut-on trouver plus somptueuse métaphore du travail d’écrivain ?
A peine terminée, j’ai repris la lecture de cette Bénédiction inattendue qui porte si bien son nom, confondue par tout ce qui m’avait échappé la première fois et dont je ne vous ai pas parlé. Chacun s’approprie le texte, je vous laisse découvrir vos propres trésors dans cette grotte japonaise où tant de fleurs s’épanouissent dans le froid et l’humidité.

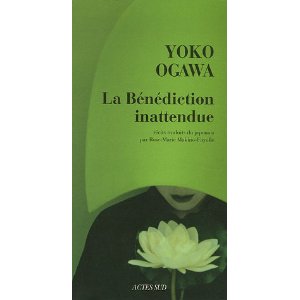

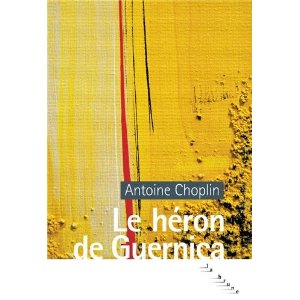 Après Cour Nord aux éditions du Rouergue, Antoine Choplin publie Le héron de Guernica dans la même maison.
Après Cour Nord aux éditions du Rouergue, Antoine Choplin publie Le héron de Guernica dans la même maison.