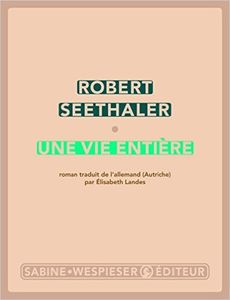Personne ne transforme le suspense en poésie comme James Lee Burke.
Comment résister à cet appel de la quatrième de couverture de Creole Belle ? C’est un épais roman publié en français aux éditions Payot-Rivages, un thriller de 620 pages dont la plupart se lisent avec passion, mélancolie et douceur, dans un état de tension qui ne connaît pas de répit.
 L’ouragan Katrina et la pollution provoquée par l’explosion de la plateforme Deepwater dans le golfe du Mexique, le fatalisme des pauvres et l’abandon du gouvernement fédéral forment la trame objective de ce roman noir. Le reste est création littéraire, mélancolie et superbe écriture.
L’ouragan Katrina et la pollution provoquée par l’explosion de la plateforme Deepwater dans le golfe du Mexique, le fatalisme des pauvres et l’abandon du gouvernement fédéral forment la trame objective de ce roman noir. Le reste est création littéraire, mélancolie et superbe écriture.
Ce volume fait partie du cycle des aventures de l’inspecteur Dave Robicheaux à la Nouvelle-Orléans, et au début du récit celui-ci se trouve plutôt mal en point. Il est sujet à des hallucinations à l’hôpital où il pense qu’une jeune femme, Tee Jolie Melton, lui a rendu visite. Est-ce l’effet de la morphine ? Physiquement, cela s’arrange au fil des pages, quoique Tee Jolie ressurgisse au téléphone alors qu’elle a disparu et qu’on a retrouvé le cadavre de sa petite sœur congelé dans un bloc de glace flottant sur l’eau.
Ce n’est pas le seul mystère de ce roman noir, entre politiciens véreux et flics pourris, alcool et exécutions, combats et enquête têtue, on se retrouve dans un parfait produit de la littérature de suspense. Tous les ingrédients sont connus et utilisés à la louche : disparitions, meurtres, vengeances, traques diverses, obsessions du personnage principal, tout y est. Y compris le méchant encore pire qu’on l‘imagine et une nébuleuse menaçante. Y compris le psychopathe de service et les scènes de combat, ou bien la famille de Clete menacée d’une manière particulièrement perverse.
Nous reconnaissons bien sûr les ficelles du thriller pourtant nous nous laissons prendre très vite et le livre fonctionne à merveille : la tension de l’action dramatique malgré les faiblesses évidentes (invraisemblances et autres difficultés à nouer l’intrigue) ne se relâche pas. Quant à la puissance d’évocation de la Louisiane et la poignante nostalgie que distille le blues qui donne son titre au livre, elles vous maintiennent dans une obsédante note bleue.
Creole Belle est un hymne aux écorchés de la vie, ceux qui se défendent à leur façon contre les cauchemars de la guerre ou d’une enfance meurtrie. L’alter ego de l’inspecteur, son ami Clete Purcel, détective privé depuis qu’il a été viré de la police, essaie en vain de chasser les tourments du Viet-Nam avec de l’alcool. Sa fille Gretchen, découverte sur le tard, pourchasse les hommes qui l’ont torturée enfant pour les éliminer. Gretchen est tueuse à gage et Clete essaie à la fois de la protéger et de l’aider ; difficile quand il s’avère que la jeune femme doit honorer un contrat contre la famille de son ami Dave Robicheaux…
Comme les héros sont tristes, comme ils sont fragiles ! Ils sont nostalgiques de la Louisiane d’antan, avant le pétrole et l’ouragan Katrina, avant la dégradation de l’environnement et celle de la morale. Creole Belle est à la recherche d’un paradis perdu où le bien triompherait du mal, où les hommes ne vendraient pas la nature pour de l’argent. Combat naïf et perdu d’avance, mais il y a les somptueuses descriptions de la pluie et du soleil sur le bayou, le grincement métallique du pont qui se soulève, la vie qui s’infiltre dans les moindres recoins de cette région où l’eau et la terre ne sont pas vraiment différenciées.
Au fur et à mesure que le soleil descendait dans un banc de cumulo-nimbus, à l’ouest, le ciel, d’or et de pourpre, tournait au vert. La brise sentait la pluie déversée par les nuages venus du golfe, et l’odeur de frai montant des marais. Elle sentait les pelouses fraîchement tondues, les arroseurs frappant le ciment chaud et le charbon de bois sur un gril. Elle sentait les chrysanthèmes épanouis dans les jardins noyés d’ombre, nous disant que la saison n’était pas encore terminée, que la vie était encore une fête et qu’on ne devait pas y renoncer sous prétexte que la nuit approchait.(p.255)
La poésie s’infiltre comme l’eau dans les pages du roman, une musique lancinante et superbe, même si l’on peut s’agacer de certaines faiblesses de traduction et de fautes de langues :
Une lumière s’éteignait pour toujours dans la maison de quelqu’un et le reste d’entre nous poursuivions nos existences. Le scénario était toujours le même. Les visages des acteurs changeaient, mais le script d’origine avait sans doute été écrit au charbon, il y a bien longtemps, sur le mur d’une grotte, et je suis persuadé que, depuis, nous sommes livrés à ses exigences. (p. 538-539)
La lutte contre le mal est comme le tonneau des Danaïdes et les héros sont fatigués.
Existe-t-il un sort pire que de se sentir approuvé ? Les gens qui acceptent le monde tel qu’il est vous ont-ils jamais appris quelque chose de nouveau ? Les individus les plus courageux que j’ai rencontrés sortent de nulle part et accomplissent des actes héroïques qu’on associe généralement aux parachutistes, mais ils sont tellement banals que lorsqu’ils ont quitté la pièce, on a du mal à se rappeler leurs traits. (p. 616)
Au final, James Lee Burke a-t-il écrit un thriller ? Un roman de société ? Une ode triste à la Louisiane ? Cela n’a pas vraiment d’importance, chacun choisira sa propre grille de lecture.
James Lee Burke
Traduit de l’anglais (états-unis) par Christophe MERCIER
Rivages, avril 2014, 624 p., 22 €
ISBN : 978-2743627362

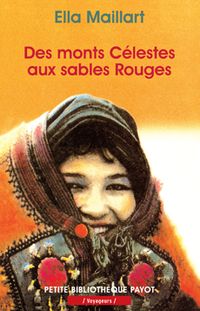 À 5 000 mètres d’altitude dans le Turkestan soviétique, à dos de chameau ou à cheval, précipices et montagnes grandioses – sujets au mal des montagnes et au vertige s’abstenir – la jeune femme désire rencontrer les nomades d’Asie Centrale de l’empire soviétique.
À 5 000 mètres d’altitude dans le Turkestan soviétique, à dos de chameau ou à cheval, précipices et montagnes grandioses – sujets au mal des montagnes et au vertige s’abstenir – la jeune femme désire rencontrer les nomades d’Asie Centrale de l’empire soviétique. Cette fille de la bonne société genevoise (père fourreur, mère danoise grande sportive) n’a sans doute jamais rêvé chiffons et princes charmants ; elle préférait des actions beaucoup plus musclées : la jolie blonde un peu carrée d’épaules a fondé à seize ans le premier club féminin de hockey sur terre de Suisse romande ! Elle a continué en faisant de la voile à un haut niveau de compétition ; elle fut la plus jeune barreuse aux régates olympiques de 1924 où elle représenta la Suisse, et accessoirement la seule femme de la compétition. De 1931 à 1934 elle participa aux premiers championnats du monde de ski alpin dans l’équipe suisse.
Cette fille de la bonne société genevoise (père fourreur, mère danoise grande sportive) n’a sans doute jamais rêvé chiffons et princes charmants ; elle préférait des actions beaucoup plus musclées : la jolie blonde un peu carrée d’épaules a fondé à seize ans le premier club féminin de hockey sur terre de Suisse romande ! Elle a continué en faisant de la voile à un haut niveau de compétition ; elle fut la plus jeune barreuse aux régates olympiques de 1924 où elle représenta la Suisse, et accessoirement la seule femme de la compétition. De 1931 à 1934 elle participa aux premiers championnats du monde de ski alpin dans l’équipe suisse.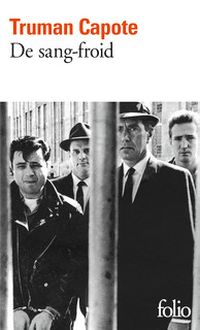
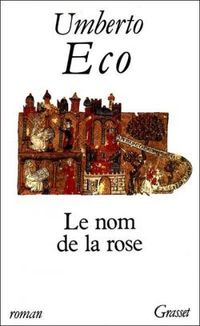 Umberto Eco vient de mourir, et le Nom de la rose me revient en mémoire, ce roman si riche, si érudit et si profond dont la lecture m’a imprégnée durablement.
Umberto Eco vient de mourir, et le Nom de la rose me revient en mémoire, ce roman si riche, si érudit et si profond dont la lecture m’a imprégnée durablement.
 Pour Hildegarde, le rire est le propre du diable. La dérision est l’arme des esprits malins qui ont contesté la suprématie de Dieu. C’est le diable en action qui provoque ce rire irrépressible qui ne peut-être canalisé, ce si justement nommé fou-rire, irruption de l’animalité pour la grande visionnaire du XIIe siècle. Elle associe le rire de l’homme au plaisir charnel d’où la comparaison des larmes de rire avec le sperme… Hildegarde de Bingen a été mise en échec par un démon moqueur lors de tentatives d’exorcisme, ceci explique peut-être cela.
Pour Hildegarde, le rire est le propre du diable. La dérision est l’arme des esprits malins qui ont contesté la suprématie de Dieu. C’est le diable en action qui provoque ce rire irrépressible qui ne peut-être canalisé, ce si justement nommé fou-rire, irruption de l’animalité pour la grande visionnaire du XIIe siècle. Elle associe le rire de l’homme au plaisir charnel d’où la comparaison des larmes de rire avec le sperme… Hildegarde de Bingen a été mise en échec par un démon moqueur lors de tentatives d’exorcisme, ceci explique peut-être cela.