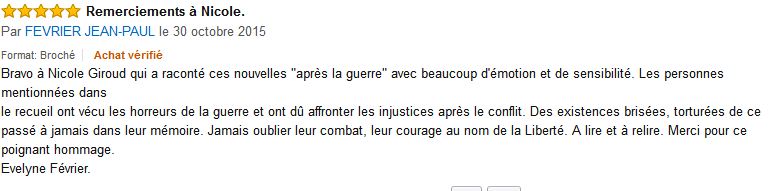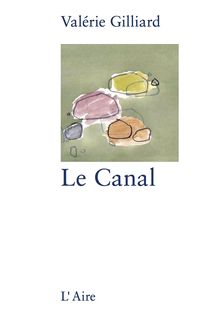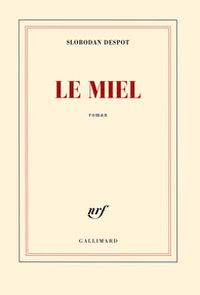Contrairement à mes principes j’ai accepté de chroniquer un livre pour Babelio et le moins que l’on puisse dire c’est que je ne l’ai pas regretté : j’ai dévoré Celles de la rivière en une très longue soirée. Ce n’est qu’après lecture que je me suis inquiétée de savoir ce qu’étaient ces éditions Mosaïc dont j’ignorais l’existence. Heureusement, car mes préjugés m’auraient peut-être fait abandonner la lecture…
Contrairement à mes principes j’ai accepté de chroniquer un livre pour Babelio et le moins que l’on puisse dire c’est que je ne l’ai pas regretté : j’ai dévoré Celles de la rivière en une très longue soirée. Ce n’est qu’après lecture que je me suis inquiétée de savoir ce qu’étaient ces éditions Mosaïc dont j’ignorais l’existence. Heureusement, car mes préjugés m’auraient peut-être fait abandonner la lecture…
Celles de la rivière est paraît-il le premier roman de l’auteure américaine Valerie Geary. Si c’est vraiment le cas, je suis suffoquée d’admiration par sa maîtrise parfaite de la tension dramatique et ce dès la toute première phrase. Jugez plutôt :
La femme flottait entre deux eaux quand nous l’avons découverte dans les remous, là où le lit de la rivière Crooked s’incurve en direction du nord, à un jet de pierre du meilleur endroit pour nager dans le coin.
Sam et Ollie viennent de trouver un cadavre. Un roman policier de plus ? Pas si simple… La réaction distanciée des deux sœurs, leur absence d’horreur face au cadavre saisissent le lecteur :
Je voulais essayer de toucher la morte. Est-ce qu’elle serait comme ma mère : froide, caoutchouteuse, un vrai ballon dégonflé ?
Vous n’en êtes qu’à la page deux et vous êtes désormais happé par cette histoire pratiquement impossible à lâcher avant le dénouement. Quatre cents pages de suspense, de tension, sans bavardages inutiles malgré l’abondance de dialogues entre Samantha et sa sœur Olivia. Des échanges étranges car la petite Ollie ne parle plus depuis la mort de sa mère quelques semaines plus tôt :
Il y a beaucoup d’ombre dans la voiture. Ainsi, je vois celle de la rivière, assise à l’arrière, juste derrière ma sœur. Ses dents sont comme des crocs. Ses yeux, des pierres noires et froides qu’elle pose sur moi. Elle ondule et elle crache. Elle veut que je lui prête ma voix. Elle veut que je dise Ce n’est pas juste. Ce n’est pas lui. Mais je ne peux pas. Je ne le ferai pas.
Si je le fais pour elle, alors il faudra que je le fasse pour tous les autres, et mes mots les miens, ceux qui sont à moi, rien qu’à moi et à personne d’autre n’auront plus du tout d’importance, ils seront jetés, enterrés profondément et piétinés par tous les autres.
Alors je me tais.
Ollie se tait pour conserver sa propre voix et ne pas être submergée par les présences qui l’envahissent. Elle communique pourtant avec sa sœur en soulignant des phrases d’Alice au pays des merveilles. Ollie a traversé le miroir. Quant aux phrases Ce n’est pas juste. Ce n’est pas lui de la jeune morte assassinée, elles concernent Ours, le père d’Ollie et de Sam.
Il ne s’appelle pas Ours, bien sûr, mais c’est la façon dont tout le monde le surnomme, cet homme qui habite dans un tipi proche de la rivière Crooked, cet ermite qui vit de son potager et du miel de ses abeilles depuis huit ans. Étrange famille en vérité : la mère vivait seule avec ses filles, l’aînée rejoignant son père durant l’été pour vivre en pleine nature. Mais la mère est morte quelques semaines plus tôt et les deux filles vivent avec leur père dans cette nature amoureusement décrite dans le roman. Les abords de la rivière sont un personnage du livre, tout comme les abeilles.
Sam a voulu protéger son père en cachant ce qu’elle a vu et l’a désigné sans le vouloir comme coupable idéal. Les deux filles cherchent alors la vérité dans la petite ville qui a condamné leur père d’avance.
Le roman est construit en alternance, un chapitre pour Ollie, un chapitre pour Sam. Deux façons d’appréhender les événements, deux façons de surmonter le deuil de leur mère et les accusations d’assassinat portées contre leur père.
Ollie a dix ans, elle est accompagnée par le fantôme bienveillant de sa mère et de nombreux autres beaucoup plus inquiétants ; elle doit accepter de laisser partir sa mère, elle doit accepter de grandir et de revenir de l’autre côté du miroir mais c’est difficile.
Sam a quinze ans et découvre ses premiers émois sensuels, elle doit s’occuper de sa sœur, la protéger. Les deux filles découvrent des éléments dramatiques concernant le passé de leur père, elles doivent apprendre que la vie n’est pas toujours limpide.
Magnifique roman, vraiment, d’une richesse inattendue : l’intrigue policière est parfaite, pleine de rebondissements, avec une fin terrifiante et ambiguë que vous découvrirez avec plaisir ; les rites de passage à l’âge adulte vous surprendront par leur finesse, tout comme la progression de l’acceptation du deuil de la mère ; quant à la rivière Crooked, elle apporte poésie et lyrisme, éléments bienvenus dans ce roman qui serait autrement beaucoup trop sombre.
J’ai personnellement été surprise que ce livre soit édité par les éditions Mosaïc, filière des éditions Harlequin. Que l’on se rassure, pas une once de guimauve sinon au bout de la pique d’Ollie qui ne l’aime que brûlée. Un regret cependant : la couverture du livre est mince et gondole très vite sous les doigts fiévreux des lecteurs. Un si beau roman aurait mérité à mon avis un meilleur traitement.