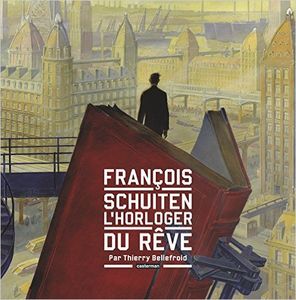Ce matin le général Desportes était l’hôte du 7/9 sur France Inter où il venait présenter le titre de son dernier livre que je n’ai pas retenu. Il expliquait la nécessité de la guerre et déplorait le lamentable état de l’armée française victime de coupes budgétaires incessantes. Bien sûr. C’est vrai que l’on oublie la guerre, que nous nous sentons en sécurité dans notre pays où le fracas des bombes s’est tu depuis soixante-dix ans. C’est vrai que nous n’avons pas pris la mesure du danger de ce qui se passe de l’autre côté de la Méditerranée et que la guerre ne s’arrête jamais.
Ce matin le général Desportes était l’hôte du 7/9 sur France Inter où il venait présenter le titre de son dernier livre que je n’ai pas retenu. Il expliquait la nécessité de la guerre et déplorait le lamentable état de l’armée française victime de coupes budgétaires incessantes. Bien sûr. C’est vrai que l’on oublie la guerre, que nous nous sentons en sécurité dans notre pays où le fracas des bombes s’est tu depuis soixante-dix ans. C’est vrai que nous n’avons pas pris la mesure du danger de ce qui se passe de l’autre côté de la Méditerranée et que la guerre ne s’arrête jamais.
Cependant quelque chose me gênait dans le discours du général, et j’ai mis du temps à mettre le doigt dessus. C’était la fascination de la guerre. Le général a déploré qu’on ne parle plus de la guerre à ces jeunes élites qui n’ont jamais connu la conscription et pour qui le service militaire se résume à une journée folklorique. Il a parlé de grands attentats inévitables dans notre pays et a conclu son intervention par une belle formule frappée du sceau des études classiques :
La guerre, cet outil terrible et parfois légitime.
Pas un instant le général n’a parlé des civils, on sentait que c’était hors sujet, que cela ne faisait pas partie de son propos. L’armée. La guerre. Le danger. Une forme de virilité abstraite où la protection de la Civilisation passe par l’héroïsme des hommes et la qualité du matériel. Quant aux dommages collatéraux, ce ne sont que billevesées. Le discours était réaliste mais il manquait d’humanité.
Moi je m’intéresse aux civils, à ceux qui fuient les bombes et affrontent le danger, sans savoir que lorsque le silence sera revenu, ce sera peut-être encore une autre forme de guerre. Je ne peux conseiller au général de lire mon recueil de nouvelles intitulé justement Après la guerre, il ne comprendrait pas. Ce livre est issu de témoignages de ceux qui ont été victimes d’affrontements qui les dépassaient, ils étaient enfants pour la plupart d’entre eux et longtemps après « cet outil terrible et parfois légitime » continue à déchirer le tissu de leur existence.