Ce cartoon figurait parmi les dessins de presse pour le palmarès 2014 au printemps. Il aurait pu dater d’hier, il pourrait représenter demain si rien ne change, il est intemporel.
On préfèrerait qu’il se périme…

L’Anthogrammate (Kindle) sera gratuit les vendredi et samedi 29 et 30 août : profitez-en ! Cela devrait vous mettre du cœur à l’ouvrage et de l’enthousiasme face à la page vierge qui s’ouvre devant vous : BONNE RENTRÉE À TOUS !
C’est avec une pointe de nostalgie que Marguerite Letourneur, institutrice à la retraite, contemple l’excitation de la jeunesse au rayon « rentrée » des supermarchés. Une toute petite pointe, en vérité, et sacrément émoussée. Surtout que c’est le moment où elle doit se montrer patiente et écouter ses anciens collègues soupirer au téléphone que c’est chaque année plus difficile. Marguerite les rassure, allons, allons, tu verras, ça va bien se passer… À la Toussaint, ils auront pris le rythme de travail, tu verras…
Ensuite, toute guillerette, elle se prend un café avec un chocolat, sort sa carte au 1 / 25 000 et son carnet. Elle vérifie d’un coup d’œil machinal dans son dressing si sa tenue de pauvresse et les produits pour les aveugles sont bien dissimulés à la curiosité de la femme de ménage. Il faudra éviter les mères de familles et les grands-parents très investis dans la garde de leurs petits-enfants. Pas disponibles avant la troisième semaine de septembre, impossible de pénétrer dans des foyers pleins d’excitation devant les livres à couvrir, les questionnaires et les étiquettes.
Marguerite défait l’enveloppe métallisée de son chocolat et songe à ses anciens collègues : pourquoi ne liraient-ils pas ses aventures avant la rentrée, histoire de conjurer le sort et de rire ? Alors comme l’enseignement est l’art de la répétition, n’oubliez pas:
L’Anthogrammate (Kindle) sera gratuit les vendredi et samedi 29 et 30 août : profitez-en !
Et pour rendre la rentrée encore plus facile, les dix premiers commentaires postés sur Amazon ET sur mon blog recevront un exemplaire Kindle dédicacé de Lovita broie ses couleurs. BONNE RENTRÉE À TOUS !
Et Georgette, l’octogénaire vigneronne, vous ne l’avez pas inventée ? Pas plus que Marguerite, cher lecteur soupçonneux.
Cela se passait une dizaine d’années après la rencontre avec la fausse représentante de produits pour les aveugles.
Un dépassement intempestif en bas de Reignier, une petite plaque de verglas et hop ! Des virages avec ma Panda Val d’Isère, d’un côté le muret de pierre, de l’autre le ravin avec le ruisseau tout en bas. Je dois dire qu’être une acharnée joueuse de Tétris m’a bien aidée : j’essayais d’éviter les obstacles pour acquérir le plus de barres, je veux dire de mètres possibles pour que ne pas entendre la petite musique : maintenant vous êtes mort, try it again ! J’ai fini deux cents mètres plus loin contre le muret dans le sens inverse de mon dépassement et la voiture avait rétréci pendant qu’un nuage de fumée m’obscurcissait le paysage. La portière était coincée, plus de vitres, j’ai essayé de sortir à quatre pattes par l’arrière.
Bref un bel accident spectaculaire, avec le sentiment d’irréalité qui l’accompagne, un lundi matin en allant travailler. Ce qui explique l’hôpital après les pompiers. Et ma rencontre avec Georgette. Je vous épargne le passage aux urgences et le reste, pour me concentrer sur la rencontre avec l’octogénaire vers les dix heures du matin, soit trois heures après mes exploits.
On m’a installée dans la chambre d’une vieille dame d’apparence tranquille, pas bavarde au début. Je me suis dit que ça allait être reposant et déprimant, j’avais peur des vieux, surtout quand ils perdent la tête. Vers les onze heures le défilé a commencé, exactement comme je l’explique dans le roman sauf que je n’étais pas Marguerite et que j’étais à peine quadragénaire. Des visites, encore des visites ! J’essayais de dormir, épuisée par mes émotions du matin.
On craignait une hémorragie interne, j’avais du sang dans le ventre, j’allais rester à l’hôpital, m’a expliqué le médecin. Portrait exact de l’individu dans le roman. Alors Georgette a sorti la bouteille de limonade de dessous son lit. Et quand mon mari est arrivé le soir, je lui ai expliqué en riant, l’œil brillant et les joues un peu rouges, que j’allais rester à l’hôpital et qu’il devrait se débrouiller avec les enfants. Cela nous réjouissait apparemment beaucoup, ma vieille voisine et moi.
L’homme a reniflé la bouteille de limonade vide et promis que le lendemain soir il amènerait une bouteille de Bourgogne pour notre hydratation du soir et les enfants pour les rassurer sur l’état de leur mère.
Georgette était réellement vigneronne à Ayze, elle s’était cassé la jambe en descendant l’escalier raide qui menait à sa cave. Tout ce que j’ai écrit dans le roman à son sujet est exact. Georgette est une des personnes les plus lumineuses que j’ai rencontré dans ma vie. Vous connaissez ces solidarités d’hôpital, quand, dans la souffrance et la solitude qui vous placent hors du temps, vous vous trouvez sur le même radeau que les compagnons de chambre. Naissent alors des torrents d’amitié violente qui disparaissent aussitôt la vie quotidienne reprise comme l’eau retrouve son calme après l’orage. Quand je suis partie de l’hôpital nous avons pleuré, Georgette et moi. Mais il y avait les enfants, le travail, la maison. Je l’ai oubliée.
Lorsque je me suis enfin rendue à Ayze, je ne me souvenais plus de son nom et je n’ai pas retrouvé la maison qu’elle m’avait pourtant décrite très précisément. C’est un regret lancinant de ma vie ; nous traînons tous une cohorte de regrets, d’amitiés avortées, de petites lâchetés qui plombent le paysage. Aujourd’hui Georgette doit reposer quelque part dans le petit cimetière d’Ayze, mais où ? J’ai voulu lui rendre la vie, Marguerite effectue à ma place les visites que je n’ai pas rendu à ma compagne d’hôpital, elle essaie de gommer mes remords de femme égoïste reprise par le quotidien.
Georgette qui ne s’appelait pas Georgette (prénom d’une de mes tantes au verbe haut) recevait des tas de visites, en particulier des jeunes. Portraits repris dans le livre. Son fils était cantonnier, sa fille institutrice. Georgette m’avait expliqué que cette dernière venait de prendre sa retraite et que c’était difficile. Elle avait rencontré son mari dans le petit village de montagne où elle avait eu son premier poste. Sa fille est venue se mélanger à Marguerite, personnage infidèle celui-là, je le reconnais.
J’ai pu me rendre compte du pouvoir des livres : après la biographie de Louis Favre j’ai reçu beaucoup de courrier. Alors, si par hasard la fille de Georgette, ancienne institutrice, lit l’Anthogrammate (je ne compte pas trop sur son fils cantonnier, passionné par la pêche plus que par l’écrit, portrait fidèle là encore) j’aimerais qu’elle me contacte. Que je puisse me rendre au cimetière et reprendre avec sa mère notre conversation interrompue. J’apporterai une bouteille d’Ayze et deux verres.
Pour le reste de vos interrogations, j’attendrai vos questions sur mon blog et j’y répondrai avec le maximum de précisions et de sincérité possibles.
En examinant attentivement mes statistiques sur Facebook, j’ai découvert que pour Lovita broie ses couleurs, mes fans se divisaient en deux groupes : les femmes, 53% dont une majorité de 25/34 ans et de plus de soixante, et les hommes, 44% dont une minorité de 25/34, le reste se répartissant équitablement.
Cela en dit long sur l’irritation des jeunes mâles face à Lovita mais cela me réjouit que les jeunes femmes se reconnaissent. Quid des quadragénaires ? Leurs enfants virent boutonneux, la voix rauque de leur ancien petit garçon, leur fille dont elles évitent tous les jours les bombes incendiaires et autres rockets, l’homme à surveiller pour gérer le fameux tournant existentiel, sans compter le travail et la gestion du quotidien : les malheureuses sont débordées, trop occupées à établir un semblant de paix du foyer dans cette pétaudière. Je comprends fort bien. Heureusement, l’apaisement de l’âge aidant, les turpitudes de la vie se calment et je regagne des lecteurs dans les deux camps. Passé soixante ans, à part les grands-parents surexploités, tout le monde retrouve le temps de lire.
Non, une autre chose me chiffonne dans ces statistiques très élaborées. Un rapide calcul mental montre que nous arrivons à 97% d’hommes et de femmes.
Et les 3% restants ? Des eunuques ? Des hermaphrodites ? Des anges dont chacun sait qu’ils n’ont pas de sexe ? Les prénoms mixtes comme « Dominique » peut-être ? Des travestis et des transsexuels alors ? Vous approchez de la vérité : les statisticiens, en intégrant le troisième sexe dans leurs calculs, reconnaissent tant de civilisations passées ou présentes qu’il faut leur rendre hommage. Bien sûr les Bugis en Indonésie reconnaissent cinq sexes différents, mais pour le confort des lecteurs les statisticiens, dans leur infinie sagesse, n’en ont retenu que trois.
Ils ont pensé aux travestis des Philippines, aux transgenres de Thaïlande qui leurrent tant de touristes, aux quasi-femmes des Maoris ou de Samoa, aux femmes-hommes albanaises et j’en passe. Même les Sioux que l’on imaginait toujours sur le sentier de la guerre avait leurs winkte, quant au Mexique il a ses muxe dans la province d’Oaxaca ; dans les deux cas des hommes occupent rôle et apparence de femmes. Grâce soit rendue aux statisticiens pour cette ouverture d’esprit malgré cette douloureuse découverte : Lovita broie ses couleurs n’intéresse pas tout le genre humain.
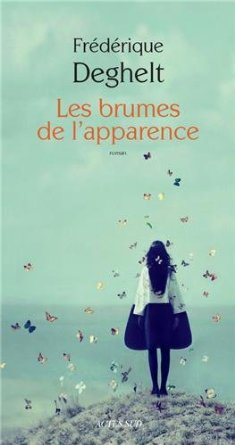 Au tournant de la quarantaine, une femme qui a réussi sa vie dans l’événementiel à Paris, mariée à un chirurgien esthétique, vient d’hériter d’une forêt en France profonde. Elle désire la vendre au plus vite car elle déteste la campagne mais rien ne se passe comme prévu. La forêt est hantée, la jeune femme est un grand médium qui s’ignore, héritière d’une longue lignée de sorciers.
Au tournant de la quarantaine, une femme qui a réussi sa vie dans l’événementiel à Paris, mariée à un chirurgien esthétique, vient d’hériter d’une forêt en France profonde. Elle désire la vendre au plus vite car elle déteste la campagne mais rien ne se passe comme prévu. La forêt est hantée, la jeune femme est un grand médium qui s’ignore, héritière d’une longue lignée de sorciers.
Magie noire, magie blanche, crise de quarantaine, opposition du bien et du mal, du rationnel et de l’irrationnel, tout se mêle et s’affronte dans la vie de Gabrielle. L’auteur a choisi pour son héroïne le prénom de l’ange visité par les visions et apparitions que lui envoie Dieu dans les Livres. Choix subtil car les révélations d’une autre vie ne manquent pas dans ce roman qui se lit agréablement ; le style alerte de Frédérique Deghelt, son art consommé de la narration et sa croyance intime en une vie qui nous échappe et envahit notre quotidien.
J’ai regretté le côté manichéen et sans nuances du roman : l’ombre contre la lumière, le Bien contre le Mal, la ville et la campagne, le superficiel et le profond, le rationnel et l’irrationnel. Comme si dans la vie nous n’étions pas noyés dans un gris où se mêlent intimement tant d’éléments contradictoires !
Le roman hésite entre plusieurs tendances de fond : on se prépare à une lutte grandiose et définitive contre le sorcier maléfique mais on en n’a que les prémices, l’héroïne est victime de son mari qui la fait interner mais sort le lendemain de Sainte Anne, aidée par l’esprit de la sœur du directeur, elle obtient un magnifique contrat d’une manière assez mystérieuse, toujours à gagner sa vie de la même façon alors que celle-ci est totalement chamboulée et la fin rose bonbon avec l’amour qui pointe de nouveau son nez surprend par son inadéquation avec ce qui précède.