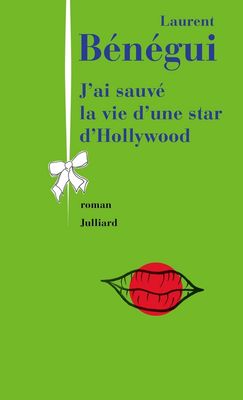L’héroïne de Lovita broie ses couleurs a servi de support érotique à des lecteurs frémissants, et j’ai reçu quelques courriers qui m’ont mise mal à l’aise. Désolée de vous décevoir, messieurs, Lovita n’a rien à voir avec moi, je ne suis que l’auteur. Mais vous avez raison, cette jeune personne n’est pas sortie du chapeau de mon imagination tortueuse, elle existe bel et bien, tout comme Martha d’ailleurs, mais ceci est une autre histoire.
L’héroïne de Lovita broie ses couleurs a servi de support érotique à des lecteurs frémissants, et j’ai reçu quelques courriers qui m’ont mise mal à l’aise. Désolée de vous décevoir, messieurs, Lovita n’a rien à voir avec moi, je ne suis que l’auteur. Mais vous avez raison, cette jeune personne n’est pas sortie du chapeau de mon imagination tortueuse, elle existe bel et bien, tout comme Martha d’ailleurs, mais ceci est une autre histoire.
La véritable Lovita, je l’ai rencontrée à une quinzaine de reprises chez une amie commune. Commune dans le sens amie à toutes les deux, car l’amie en question, s’il vous est donné de la rencontrer, s’imprime dans votre rétine et dans vos oreilles : tant de vitalité, est-ce possible ? Mon amie attire tous les originaux de la terre comme le miel les ours, c’est une mine pour romancier, un filon inépuisable de personnages hauts en couleur que je ne cesse d’exploiter avec sa bienveillante indulgence.
Lovita, donc, m’est apparue dans un éblouissement. Brune Brésilienne, liane flamboyante : une beauté pire qu’un aimant car la belle ne se contentait pas de se laisser admirer, il lui fallait séduire, absolument, et tout le monde. Je me souviens de mon inquiétude lorsque, la première fois qu’elle me vit, elle trouva que j’étais une personne si exceptionnelle, que nous avions tant en commun, qu’elle ne savait pas comment elle allait faire pour me quitter. Moi non plus, et je paniquais un peu. Mon compagnon me prit fermement par la taille et me ramena seule à la maison.
La fois suivante, elle m’avait complètement oubliée, et cela recommença. Je me sentais moins inquiète. Et cela continua, un besoin irrépressible de séduire sans que le support eût la moindre importance.
Elle était (elle est toujours) si belle qu’elle avait été mannequin vedette d’un grand couturier. C’était une artiste, une pianiste aux dons multiples : dessin, écriture. Elle s’habillait tout en blanc, un rituel très précis pour l’opération sacrée. Un jeune homme de bonne famille l’avait violée lorsqu’elle était adolescente et elle s’était retrouvée mère à seize ans. Ses rapports avec son fils était épouvantables, ce que j’écris au sujet de Martin, c’est de la limonade par rapport à la réalité.
Voilà Lovita telle qu’elle existe, et ses rapports très spéciaux avec la nourriture, la volonté de se retrouver pur esprit alors que personne ne peut oublier son corps de rêve, avec son incapacité à connaître une vie normale sans quelqu’un pour s’occuper d’elle. Je l’ai à peine travestie, remplaçant seulement le piano par le pinceau. Notre amie commune appréhendait un peu lorsqu’elle décida de lire Lovita broie ses couleurs… Elle a « adoré » le livre et ne s’est pas reconnue. Par contre je me suis fâchée avec une amie artiste, blonde aux yeux bleus, la générosité-même dans sa vie et dans son physique, qui – elle – s’est reconnue dans l’héroïne. Pas un seul instant je n’avais pensé à elle, allez comprendre !
Tout le monde sait bien que l’écrivain est une sangsue, alors les proches connaissent une obsession : la traque des traces de leur propre vie dans l’objet imprimé qui les mettra pour toujours dans une posture qu’ils détestent d’avance. Mon amie ne m’a toujours pas pardonné cette trahison fictive et fictionnelle.