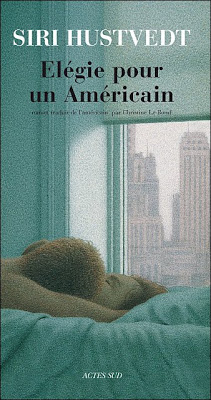 Eric et Inga Davidsen viennent de perdre leur père, et en rangeant ses papiers ils découvrent une lettre dérangeante signée d’une femme dont ils n’ont jamais entendu parler et parlant d’une mort qu’il fallait garder secrète. Eric et Inga vont donc essayer de résoudre ce mystère.
Eric et Inga Davidsen viennent de perdre leur père, et en rangeant ses papiers ils découvrent une lettre dérangeante signée d’une femme dont ils n’ont jamais entendu parler et parlant d’une mort qu’il fallait garder secrète. Eric et Inga vont donc essayer de résoudre ce mystère.
Voilà la (très mince) trame de départ de ce roman de la mémoire et du deuil de Siri Hustvedt, The Sorrows of an American – les soucis et ou les peines d’un Américain – étrangement traduit par Élégie pour un Américain en français. Autant le titre originel nous orientait sur la complexité de ce que signifie être américain, avec l’importance de l’immigration, la façon de se fondre dans le creuset, de conserver ses racines tout en se sentant parfaitement américain (et cela évoque des résonances profondes en ce moment), autant le titre français affadit le propos. Élégie vient du grec élégos qui veut dire plainte et suggère une sorte de poésie douce et triste, enfermant ce livre fort dans une forme qui n’est pas la sienne et affadit son propos.
Le narrateur est Eric, psychiatre divorcé qui, au début du roman, vient de louer une partie de sa maison à une jeune femme d’origine jamaïcaine Miranda et à sa fille de cinq ans, Eglantine. Eric se sent immédiatement attiré par Miranda qui est harcelée par le père d’Eglantine : celui-ci prend sans cesse des photos, très intrusives, ce qui permet quelques développements angoissants fort bien construits ainsi que d’autres plus philosophiques sur la puissance de l’image dans la construction de notre vécu. Car au fond, c’est le vrai propos : comment se construire vraiment ? Comment se tenir debout quand on est confronté au deuil et à la mémoire, au secret de famille, aussi.
Ce roman est construit en strates qui s’imbriquent les unes dans les autres, qui se répondent et se complètent comme une gigantesque métaphore du travail qu’un individu doit accomplir pour se construire une image cohérente de lui-même : légendes familiales, non-dits destructeurs, traumatismes personnels ou nationaux comme celui du 11 septembre, deuils, présence des morts dans la vie des vivants, ambiguïtés sexuelles, comment s’y retrouver ?
La complexité de la vie se retrouve dans la façon très naturelle dont Siri Hustvedt mêle les histoires des différents personnages en incluant également dans son travail le journal de son propre père disparu.
Les passages du livre extraits des Mémoires de Lars Davidsen proviennent directement de ceux de mon père, avec quelques rares modifications éditoriales, notamment des noms propres.
Où se situe la fiction ? Où se trouve la réalité ? Dans ce livre les personnages s’expriment parfois dans des discussions si pointues que cela tient de l’exposé sur les neurosciences et la philosophie mais cela passe, tellement le moment est intégré à l’ensemble du texte. Les difficultés des patients d’Eric à concevoir la réalité de leur personnalité font écho à la fragilité de celui à qui ils confient leur mal-être. Au fond, qu’est-ce que la mémoire, et permet-elle de construire les fondements d’une existence ?
La mémoire ne prodigue ses cadeaux que si quelque chose, dans le présent, la stimule. Ce n’est pas un entrepôt d’images et de mots fixes, mais un réseau associatif dynamique dans le cerveau, jamais inactif et sujet à révision chaque fois que nous récupérons une image ou un mot du passé. Je savais que, du simple fait de son arrivée dans ma vie, Eglantine avait commencé à me ramener vers ces chambres de mon enfance qu’en dépit de mon analyse j’avais gardées fermées – ou plutôt entrouvertes juste assez pour apercevoir un trait de lumière ou respirer de temps à autre une odeur de moisi.
Tous les personnages du livre de Siri Hustvedt – j’ai de la peine à parler de roman – se débattent dans le même vivier, quel que soit leur âge. Ils sont tous hantés par la perte : Eric par la perte de son père mais aussi par celle de sa femme depuis leur divorce ; sa sœur Inga par celle de son père et plus encore par celle de son mari, écrivain célèbre autour duquel tourne des lettres écrites à une maîtresse dont le contenu intéresse beaucoup de monde ; sa nièce Sonia en deuil de son père et de tout ce qu’elle a vu le 11 septembre ; Miranda qui s’est construite autour de l’assassinat de son oncle homosexuel ; Lane le père d’Eglantine dont les parents sont morts dans un accident de voiture : ils sont à la recherche de la pièce manquante du puzzle de leur existence, celle qui en éclaircira le sens.
On cherche à donner un sens à sa vie mais tout est biaisé et l’auteur multiplie les notations fines sur la façon dont on se trompe sur les réactions des autres, déclenchant ainsi des réactions en chaîne terribles :
Derrière le regard de Lorelei, dans lequel j’avais lu de l’insécurité et Inga du mépris, se cachait un fouillis de rapports de classes, d’égalitarisme pionnier et de nature humaine pure et simple. En observant ma sœur, assise à table en face de moi, je remarquai qu’elle portait un chemisier blanc sans manches et un étroit pantalon bleu foncé, qui, malgré leur inoffensive simplicité, avaient cet éclat de qualité des vêtements coûteux qui m’avait toujours intrigué mais qui est néanmoins immédiatement perceptible. (…)
La moindre différence perçue, si minime soit-elle, peut devenir un argument de division – fortune, éducation, couleur de peau, religion, parti politique, style de coiffure, n’importe quoi. Les ennemis sont vivifiants. Malfaiteurs, fanatiques religieux, barbares. La haine est excitante et contagieuse, et elle élimine commodément l’ambiguïté. On n’a plus qu’à se défausser de ses saletés sur les autres.
Confondant, vous ne trouvez pas ?
Dans un final polyphonique absolument somptueux, Eric recolle les bribes de souvenirs en un patchwork d’une infinie délicatesse. Et si les soucis de cet Américain, cette élégie parfois douce, souvent angoissante construite avec entêtement et tendresse pour ses personnages nous mettait face à notre propre fragilité, à la reconstruction permanente de notre mémoire ?
