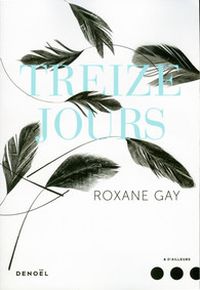 Le chiffre 13 porte malheur dans ce roman : c’est le nombre de jours que Mireille Duval Jameson va rester prisonnière de ses geôliers et subir leurs sévices sexuels en attendant que son père, riche homme d’affaire d’Haïti, paie la rançon.
Le chiffre 13 porte malheur dans ce roman : c’est le nombre de jours que Mireille Duval Jameson va rester prisonnière de ses geôliers et subir leurs sévices sexuels en attendant que son père, riche homme d’affaire d’Haïti, paie la rançon.
Celui-ci traîne par principe moral : il est sûr qu’après sa plus jeune fille, ce sera au tour des autres femmes de la famille d’être enlevées. Il a surtout l’air de ne pas vouloir sortir un million de dollars de sa poche.
Mireille est mariée à un Américain, Michael, prototype du mari idéal : il est beau, supporte tous les caprices de son épouse (parfois on a envie de lui donner une fessée à cette enfant gâtée) et il est le père de son petit Christophe que Mireille allaite toujours lorsqu’elle est enlevée à la sortie de la somptueuse propriété de ses parents. La petite famille est en vacances à Haïti lorsqu’elle est victime de l’industrie la plus florissante de l’île, le kidnapping.
Tout se mélange dans ce roman : la description de la misère crasse du peuple haïtien et de l’opulence indécente de la classe dirigeante, la corruption, la violence, le sadisme, le tout entrelardé des souvenirs de Mireille de sa vie d’avant.
Treize jours de souffrance, de survie, de révolte, avec au bout du compte le père qui paie tout de même et la libération. Et la suite ? Quand on a tenu en supprimant tout ce qu’on était, quand on a subi des horreurs et que le corps et l’âme sont esquintés ? Comment pardonner ? Comment reprendre une vie sexuelle et affective ?
Très beau sujet.
J’ai lu le livre (presque cinq cents pages) jusqu’au bout, mais vraiment pas d’une traite, partagée entre la perplexité et l’irritation, pas plus bouleversée que ça par les malheurs de Mireille. Pourquoi ? Sans doute parce que l’auteur, animatrice d’ateliers d’écritures, nous fait – et à ses étudiants – une démonstration à l’américaine de la façon de varier le récit. Sur environ trois cents pages au moins nous assistons aux sévices que subit la malheureuse jeune femme qui refuse de plier devant le sadique « commandant ». Viols à répétitions, mutilations diverses, de quoi allécher un certain public, et cela m’a mise profondément mal à l’aise. Trop de violence fait basculer dans l’indifférence, surtout quand ça sent la démonstration.
Un douloureux sujet comme celui-ci aurait mérité un traitement différent : la misère et la violence de ce pays parmi les plus pauvres du monde, la façon dont les victimes essaient de se reconstruire après avoir été brisées auraient mérité mieux que du brio : de l’empathie et de l’immersion, des faits bruts non délayés. Or, dans Treize jours la complaisance dans la violence alterne avec la vie d’avant, sirupeuse à souhait. C’est bien connu, l’Enfer ne prend de sens que par rapport au Paradis.
Un exemple de la prose-Paradis :
— Tu as dit que tu rentrais.
— Non, c’est toi qui l’as dit. Tu n’es pas mon patron.
Les yeux grands ouverts, j’ai levé la tête vers lui :
— Ah bon ?
— Non, pas aujourd’hui.
Je me suis mordillé la lèvre. Michael est très sexy quand il est impertinent. Il dit la même chose de moi.
— Ne reste pas dans ce couloir. C’est bizarre. Rentre dans la chambre. Je m’ennuie.
Il a secoué la tête et croisé les bras.
— Pas avant que tu aies fait quelque chose pour moi. Lève la main droite.
— Pardon ?
— Tu es avocat. Ce n’est pas de la gymnastique. Lève la main et répète après moi : « Moi, Mireille Duval Jameson, m’excuse d’être méchante avec mon mari aimant et dévoué.
Dialogue d’une profondeur insondable, n’est-ce pas. Cela alterne avec cela :
Ses mains trituraient mon pantalon, il l’a descendu sur mes cuisses.
— J’ai tous les droits ! Tu penses que tu es trop bien pour moi, c’est ça que tu penses ?
Suit une description de sévices sexuels, très très nombreux dans le roman. La belle et insolente Mireille sombre dans l’horreur. Au début cela remue :
Il m’a déshabillée, il m’a mise à nu, et ensuite m’a encore dépouillée de quelque chose que je ne peux pas nommer, il m’a plaquée sur le ventre, m’a soulevée par les hanches, m’a obligée à écarter les cuisses avec les siennes et est entré en moi de force. Il m’a fendue en deux. Tout se déchirait. Je n’étais en mesure de penser qu’à une seule chose, mon corps, et je comprenais pour la première fois de ma vie la faiblesse même de l’être humain, l’extrême fragilité de la chair.
Les viols se succèdent, les sept ravisseurs la traitent comme un objet, une revanche sociale ; le chef, lui, utilise des raffinements de cruauté.
Comment survivre ? Le sujet était grave, la façon dont il est traité est bavarde. Après les frémissements d’horreur de départ, je me suis vite ennuyée devant la description répétitive des sévices alternant avec la vie d’autrefois de cette enfant gâtée qui tient tête à ses ravisseurs, ce qui les excite encore plus. Bêtise ?
Il y a tout de même des éléments intéressants. L’auteure est bien renseignée. Elle sait qu’une victime ne reprend jamais sa vie d’avant, que le chemin vers un semblant de rédemption est pavé d’ornières. Las, là encore, pourquoi étaler, enfoncer le clou ? Le mari parfait, la belle-mère compréhensive, tout est délayé, perd de sa force. La famille américaine est parfaite, contrairement à la famille haïtienne. Hum… Quant à cette pauvre Mireille, le fait qu’elle n’avait connu sexuellement que son mari avant de faire l’expérience quotidienne du viol, est sans doute destiné à nous faire frémir encore plus. Elle est de surcroît jeune mère allaitante : cela vire au tire-larmes. Trop, c’est trop.
C’est une chose d’animer un atelier d’écriture, c’en est une autre d’être écrivain, même si certains professionnels chargés de nous faire acheter des livres ne sont apparemment pas de mon avis :
« Cette icône de la contre-culture signe un premier roman époustouflant » Lire – 28/09/17 – Gladys Marivat
« Lisez ce livre qui est de la trempe de ceux qui peuvent (un peu) changer le monde ;
lisez ce livre dont vous ressortirez (un peu) changé, peut-être meilleur. » Libération – 26/9/17 – Antonin Iommi Amunategui
« C’est le roman le plus secouant de la rentrée » Libération supplément – 22-23/7/17 – CI.D.
Avons-nous lu le même livre ? Comment peut-on sortir meilleur d’un pavé pareil, bavard et lourdingue ?
À réserver pour les amateurs de sadisme et pour les midinettes, on peut être les deux.
Roxane Gay
traduit de l’anglais (États-Unis) par Santiago Artozqui
Denoël, 480 p., 22,90 €
ISBN : 978-2-207-13594-5

Étonnant la couverture de ce livre au contenu assurément d’une violence extrême au vue de votre présentation Nicole.
Sept feuilles en forme de plume cela représente plutôt la nature, la sérénité, bizarrement les agresseurs étaient sept…
Ce pays d’Haiti, c’est au travers de ces catastrophes humanitaires que j’en ai eu connaissance, et par l’adoption d’une petite fille de ce pays par une femme qui avait redonné goût et soutien à notre fille pour l’école
Il m’arrive d’être attiré vers un livre par l’image sur la couverture, pour le coup cela là m’aurait égaré
Votre remarque est stupéfiante, Eric: sept plumes pour sept violeurs, et je ne l’avais pas vu!
Couverture mensongère d’une façon troublante… Il fallait votre regard exercé pour percevoir de telles contradictions.
Un livre a priori sans intérêt… sauf pour des ados en mal d’idées sexuelles… encore que… ils vont plutôt les chercher de visu dans les zones pornos d’Internet…
Mais quand même il y a un truc qui m’a fait bien marrer !:
«« C’est le roman le plus secouant de la rentrée » Selon libération
comme quoi, il y a encore des critiques qui aiment se masturber en lisant un bouquin…
;-))
Mouarf !…. Ok je sors ————————–>
Ah! Ah! Je n’avais pas remarqué que cela pouvait prêter à des remarques potaches! Tu as raison de te moquer, cela ne vaut pas plus.