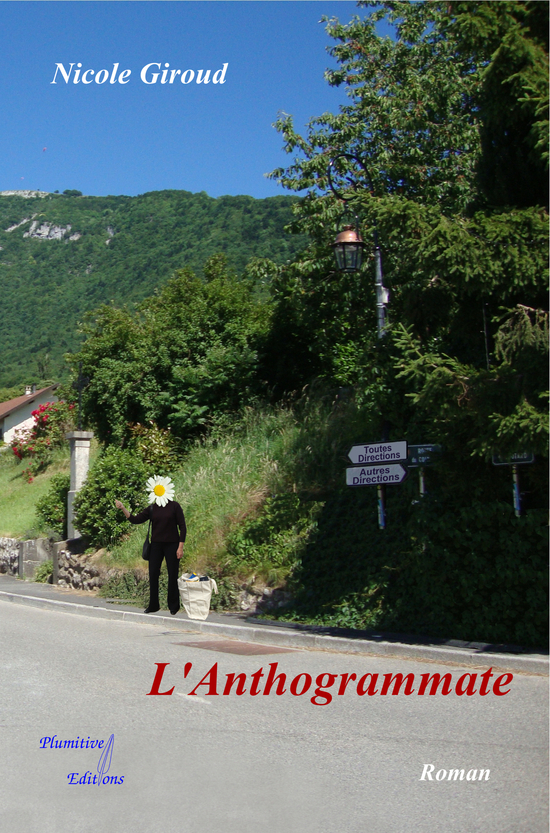La nouvelle coupe la nuit en deux.
La nouvelle coupe la nuit en deux.
L’appel téléphonique fatal
que tout homme d’âge mur
reçoit un jour.
Mon père vient de mourir.
J’ai pris la route tôt ce matin.
Sans destination.
Comme ma vie à partir de maintenant.
Ainsi commence cette énigme du retour au pays natal, ce voyage circulaire autour du père, des origines, de la douleur d’être d’un pays en n’étant plus de celui-ci.
Lent poème magnifique, ode à la vie, à la solitude, au temps qui s’imprime comme les cercles des arbres dans le tronc.
Le narrateur revient au pays qu’il a quitté depuis plus de trente ans. Il n’a pratiquement pas connu son père, dandy révolutionnaire parti en exil alors qu’il était tout petit et qui n’a jamais repris contact avec lui, même lorsqu’il est parti à son tour en Amérique du Nord.
Ce père mirage et douleur hante ce retour, son portrait se dégage des souvenirs de la mère du narrateur, des amis restés au pays, de tout un réseau de correspondances qui se mêlent d’une façon étrange et peut-être rêvée. Vaudou, misère, beauté, violence, tout s’amalgame dans ce portrait d’Haïti :
Pour chaque bras qui pointe un
revolver sur vous
il y a une main qui vous offre un fruit.
Toute parole méprisante de l’un
est effacée par le sourire de l’autre.
On reste incapable de bouger
entre ces deux pôles.
Portrait rêvé ? Le narrateur dort beaucoup et lorsqu’il voyage cela tient parfois du rêve éveillé comme si la réalité se manifestait à travers un voile, une distance où même le narrateur ne possède pas d’existence propre : son neveu qui ambitionne d’être écrivain et de partir possède le même prénom que lui. Lors d’une fête étrange dans un village, le narrateur croit que c’est lui que l’on honore, mais non, c’est son neveu. Lui n’est que la manifestation de la présence d’un dieu vaudou. Le vaudou, présence obsédante et protectrice : un des meilleurs amis de son père lui offre une poule noire qui va le protéger des âmes néfastes.
Legba. Il me confond avec le dieu qui se tient à la frontière du monde visible et du monde invisible. Celui qui peut vous permettre de passer dans l’autre monde. Je n’étais pas dans le pays. On le sait. Je suis venu enterrer mon père, et c’est moi qu’on accueille comme un dieu dans sa ville natale. On vous attendait, fait-il gravement. Je ne suis pas Legba. Vous êtes le fils de Windsor K., mon camarade de classe. On a fait nos classes primaires ici ensemble. Me voilà bouche bée. Si on ne savait pas qui vous étiez, vous ne seriez plus vivant à cette heure. ( …) Et puis vous êtes accompagné de Legba. Et Legba qui a choisi de passer la nuit sur notre tombe. Nous ne méritons pas un tel honneur. Je me demande à quel signe avez-vous reconnu Legba. La poule noire. La poule ? Oui, la poule noire. Bien sûr, la poule noire. Il faut parfois faire semblant de comprendre. C’est une manière rapide d’apprendre, car personne ne vous expliquera ici ce que vous êtes censé savoir.
Cette énigme du retour, c’est un peu celle de notre vie. Que connaissons-nous vraiment de notre vie à part l’écume des souvenirs et des faits ? Haïti le lieu rêvé, violent et inquiétant est celui de la dérive intime qui nous a fait oublier ce que nous sommes :
On circule dans les rues illuminées
des grandes métropoles du monde
avec nos airs urbains et nos politesses apprises
ignorant que nos vies sont gorgées
de sentiments secrets et de chants sacrés
oubliés quelque part en nous
et qui ne surgiront qu’à nos funérailles.
Laissez-vous porter, envoûter, par cette Odyssée chantée-murmurée qui rejoint des paysages enchanteurs et dévastés. Celui qui la chante se trouve à la frontière des mondes, mais n’est-ce pas une définition possible de l’écrivain ?