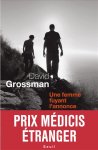
Connaissez-vous le récit du conteur perse du XIIème siècle, Farid Al-Dîn Attar ?
À Bagdad le fils du calife rencontre la mort sur le marché qui tend un bras vers lui. Terrifié, il demande à son père la permission de s’enfuir à Samarkand pour échapper à la mort. Le père se rend sur le marché, reconnaît la mort et lui demande pourquoi elle a tendu un bras vers lui :
– C’était un geste de surprise… Je l’ai vu ici alors que je dois le prendre ce soir à Samarkand.
Aucun de nos petits arrangements n’empêchera le destin de s’accomplir.
Ils se rencontrent dans un hôpital déserté en 1967, durant la guerre des Six Jours. Ils ont seize ans : Ilan et Avram, les deux garçons, et Ora la fille.
Naissance d’un triangle amoureux classique, me direz-vous. Pas tout à fait : nous sommes en Israël, et le poids de la guerre va laminer les destins, détruire la force de vie d’Avram, le plus doué des trois, écraser sous la culpabilité les survivants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et ce qui les fait agir.
Le prologue, avec son abondance de dialogues sans tirets introducteurs, – contrairement au reste du roman –, déroute le lecteur ; nous sommes au cœur de l’échange de ces adolescents pris dans une guerre qu’ils devinent à peine, dans cet hôpital déserté des autres malades :
« As-tu remarqué que tout le monde nous en veut ? Comme si nous avions fait exprès de…
Parce que nous sommes les dernières victimes de l’épidémie. Ceux qui allaient un tout petit peu mieux sont rentrés chez eux. En priorité les soldats. Aussitôt après, on les a renvoyés juste à temps pour la guerre.
Il y aura réellement la guerre ?
Tu retardes ! Voilà au moins deux jours qu’elle a éclaté ! »
« Quelques jours auparavant elle s’était évanouie dans la rue en rentrant de l’entraînement au stade du Technion. Aurait-elle séjourné dans l’un des camps militaires que l’on venait d’installer en prévision de la guerre ? Y avait-elle mangé quelque chose, ou utilisé les toilettes ? lui avait demandé le médecin de l’hôpital de Rambam. On l’avait immédiatement transférée dans une ville inconnue, loin de chez elle, et enfermée dans une chambre au troisième étage d’un petit hôpital délabré avec interdiction absolue d’en sortir. Ses parents et amis n’étaient pas autorisés à lui rendre visite, ou, au contraire, étaient-ils venus la voir pendant qu’elle dormait ? »
Malaise… Ces trois adolescents eu quarantaine suggèrent-ils la dimension nucléaire du conflit ? Beaucoup de choses ont été écrites après la guerre des Six Jours, rien d’officiel cependant. Nous n’en saurons pas plus.
L’histoire reprend, en 2000 : Ora est séparée d’Ilan, son fils ainé Adam est parti avec son père en Amérique du Sud, et le deuxième fils, Ofer, s’est porté volontaire pour la guerre alors qu’il vient à peine de terminer son service militaire.
« Ora doit s’endormir malgré tout, car, au petit matin, elle est réveillée par trois militaires en uniforme, plantés sur le seuil de sa maison. Deux d’entre eux s’effacent devant leur supérieur, qui frappe à la porte. Le médecin cherche un tranquillisant dans sa sacoche et la femme officier se prépare à rattraper Ora, au cas où elle tournerait de l’œil.
Ora les voit redresser la tête, ils s’éclaircissent la gorge, puis l’officier supérieur lève une main hésitante. Les yeux hypnotisés, sur son poing crispé, elle se dit que le temps va s’arrêter, mais l’homme se décide à frapper trois coups énergiques, le nez pointé vers le bout de ses chaussures, et, en attendant que la porte s’ouvre, il repasse son message : à telle heure, au lieu X, votre fils Ofer, qui exécutait une mission opérationnelle…
Pour fuir cette annonce, Ora s’enfuit de la maison ; elle est persuadée que si elle ne se trouve pas derrière la porte lorsque les messagers frapperont, si elle pense sans cesse à son fils de vingt-et-un ans, elle le maintiendra en vie, elle le protégera.
Pensée magique douloureuse, obsessionnelle.
« Tout son corps palpite, exhalant le nom de son fils, tel un soufflet – mais rien à voir avec l’absence, la nostalgie. Il la déchire de l’intérieur, se démenant comme un enragé, martelant de ses poings les membranes de son corps. Il la veut pour lui seul, inconditionnellement, exige qu’elle s’oublie elle-même pour se consacrer à lui ad vitam aeternam, qu’elle ne cesse de penser à lui, parle de lui sans arrêt à tous ceux qu’elle rencontre, même aux arbres, aux pierres, aux chardons, qu’elle prononce son nom à voix haute ou en silence, encore et encore, qu’elle se souvienne de lui à chaque instant, à chaque seconde, qu’elle ne l’abandonne pas, parce que aujourd’hui il réclame sa présence pour exister – et elle comprend alors que c’est la raison de sa férocité. Pourquoi n’a-t-elle pas saisi plus tôt qu’il a besoin d’elle afin de ne pas mourir ? »
Ora se sauve, effectue avec Avram le père biologique d’Ofer, le périple soigneusement préparé par le fils, la traversée de la Galilée.
Trame simple et dure qui ne rend pas justice à la densité de ce livre.
Ofer est le deuxième fils d’Ora, comme Uri était le deuxième fils de David Grossman, le héros de papier et l’enfant chéri ont le même âge, et si Ora espère protéger son enfant par une parole obsessionnelle, l’auteur du livre a essayé de protéger son enfant avec les mots qu’il alignait sur les pages.
Mais Uri est mort aux toutes dernières heures de la deuxième guerre du Liban, le 12 août 2006.
Et ce livre terrible, dont tant d’éléments de la vie réelle de l’auteur accentuent le déchirement, est bien plus que la relation d’un drame personnel dont les éléments se répètent en écho.
Ora et Avram marchent, et la parole d’Ora (prénom prédestiné ?) reconstruit pour Avram la vie de sa famille. Nous découvrons la complexité de la famille d’Ora, le poids de l’histoire du pays dans la construction des individus, les interactions entre attentats, représailles, humiliations, peurs, le quotidien des gens qui vivent en Israël, Juifs et Arabes confondus.
« Elle se souvint que, au début de la première vague d’attentats-suicides – Adam était à l’armée –, Ilan, accompagné d’Ofer, s’était mis en quête d’un parcours parfaitement sûr afin d’effectuer à pied le trajet de l’école, située en ville, à l’arrêt où le garçon prenait le bus pour rentrer à la maison. Le premier itinéraire était trop proche du lieu où un terroriste s’était fait sauter, dans le bus 18, avec vingt passagers. Quand Ilan suggéra à Ofer de passer par la rue piétonne Ben Yehouda, son fils lui rappela la triple explosion qui avait eu lieu ici-même, tuant cinq personnes et en blessant cent soixante-dix autres. Il tenta de tracer un circuit un peu plus long, contournant Mahane Yehouda par-derrière pour déboucher près du marché, mais Ofer lui fit remarquer que c’était exactement à cet endroit qu’un double attentat-suicide s’était produit : quinze morts et dix-sept blessés. De toutes façons, ajouta-t-il, tous les bus reliant le centre-ville à Ein Karem passaient par la gare routière, où il y avait eu un autre attentat – dans le bus 18, encore une fois –, vingt-cinq morts et quarante-trois blessés. »
Petit à petit, nous sommes imprégnés par cette atmosphère qui n’existe qu’en Israël. L’amitié impossible entre Arabes et Juifs, symbolisée par Sami, le chauffeur de la famille. Les humiliations de l’un, les maladresses de l’autre. Le fossé ne peut pas se combler.
Ora et Avram marchent en Galilée, paysage idyllique et rencontres variées. La marche, avec son épuisement, sa vertu thérapeutique pour Avram détruit par les tortures lorsqu’il était prisonnier des Egyptiens, la marche et la parole d’Ora qui raconte la vie de sa famille à Avram et comprend enfin certains éléments, la marche et le refus d’avoir des nouvelles du conflit.
Puissance magique, toujours, mais qui se fissure au fil de l’avancée du voyage et du retour au point de départ : la guerre et ses morts harcèlent pourtant la mère qui refuse le malheur : partout sur leur trajet des mausolées, des pierres rappelant les jeunes morts dans les combats.
Le roman s’arrête à ce moment, juste avant le retour.
Avec une brève postface de David Grossman racontant l’écriture de ce livre.
«À l’époque, j’avais le sentiment – je formais le souhait, plutôt – que les pages que je rédigeais le protégeraient ».
Mais nul n’échappe à son destin. Le fils du calife, celui d’Ora, celui de l’auteur, rien ne protège ceux que l’on aime.
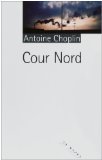 Variations de jazz sur fond de conflit social dans une petite ville du Nord, Cour Nord va vous saisir, vous envelopper dans ses variations syncopées, sèches, à la limite de l’épure. Malgré l’argument de départ – les relations entre un vieil ouvrier syndicaliste et son fils qui ne rêve que de musique –, Cour Nord n’est pas un ènième roman social sur les ravages de la désindustrialisation et de la déstructuration du monde ouvrier.
Variations de jazz sur fond de conflit social dans une petite ville du Nord, Cour Nord va vous saisir, vous envelopper dans ses variations syncopées, sèches, à la limite de l’épure. Malgré l’argument de départ – les relations entre un vieil ouvrier syndicaliste et son fils qui ne rêve que de musique –, Cour Nord n’est pas un ènième roman social sur les ravages de la désindustrialisation et de la déstructuration du monde ouvrier.
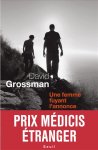
 Le Général Solitude d’Eric Faye n’a d’intérêt ni pour l’originalité de son sujet ni pour la façon dont il est traité et les références littéraires qui viennent à l’esprit en le lisant abondent.
Le Général Solitude d’Eric Faye n’a d’intérêt ni pour l’originalité de son sujet ni pour la façon dont il est traité et les références littéraires qui viennent à l’esprit en le lisant abondent.