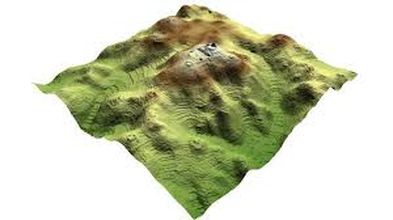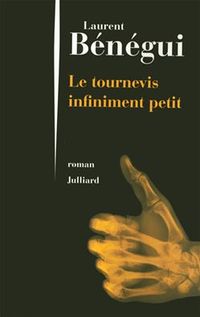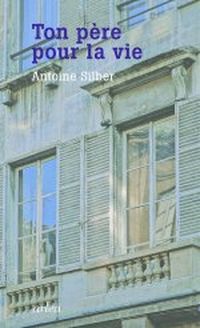 Commençons par la fin du livre, après l’enterrement de Jacques Silberfeld le père d’Antoine Silber.
Commençons par la fin du livre, après l’enterrement de Jacques Silberfeld le père d’Antoine Silber.
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à écrire ce livre. Oui, j’allais le raconter dans sa générosité et son exubérance, sa complexité et sa truculence. En parlant de sa vie quotidienne, de ce qu’il était, de la manière dont il vivait.
Ce livre imposé par le deuil comme une nécessité, ce livre d’une écriture d’eau claire, est tout autre chose que le simple exercice de style d’un fils aimant, c’est de la littérature. Mais laquelle, par-delà l’hommage au père disparu ? Autofiction ? Biographie ? Témoignage ? Un peu tout cela à la fois. Les textes concernant la vieillesse et l’approche de la mort abondent dans la littérature, mais beaucoup moins ceux des enfants qui ont accompagné leurs parents le dernier bout du chemin.
« Ton père pour la vie », c’est ainsi que le père d’Antoine Silber terminait ses lettres à son fils, plus exactement il écrivait TPPLV, Jacques. Et il écrivait beaucoup, deux ou trois lettres par jour, et quelles lettres ! Bourrées d’humour, de notations érudites et de tendresse, ces lettres d’écrivain et de père aimant rythment le livre, lui donnent sa tonalité si particulière, son côté extrêmement vivant.
L’auteur remercie Annie Ernaux pour ses encouragements, pourtant il ne se situe pas dans l’axe universel qui sous-tend tout le travail de la grande romancière. Impossible. Son père n’était pas un archétype et ni la fin de sa vie ni sa personnalité ne sont transposables. Qui peut reconnaître son père dans le traducteur de Nabokov Jacques Silberfeld alias Michel Chrestien familier de tant d’écrivains célèbres comme Alexandre Vialatte, Jean Dutourd, Antoine Blondin, et de journalistes comme Bernard Pivot ? Jacques Silberfeld, le critique littéraire, le membre du comité de lecture de Gallimard et j’en passe ?
Cette célébrité trop forte masque la fragilité de la vieillesse et empêche son fils d’aboutir à l’universel. Un piège doré en somme.
Le vieil homme ne quittait pratiquement plus son lit d’où il accueillait beaucoup de visiteurs, ce fin lettré redonnant ironiquement vie à la « ruelle » où recevaient au XVIIe siècle mesdames de Sablé, de La Fayette, du Plessis-Guénégaud et consœurs. Comme ses illustres devancières, Michel Chrestien recevait ses visites allongé sur son lit. Michel Chrestien ?
André Féron, Pierre-Jacques Cazaux, André Gilbert… Il avait si souvent changé de nom pendant la guerre. Il y était habitué. Il s’en amusait. Mais ce pseudo, ce nom-là n’était pas anodin. En l’adoptant, il avait moins cherché à abdiquer son identité, à se dissimuler qu’à affirmer cette identité à sa manière, désinvolte et paradoxale. Il y avait dans ce choix une grande provocation et une assez extraordinaire ironie. Il était juif, ne se cachait jamais de l’être. Il le soulignait au contraire. En humoriste. Et c’était comme s’il voulait montrer à ceux qui ne professaient que haine et intolérance, qu’il ne les craignait pas.
Admiration du fils devant le résistant et l’homme de lettres, dans tous les sens du terme. Une culture encyclopédique et un amour de la chose écrite qui transparaît dans les missives qu’il écrit à son fils, à peine celui-ci l’a-t-il quitté. Antoine a conservé toutes les lettres de son père, et il y en a beaucoup. Quelles lettres ! Jubilatoires pour tout amoureux de la littérature : primesautières, érudites, à sauts et à gambades entre humour et tendresse…
Nous nous trouvons très loin de l’hagiographie ou du pieux souvenir, c’est une richesse d’avoir contourné les bons sentiments avec des notations qui surprennent et déstabilisent le lecteur :
Il avait tout lu !
Je le regardais se passer le rasoir au coin des lèvres, sous le menton. J’avais douze ans, quand, déjà, je le regardais dans la salle de bains de Neauphle. Il voulait toujours qu’on lui tienne compagnie pendant qu’il se lavait ou qu’il se rasait. Il était toujours tout nu, je ne pouvais détacher mon regard du bas de son corps, fasciné par le diamètre de son sexe circoncis, hypnotisé par ce gland plus gros qu’un gros marron d’Inde, ce si gros gland gris, vaguement violacé par endroits.
On ne se trouve pas très loin du père de Kafka, vous ne trouvez pas ? Cela peut virer au combat de coqs lorsqu’une jeune femme est dans les parages, au règlement de comptes ou aux notations finement cruelles :
Il avait retrouvé sa superbe et de mon côté je ne me sentais pas assez fort, je n’avais pas l’impression de réussir suffisamment ce que j’entreprenais pour pouvoir parler d’égal à égal avec lui. Ce n’était pas tant qu’il parlait beaucoup mais il prenait toute la place et m’empêchait de m’exprimer. Ce n’était pas qu’il ne me donnait pas la parole, mais que je n’arrivais pas à la lui prendre.
J’avais tant aimé nos tête-à-tête peu après la mort de ma mère. J’aurais préféré que nous continuions d’être tristes ensemble.
Époustouflant et universel, ce père qui prend toute la place, enfin l’universel pointe le bout de son nuage dans le ciel humain :
Mon père était mort, et je rêvais que j’étais mon père.
Durant toute la vie, vos parents vous obsèdent, vous emprisonnent, vous vampirisent, même. Et c’est pire encore après qu’ils ont disparu : leur amour vous envahit définitivement ; vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Il vous habite pour l’éternité.
Les encouragements d’Annie Ernaux ? Antoine Silber n’en a pas besoin, il creuse son propre sillon après Le silence de ma mère et Les cyprès de Patmos.