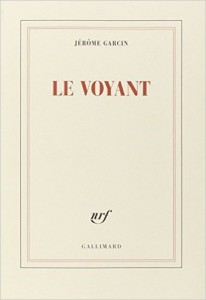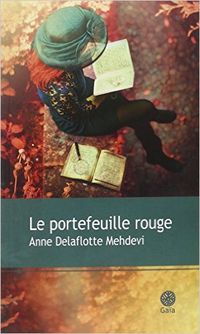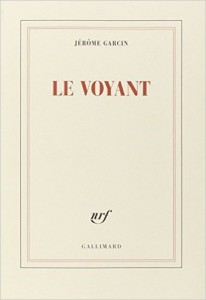
Par un hasard troublant, ce livre est un des derniers que j’ai lu et chroniqué avant de connaître de graves problèmes de vue. Depuis le 1er août je pense intensément à Jacques Lusseyran, à sa vision optimiste de la cécité. J’en ai conclu que l’extraordinaire pouvoir d’adaptation de l’enfance conduit à des richesses là où l’âge mûr ne voit que détresse, la danse sur le fil de l’adversité nécessite des jambes agiles. Voici la critique.
Dans ce livre vibrant qui tient de l’incantation, du galop d’un cheval fou, du fouet et de la caresse, Jérôme Garcin nous restitue l’essentiel de la vie de Jacques Lusseyran, scandaleusement oublié après la seconde guerre mondiale.
Biographie ? Pas vraiment. Roman ? Non plus. Un objet inclassable, pétri d’admiration et d’empathie, d’une tendresse qui ne va pas sans sévérité devant cet homme magnifique, excessif et égoïste.
Jacques Lusseyran, né en 1924 dans une famille bourgeoise et intellectuelle, est victime d’un accident en classe qui lui arrache un œil et rend l’autre inopérant. Désormais aveugle à huit ans, il est admirablement pris en charge par ses parents et peut réintégrer l’école dont il est un brillant sujet. Jacques se montre d’une intelligence supérieure et considère son handicap comme un atout :
« La cécité a changé mon regard, elle ne l’a pas éteint ». Et il ajoutait : « Elle est mon plus grand bonheur ».
Être aveugle ne l’empêche pas de faire de brillantes études et de s’investir dans la Résistance à dix-sept ans. Il est arrêté par la Gestapo en 1943, conduit à Fresnes puis déporté à Buchenwald. L’horreur du camp mais aussi la lumière qu’y apporte Jacques récitant de la poésie et racontant les grands auteurs français.
Le retour au bout d’un an et demi de captivité est difficile. Jacques fait partie des trente qui ont survécu sur deux mille, culpabilité, dépression, impossibilité de trouver sa place dans cette France de l’après-guerre qui ne reconnaît pas ses mérites dans la Résistance. Dépression larvée qui ne le quittera que lorsqu’il abandonnera l’Europe pour aller enseigner en Amérique.
Il tombe sous la coupe d’un gourou, Georges Saint-Bonnet, et perd tout esprit critique devant cet ami admirable qui vivra ensuite avec sa femme jusqu’à sa mort.
Il se marie trois fois, abandonnant ses enfants en France, puis son fils en Amérique avant de mourir dans un accident de voiture avec sa troisième femme à l’âge de quarante-sept ans.
Avec Le Voyant Jérôme Garcin entend réparer une injustice comme il l’avait fait avec Pour Jean Prévost. Le pays s’est montré ingrat avec cet homme qui s’est conduit de manière admirable pendant la guerre, le monde des lettres aussi, qui l’a réduit au statut d’écrivain-résistant et a refusé de publier ses romans.
Je ne sais pas si ce très beau livre réussira à sortir de l’enfer de l’oubli ce voyant magnifique ; demeure la restitution vibrante de fraternité de cet homme qui a marqué ceux qui l’ont connu, restitution qui ne cèle rien des zones d’ombres du personnage.
Les trois enfants, Jean-Marc, Claire et Catherine, ont eu le sentiment, en 1958, d’être abandonnés. C’est à la grand-mère paternelle qu’a incombé la charge d’élever les deux fillettes que leur père avait laissées pour une nouvelle vie et que leur mère, partageant désormais celle de Saint-Bonnet et peu portée sur l’éducation, avait préféré éloigner. Quant à Jean-Marc, il fut confié depuis sa plus tendre enfance à sa grand-mère maternelle, Charlotte Pardon.
Père défaillant, mari toujours volage, Jacques Lusseyran ne se sentait vraiment lui-même qu’en écrivant, sur une machine à écrire normale et pas en Braille. Et c’est cette vie-là que la postérité lui a refusée.
Il ne reste pas grand-chose de la vie brève de Jacques Lusseyran, dont la philosophie et l’éthique reposent sur un principe élémentaire ; c’est au-dedans que le regard exerce son vrai pouvoir, que le vaste monde se donne à voir et que vivent, en harmonie, se tenant par la main, les vivants et les morts. S’exercer à fermer les yeux est aussi important qu’apprendre à les ouvrir.
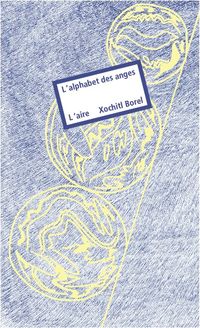 Dans le cadre de la sélection suisse du concours Lettres Frontière 2015, j’ai lu L’alphabet des anges publié aux Éditions de l’Aire à Vevey dans la jolie ville du bord du lac Léman.
Dans le cadre de la sélection suisse du concours Lettres Frontière 2015, j’ai lu L’alphabet des anges publié aux Éditions de l’Aire à Vevey dans la jolie ville du bord du lac Léman.