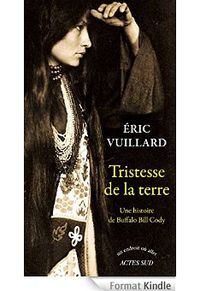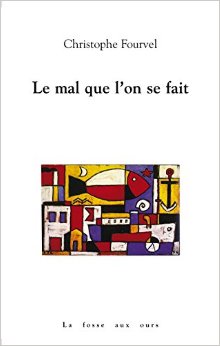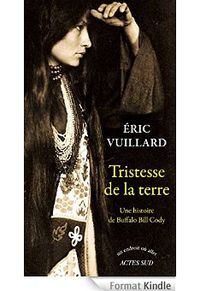 Une histoire de Buffalo Bill Cody : l’article possède toute son importance dans le sous-titre d’Eric Vuillard qui situe d’emblée son texte comme une construction autour de la vie du chasseur de bisons. D’ailleurs qu’y a-t-il de véridique chez ce héros de l’Ouest, ce type un peu ridicule avec sa veste à franges qui fait dire « Wouh Wouh » aux Indiens ?
Une histoire de Buffalo Bill Cody : l’article possède toute son importance dans le sous-titre d’Eric Vuillard qui situe d’emblée son texte comme une construction autour de la vie du chasseur de bisons. D’ailleurs qu’y a-t-il de véridique chez ce héros de l’Ouest, ce type un peu ridicule avec sa veste à franges qui fait dire « Wouh Wouh » aux Indiens ?
Eric Vuillard nous raconte avec précision et fascination le premier et l’un des grands spectacles de divertissement du monde, le Wild West Show. Un spectacle hors normes qui accueille deux fois par jour sous un immense chapiteau 18’000 spectateurs ! Un spectacle qui se produit en Amérique mais aussi en Europe, plus de 70 millions de personnes se presseront à cette grandiose et mensongère reconstitution de la conquête de l’Ouest.
C’est ainsi que, de gare en gare, bien après l’Italie, après d’innombrables autres représentations, la troupe, qui avait traversé l’Atlantique et parcouru l’Europe, était un beau jour arrivée à Nancy. Il avait fallu plusieurs bateaux pour traverser l’océan. Les cales contenaient 1 200 pieux, 4 000 mâts, 30 000 mètres de cordage, 23 000 mètres de toile, 8 000 sièges, 10 000 pièces de bois et de fer, et tout ça devait former une centaine de chapiteaux éclairés par trois dynamos et surplombés par tous les drapeaux du monde. La troupe comptait huit cents personnes, cinq cents chevaux de selle et des dizaines de bisons.
Le premier spectacle total dans une immense arène, avec une fausse armée mais de vrais Indiens, et le plus souvent possible les vrais acteurs des grandes batailles où leur peuple a trouvé la mort. Perversité, humiliation et sens des affaires, après la représentation les Indiens vendaient de la bibeloterie indienne.
Le spectacle est fini ; les gens se promènent entre les boutiques d’artisanat indien et les stands de hot-dogs. On jette un coup d’œil, on enfile un collier. (…) C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le merchandizing. Les Indiens vendent les produits dérivés de leur génocide. (…)
Le premier show et les premiers produits dérivés de ce qui deviendra l’industrie que nous connaissons.
Le massacre de Wounded Knee devient une bataille très fair play dans le grand show bien rôdé, un génocide dont la foule en délire redemande encore une représentation, et les morts se relèvent et recommencent à mourir.
L’Indien est mort. Les cavaliers remontent en selle et quittent la piste. La foule applaudit et bisse ; car à cet instant, on désire plus que tout revoir la scène, oui, juste la fin tragique, seulement ça, la mort du chef indien. (…) Alors l’acteur se relève, les morts ressuscitent, les cavaliers reviennent en scène ; et on rejoue le final.
Tristesse de la terre, quel beau titre, poignant et amer comme ce roman où les photographies d’époque des personnages ajoutent un peu plus de vérité, à moins que nous soyons égarés comme les spectateurs de cette fin du XIXe siècle en face de la mise en scène des Indiens.
Vertige de la représentation, du divertissement de masse présenté comme une option véridique de l’histoire, vertige des acteurs qui ne savent plus, à force de répétitions et d’applaudissements où se situe la réalité. La belle écriture de l’auteur renforce l’empathie envers le destin tragique des Indiens, pourtant j’émets des réserves sur la fin du livre.
Après quelques pages d’une puissante tristesse sur la vieillesse de Cody, l’auteur reprend cette idée du divertissement de masse avec Elmer Dundy fondant le premier Luna Park avant de basculer sur des « histoires » sur la fin des Indiens dans leurs réserves, et sur les photos de flocons de neige de Wilson Alwyn Bentley. Cela donne un peu l’impression d’un texte qui ne sait pas finir, à moins qu’après tant de tristesse dans le grossièrement grand il ait voulu finir par les infinies beautés du minuscule et de l’éphémère.