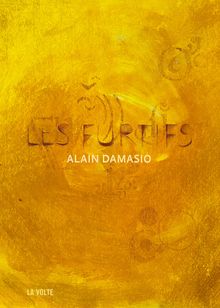 Cet épais roman (presque sept cents pages) commence par un chapitre aussi palpitant que dérangeant : la première traque de Lorca Varese, son examen de passage. Lorca réussit : il voit le furtif et celui-ci se vitrifie aussitôt à 1400 degrés. Par une sorte d’inversion du mythe antique de la Gorgone qui pétrifiait tout mortel croisant son regard, les furtifs meurent si on les voit. Lorca peut rejoindre l’élite très fermée des chasseurs de furtifs, les militaires du Récif – acronyme pour « Recherches, Études, Chasse et Investigations Furtives ». Ce n’est que le premier des nombreux acronymes qu’affectionne l’auteur, Alain Damasio, mais le lecteur n’est pas au bout de ses surprises…
Cet épais roman (presque sept cents pages) commence par un chapitre aussi palpitant que dérangeant : la première traque de Lorca Varese, son examen de passage. Lorca réussit : il voit le furtif et celui-ci se vitrifie aussitôt à 1400 degrés. Par une sorte d’inversion du mythe antique de la Gorgone qui pétrifiait tout mortel croisant son regard, les furtifs meurent si on les voit. Lorca peut rejoindre l’élite très fermée des chasseurs de furtifs, les militaires du Récif – acronyme pour « Recherches, Études, Chasse et Investigations Furtives ». Ce n’est que le premier des nombreux acronymes qu’affectionne l’auteur, Alain Damasio, mais le lecteur n’est pas au bout de ses surprises…
Lorca n’est pas un militaire, mais un civil. C’est un intellectuel impliqué dans les mouvements altermondialistes. Il a choisi cette formation militaire parce que sa fille Tishka a disparu depuis deux ans et qu’il est persuadé qu’elle a été enlevée par un furtif et qu’elle est vivante. Il veut la retrouver. Sa femme Sahar, dont il est séparé depuis la disparition inexpliquée de leur fille de quatre ans, se force à penser que sa fille est morte en espérant reprendre le cours de sa vie. Deux versants de la même douleur de parents.
Sahar est « proferrante », c’est-à-dire qu’elle se déplace dans les zones non couvertes par l’éducation privée et donne des cours à des adolescents dans les cours d’immeuble.
Le roman se passe en légère anticipation, une vingtaine d’années à peine, et l’éducation a failli, tout comme l’état, et les villes ont été rachetées par de grandes sociétés privées. Quant aux citoyens, à part ceux qui résistent, les autres s’enferment dans leur propre réalité. Légère anticipation, vraiment, quand on pense à la façon dont les téléphones portables et internet ont déjà modifié notre vie. Le roman de Damasio n’est qu’une projection fort crédible de ce qui nous attend bientôt avec la miniaturisation :
À la volée, j’ai observé les gens sur les gradins des places et dans les anses anti-cohue de l’Orange Boulevard, qui soliloquaient avec leur intelligence de compagnie. Tous ces citoyens couverts d’ubijoux, que je ne regardais plus depuis deux ans tant ils me déprimaient ; ces filles parées de bracelets où elles stockent en dur leur vie numérique, avec leur piercing discret aux narines qui est devenu la norme pour le micro intégré ; ces garçons équipés de baskets autoportantes, qui flottent à ras l’asphalte et semblent voler comme Hermès vers leur destination d’un laconique « Place Retina, please ».
À ma grand surprise, je n’ai même pas senti l’agacement monter : j’ai trouvé ça presque beau, cette fluidité, ces individus qui glissent sans s’entrechoquer, chacun dans leur bulle de savon digitale, qui discutent avec leur MuM (My unique Machine), leur moa (my own assistant), bref devisent avec leur alter ego virtuel – valet, maman ou esclave, c’est selon le style ou l’humeur – sans se soucier de quiconque. (p. 366)
Les gens qui en ont les moyens portent la bague, l’outil absolu, celui qui procure tout ce dont on a besoin. La bague, c’est l’anneau du pouvoir chez Tolkien, c’est également l’antique anneau médiéval devant lequel on s’incline avec soumission. « Self serf vice » écrit l’auteur. La servitude volontaire, la pire des aliénations puisqu’elle naît de notre passivité, de notre refus de l’effort ou du danger de la confrontation à l’autre. En sommes-nous si loin ?
Le revers de cette société anesthésiée, c’est le glissement vers la léthargie, et seuls quelques îlots de résistance refusent cette dictature de l’hypercontrôle et de la discrimination par l’argent. C’est l’occasion pour l’auteur de nous introduire dans les philosophies de vie de certaines sociétés traditionnelles comme la société balinaise. Impossible pourtant de passer totalement à travers les mailles de ce monde entièrement connecté. Seuls échappent à ce contrôle absolu les êtres qui se glissent dans les angles morts, ultrarapides et sans cesse en train de se transformer : les furtifs.
Lorca, avec l’aide des amis qu’il s’est fait au sein de sa meute de chasseurs, va retrouver sa fille, et le roman ne s’arrête pas là, il bondit, rebondit, virevolte, ne laisse pas un instant son lecteur souffler. Il alterne batailles dignes du Seigneur des Anneaux et longues digressions philosophiques sur la nature des furtifs, éléments de pure poésie graphique et histoires d’amour ou d’amitié.
Parfois c’est trop, beaucoup trop, on étouffe, on a envie de dire stop, perdus dans cette arborescence monstrueuse, gênés par cette forêt de signes qui se greffent sur le texte. Au début on pense que les machines destinées à imprimer le texte étaient encrassées, rajoutaient des points et des virgules un peu partout. Suivent bientôt parenthèses et l’alphabet grec, sans compter cédilles ou les signes utilisés dans les langues slaves, les accents, trémas et autres fantaisies qui tombent comme un cheveu sur la soupe. On comprend que ce n’est pas une erreur, que c’est volontaire, histoire de signaler que non seulement le texte est en mouvement perpétuel, mais la langue aussi.
Personnellement je ne m’extasie pas devant cette trouvaille qui figurait déjà à l’état embryonnaire dans premier roman, La Zone du dehors. Cela m’a beaucoup gênée, je devais sans cesse évacuer mentalement ce qui me semblait une rupture de contrat entre l’auteur et le lecteur : la lisibilité du texte. Est-ce que cela apporte vraiment grand chose, ces signes cabalistiques pour signaler qui parle et évolue ? On passe sans cesse d’un point de vue à un autre, d’un niveau de langue à un autre, aucun personnage n’est signalé : l’auteur fait confiance à l’intelligence de son lecteur, je suppose. Certes. Dans mon cas, la lectrice moyenne que je suis a été fatiguée, agacée par ce que l’auteur considère sans doute comme un éclair de génie.
J’avoue que si le texte n’avait pas été aussi riche, aussi intéressant, je me serais arrêtée en cours de route. Las, c’était aussi irritant que passionnant. Un somptueux travail sur le langage, sur ses évolutions possibles au cours d’hybridations, des néologismes à la pelle et pratiquement toujours hautement signifiants, leur progression suivant finement celle des protagonistes. La description de ce qui est à peine une anticipation, ainsi que des utopies déjà mises en chantier dans les ZAD, mais développées, théorisées. Le travail sur les temps, avec l’intrusion de l’irréel du passé, cette forme subtile de conditionnel qui introduit les possibles dans le passé. La poésie, éblouissante parfois.
J’ai zappé les passages trop illisibles pour mes yeux fatigués, les digressions longuettes, les compte-rendus et les batailles itou.
Si vous êtes prêts à vous lancer dans ce roman expérimental, touffu, foutraque parfois, toujours en mouvement, toujours en transformation, à une vitesse qui donne le tournis, au mépris des règles les plus élémentaires de la narration, ce livre est pour vous. Vous êtes prêt à suivre un furtif de la langue, un OVNI littéraire, philosophique et sociologique, un homme qui veut rester vivant.
Le roman possède un complément logique à un texte où ce qui est audible est bien plus important que ce qui est visible. C’est l’album Entrer dans la couleur, composition Yan Péchin, guitariste, dont voici un extrait. Une bande originale pour un livre, c’est tout à fait dans la ligne du roman. Il existe même la version audio.

Je suis très attiré par ce livre, mais une nouvelle fois, je ne lis pas un avis entièrement enthousiaste … Tant pis, et merci 🙂
Mais, ma chère Laure, il faut le lire! C’est un livre très original! J’ai seulement trouvé lassantes les « trouvailles graphiques » envahissantes. Le fait que beaucoup de lecteurs en fassent abstraction très vite ne démontre aucunement l’utilité du procédé à mon avis. À vous de vous faire une opinion…