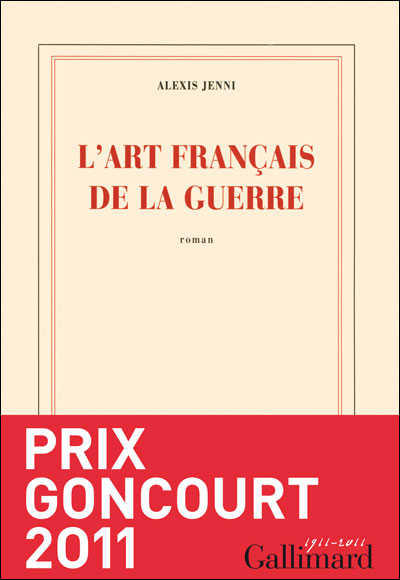Frères et sœurs écrivains à la désespérance rampante devant le manque de reconnaissance, vous avez lu L’art français de la guerre d’Alexis Jenni, sonnés par cette incongruité : le premier roman publié d’un confrère en frustration, chez Gallimard de surcroît, prix Goncourt de l’année.
La citation de la quatrième de couverture est un excellent résumé de ce qui attend le lecteur : un narrateur qui va mal et un héros qui a fait toutes les guerres coloniales après 1945 tout en étant « le seul peintre de l’armée coloniale ».
Tout est dit.
Victorien Salagnon peint ce qu’il voit, Alexis Jenni aussi.
La guerre, la torture, tous les sans-grades qui ont appris à tuer pendant la seconde guerre mondiale, ceux que l’on ne pouvait pas renvoyer à la vie civile et que l’on a recyclés dans les guerres coloniales, de l’Indochine à l’Algérie. Réalité historique, hélas.
La banlieue de Lyon ou d’ailleurs, la pharmacie de nuit, la boucherie.
La boucherie, le sang, tout nous renvoie à la guerre, l’art français de la guerre avec ce que ce titre ironique recèle d’amertume.
Lisez ce livre, si ce n’est déjà fait. L’histoire du colonialisme et des guerres coloniales n’est pas le propos de Jenni, seules comptent les répercutions humaines de certains choix de notre pays, leurs descriptions sans décryptage.
Ce Goncourt-là en rachète beaucoup d’autres, car Alexis Jenni possède un style bien à lui, sur le fil entre grandiloquence et poésie, tripailles et trait de pinceau à l’encre de chine.
Une œuvre pleine d’excès qui s’affaiblit un peu avec la vieillesse des protagonistes devenus modèles d’un groupuscule d’extrême droite et surtout avec l’histoire d’amour du narrateur, les « mon cœur » ou les « yeux auréolés de duvet de cygne ». Aie… Dommage.
Oubliez ces scories, ou plutôt ne les oubliez pas lorsque vous entreprendrez votre opus, celui qui, promis, sera publié chez un concurrent de Gallimard.
Nicole Giroud
Papiers d'Arpèges – Notes de rires et de larmes