Cela me travaillait depuis quelque temps cette envie d’un retour aux échanges, de sortir de l’écriture solitaire et d’offrir aux autres une partie de l’expérience accumulée depuis des années d’écriture, que ce soit de romans, de nouvelles et d’une biographie.
 J’ai été confrontée à l’essai autobiographique d’une personne proche, à celle d’un vieil homme qui était passé par un biographe professionnel et à celui d’une jeune femme qui désirait réorienter sa carrière professionnelle et à qui on avait demandé d’écrire son autobiographie. Elle avait été surprise de la demande, mais elle s’était vite prise de passion pour l’exercice. Je me souviens également d’avoir pratiqué l’exercice avec un adolescent particulièrement violent et perturbé qui avait éructé sur la page un cri de colère et donné un éclairage cru sur la maltraitance paternelle dont il avait été victime. Cela l’avait beaucoup aidé à se calmer. La jeune femme a pu réorienter non seulement sa carrière professionnelle, mais sa vie privée ; son autobiographie était surtout une auto-analyse. Le biographe professionnel avait réussi à rendre plate une vie pleine de péripéties mêlées à l’Histoire, la faute peut-être aux délais, je ne sais pas. Quant à la personne proche, elle avait écrit dans l’urgence, son temps était compté. Elle n’a pas pu travailler son texte.
J’ai été confrontée à l’essai autobiographique d’une personne proche, à celle d’un vieil homme qui était passé par un biographe professionnel et à celui d’une jeune femme qui désirait réorienter sa carrière professionnelle et à qui on avait demandé d’écrire son autobiographie. Elle avait été surprise de la demande, mais elle s’était vite prise de passion pour l’exercice. Je me souviens également d’avoir pratiqué l’exercice avec un adolescent particulièrement violent et perturbé qui avait éructé sur la page un cri de colère et donné un éclairage cru sur la maltraitance paternelle dont il avait été victime. Cela l’avait beaucoup aidé à se calmer. La jeune femme a pu réorienter non seulement sa carrière professionnelle, mais sa vie privée ; son autobiographie était surtout une auto-analyse. Le biographe professionnel avait réussi à rendre plate une vie pleine de péripéties mêlées à l’Histoire, la faute peut-être aux délais, je ne sais pas. Quant à la personne proche, elle avait écrit dans l’urgence, son temps était compté. Elle n’a pas pu travailler son texte.
Tout ceci montre que le temps est nécessaire pour la réussite de l’essai autobiographique. La nécessité du recul par rapport à la vision des événements qui ont traversé l’existence, le travail sur la notion de vérité, sur la lucidité et la modestie nécessaires parce que celle ci ne sera jamais que partielle et partiale, ce que l’on veut que le lecteur potentiel retienne : tout ceci doit être mis au net avant le travail de mémoire. De nombreux conseils et exercices techniques aident au déblocage qui surgit souvent devant l’étendue de la tâche. Le travail en groupe soutient les apprentis biographes en leur montrant que les difficultés sont les mêmes pour tous, les observations des autres participants aident à progresser, à condenser le travail d’écriture, à cerner ce qui est en trop et ce qui mérite au contraire d’être développé. Ce travail est essentiel pour trouver son propre tempo, la façon unique dont on racontera sa vie.
C’est décidé. À la rentrée j’animerai un atelier initiation au récit autobiographique dans mon petit coin de montagne. Dans le texte ci-dessous j’explique les questions inhérentes à l’autobiographie, ses joies et ses difficultés. Continuer la lecture

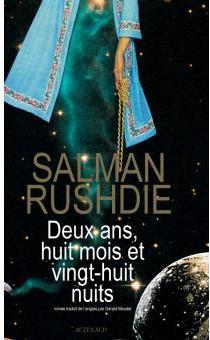 Il existe de mauvaises raisons de lire un roman ; le suivi moutonnier suite au matraquage médiatique, les prix littéraires et… le conformisme moral. Je n’avais jamais lu les Versets sataniques, ni les autres romans de Salman Rushdie, et je trouvais que je devais lire quelque chose d’un homme condamné à mort par une fatwa de l’ayatollah Khomeiny pour avoir écrit un roman. J’ai été punie, c’est bien fait pour moi : le conformisme en littérature comme ailleurs, est une faute, une malhonnêteté intellectuelle.
Il existe de mauvaises raisons de lire un roman ; le suivi moutonnier suite au matraquage médiatique, les prix littéraires et… le conformisme moral. Je n’avais jamais lu les Versets sataniques, ni les autres romans de Salman Rushdie, et je trouvais que je devais lire quelque chose d’un homme condamné à mort par une fatwa de l’ayatollah Khomeiny pour avoir écrit un roman. J’ai été punie, c’est bien fait pour moi : le conformisme en littérature comme ailleurs, est une faute, une malhonnêteté intellectuelle. On a beaucoup parlé de ces coups de folie qui frappent de jeunes hommes et qui n’ont rien à voir avec un embrigadement religieux ; très récemment c’est dans un train suisse que ce délire a frappé, conduisant à la mort d’une passagère et celle de l’auteur de l’attentat. Les Allemands nomment ce phénomène amok d’après la nouvelle de Stephan Zweig qui décrit très bien le phénomène. Ce mot est familier de nos voisins allemands, ils l’utilisent pour caractériser certains comportements très contemporains, comme la conduite automobile dangereuse ou les tireurs pris d’un coup de folie. Amok est quasiment passé dans la langue commune, loin de son origine malaise transmise par les Hollandais et qui peut être traduit par « rage incontrôlable ».
On a beaucoup parlé de ces coups de folie qui frappent de jeunes hommes et qui n’ont rien à voir avec un embrigadement religieux ; très récemment c’est dans un train suisse que ce délire a frappé, conduisant à la mort d’une passagère et celle de l’auteur de l’attentat. Les Allemands nomment ce phénomène amok d’après la nouvelle de Stephan Zweig qui décrit très bien le phénomène. Ce mot est familier de nos voisins allemands, ils l’utilisent pour caractériser certains comportements très contemporains, comme la conduite automobile dangereuse ou les tireurs pris d’un coup de folie. Amok est quasiment passé dans la langue commune, loin de son origine malaise transmise par les Hollandais et qui peut être traduit par « rage incontrôlable ».