Le Rwanda était un petit pays d’Afrique inconnu de la plupart des Européens il y a une vingtaine d’années. Tout changea en avril 1994 lorsque les premiers témoignages racontèrent les atrocités qui s’y passaient. Durant cent jours, entre huit cent mille et un million de Tutsi ont été massacrés par les Hutu, soit les trois quart de la population tutsi.
Les tutsi, les cafards, comme les surnomment les Hutu, les cafards à exterminer.
L’écrivaine rwandaise Scholastique Mukasonga, française par son mariage avec un coopérant rencontré au Burundi, se trouvait au moment des événements en Normandie où elle vivait avec son mari français et ses deux enfants. Cela lui a sauvé la vie.
Comment continuer après le massacre de presque toute sa famille ? Comment écrire lorsque l’on n’a dû son salut qu’au fait de se trouver à l’extérieur du pays au moment du génocide ? Toute l’écriture de Scholastique Mukasonga tourne autour de de cette problématique.
J’ai parlé des difficultés de l’autobiographe à capter le réel ; c’est bien plus compliqué lorsque les circonstances de la vie sont mêlées à un événement aussi épouvantable. L’auteure doit avoir à l’esprit à chaque instant, au moment où elle écrit et tente de faire revivre son passé pour ses lecteurs, le massacre qui a laminé les siens.
Le récit de Scholastique Mukasonga est un excellent exemple de la façon dont un écrivain peut transcender la matière de sa vie, la dépasser pour en faire un objet à la fois ethnologique, historique et sociologique. Dans ce retour sur l’enfant et la jeune fille d’autrefois, c’est tout un monde disparu que l’auteure ressuscite.
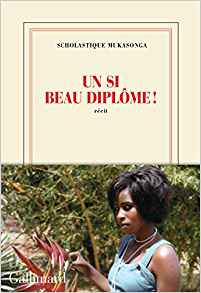 Un si beau diplôme ! raconte l’obstination de l’auteure a obtenir le diplôme d’assistante sociale, c’est le fil conducteur de ce récit autobiographique. Cette quête du diplôme commence dès l’enfance, et ce n’est pas pour rien que l’auteure dédie son livre à son père, Cosmas, « pour qui seule l’école pouvait sauver la mémoire », ce père qui ne voyait de salut pour ses enfants que dans un diplôme. Cosmas savait mieux que personne que les Tutsis étaient en sursis, lui qui avait été forcé d’accepter le regroupement des Hutu et pressentait le pire.
Un si beau diplôme ! raconte l’obstination de l’auteure a obtenir le diplôme d’assistante sociale, c’est le fil conducteur de ce récit autobiographique. Cette quête du diplôme commence dès l’enfance, et ce n’est pas pour rien que l’auteure dédie son livre à son père, Cosmas, « pour qui seule l’école pouvait sauver la mémoire », ce père qui ne voyait de salut pour ses enfants que dans un diplôme. Cosmas savait mieux que personne que les Tutsis étaient en sursis, lui qui avait été forcé d’accepter le regroupement des Hutu et pressentait le pire.
En tout cas, […] c’est ce papier, si tu l’as un jour et il te le faudra, idipolomi nziza, un beau diplôme, c’est ce qui te sauvera de la mort qui nous est promise, garde-le toujours sur toi comme le talisman, ton passeport pour la vie. (p. 12)
La petite fille veut devenir assistance sociale, mais elle sait que cela risque d’être difficile « puisque ma carte d’identité portait, comme une marque infamante, la mention TUTSI. »
Contre toute attente elle est prise dans l’école, mais elle en est chassée comme les autres Tusti en 1973. Elle continue ses études au Burundi, mais l’école des religieuses flamandes ne ressemble en rien à celle des religieuses québécoises, ce qui nous vaut de savoureuses descriptions de cette école où règne
l’affectation de pieuse soumission imposée à toutes, l’hypocrisie élevée au rang de vertu
ainsi que de savoureux portraits :
Sœur Mariette, la supérieure, exerçait sur l’école, élèves, professeurs, cuisinières, boys et boyesses, jardiniers, gardiens de nuit, une autorité absolue. Elle n’avait pas besoin de parler pour se faire obéir – il me semble que je ne l’ai jamais entendue donner un ordre –, il lui suffisait, derrière le masque d’un sourire à jamais figé sur son visage, de diriger sur l’une ou l’autre des élèves ses petits yeux inquisiteurs pour que celle-ci se sente aussitôt coupable d’une faute qu’elle ignorait jusque-là avoir commise mais que, dans son omniscience, la sœur supérieure n’avait eu aucune peine à déceler. […] À Gitega, sœur Mariette voyait tout, entendait tout, savait tout, était partout. Car si à Nyamata Dieu n’avait qu’un œil, à Gitega sœur Mariette en avait deux.
L’évocation de la vie des réfugiés rwandais au Burundi est pleine de vie et d’humour, ce qui n’exclut pas la description de l’extrême pauvreté de ces immigrants de la deuxième vague. La première, celle de 1960, composée de la classe sociale supérieure tutsi, ne se mélange pas avec elle. L’auteure nous donne également un excellent aperçu de la vie des femmes, vie de travail uniquement consacrée à la nourriture de leur famille. Les femmes groupées de leur côté et les hommes au café.
La jeune fille obtient son fameux diplôme, mais cela ne suffit pas à trouver du travail, elle se voit confier une mission de l’UNICEF et rencontre son mari, un coopérant français avec qui elle partira à Djibouti. C’est l’occasion de la découverte de l’excision des petites filles, inconnue dans son pays chrétien.
L’auteure ne parle que très peu de sa vie privée, seulement des événements factuels : la naissance de deux enfants, la mutation et la vie à Djibouti, le retour en France et l’établissement en Normandie.
Ce retour en France s’accompagne de difficultés : son diplôme n’est pas reconnu et elle s’obstine dans les arcanes administratives, se décrit avec humour avec le regard qu’elle imagine qu’on porte sur elle, cette femme africaine digne et sûre de son bon droit.
Il me parut donc de meilleure tactique d’expliquer « ma motivation » que j’avais si soigneusement, si longuement rédigée et mise bien à l’abri dans mon sac à main. Ce petit sac était sur mes genoux, je l’ouvris pour y prendre mes cinq feuillets. Ils n’y étaient pas. Je fouillai désespérément le sac, bousculant le bric-à-brac qu’il contenait. Je n’écoutais plus rien. Je regardai à mes pieds, sous ma chaise. Mes examinatrices suivaient mon manège, étonnées et amusées, sans comprendre mon agitation. Elles le furent plus encore quand je déclarai sur le ton du désespoir :
— J’ai perdu ma motivation !
— Quoi ? Qu’avez-vous perdu ?
— Ma motivation ! J’ai perdu ma motivation ! Pourtant, j’étais sûre de l’avoir mise dans mon sac.
Récit autobiographique ne veut pas dire épanchement, et l’immense pudeur de Scholastique Mukasonga l’empêche de s’exprimer sur la dévastation qui fut la sienne. Seulement quelques lignes, parfaitement mesurées. Et puis un saut, jusqu’au retour au Rwanda. Le nouveau petit pays qu’elle ne reconnaît pas vraiment, un pays vierge en pleine expansion économique où désormais les femmes choisissent leur mari et refusent les seconds rôles, un pays qui peine à se retourner sur son passé. Le jeune chauffeur de taxi qui l’accompagne n’était pas né au moment du génocide, il représente l’avenir, l’espoir que l’horreur ne recommencera jamais.
Ce récit comprend tous les éléments d’une autobiographie : événements, personnages principaux, portraits, élisions. Il pêche un peu du côté de la composition. La structure linéaire du récit s’affole à mi-parcours, devient chaotique. Comme si l’émotion prenait le pas sur le texte, ou qu’à vouloir tout dire l’auteure ait perdu le fil. C’est une leçon du texte autobiographique : il ne faut pas tout dire. On ne peut pas reconstituer une époque révolue, additionner dans un même texte les coutumes et la culture d’un peuple presque anéanti, l’évolution de la condition de la femme, l’exil avec une histoire personnelle un peu tronquée. Qui ne choisit pas risque d’être noyé dans son propos et d’égarer le lecteur. Ce n’est pas le cas dans ce Si beau diplôme ! parce que l’écriture est superbe et que l’émotion emporte les maladresses, mais c’est un risque certain pour quiconque ne possède pas le talent de Scholastique Mukasonga.
