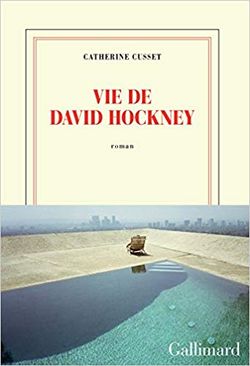 Le livre (j’ai de la difficulté à le qualifier de roman) que Catherine Cusset consacre à la vie du peintre anglais David Hockney est si intime, si lumineux et si cru parfois, qu’il semble avoir été écrit par le sujet lui-même. Très vite, on est saisi par le texte, happé par la proximité intérieure avec le peintre, les sentiments, les vibrations de la vie. L’auteure a dû être hantée par son sujet, ressentir une connivence si intime que le texte a dû couler de source à maintes reprises, offrant au lecteur ce cadeau, cette plongée dans la vie du célèbre peintre anglais et dans l’histoire de l’art du vingtième siècle.
Le livre (j’ai de la difficulté à le qualifier de roman) que Catherine Cusset consacre à la vie du peintre anglais David Hockney est si intime, si lumineux et si cru parfois, qu’il semble avoir été écrit par le sujet lui-même. Très vite, on est saisi par le texte, happé par la proximité intérieure avec le peintre, les sentiments, les vibrations de la vie. L’auteure a dû être hantée par son sujet, ressentir une connivence si intime que le texte a dû couler de source à maintes reprises, offrant au lecteur ce cadeau, cette plongée dans la vie du célèbre peintre anglais et dans l’histoire de l’art du vingtième siècle.
Catherine Cusset ne connaît pas personnellement David Hockney, elle l’explique dans l’avant-propos :
Je ne l’ai pas rencontré. Il est étrange de s’emparer de la vie de quelqu’un de vivant pour en faire un roman. Mais c’est plutôt lui qui s’est emparé de moi. Ce que j’ai lu sur lui m’a passionnée. Sa liberté m’a fascinée. J’ai eu envie de transformer une matière documentaire qui laissait le lecteur à l’extérieur en un récit qui éclairerait son trajet de l’intérieur en s’en tenant aux questions essentielles, celles qui nouent l’amour, la création, la vie et la mort. […]
Ce livre est un roman. Tous les faits sont vrais. J’ai inventé les sentiments, les pensées, les dialogues. Il s’agit plus d’intuition et de déduction que d’invention à proprement parler : j’ai cherché la cohérence et lié les morceaux du puzzle à partir des données que j’ai trouvées dans les nombreux essais, biographies, entretiens, catalogues, articles publiés sur et par David Hockney.
Le jeune David naît dans une famille dont il ne perçoit pas la pauvreté et grâce à son talent il intègre très vite une école d’art prestigieuse où règne les poncifs avant-gardistes et où il ne sait pas se situer.
Ce que tu devrais peindre, lui dit Ron un jour, c’est ce qui compte pour toi. Tu n’as pas besoin de t’inquiéter. Tu es nécessairement contemporain. Tu l’es, puisque tu vis dans ton époque. […]
Pour la première fois depuis un an, David n’avait plus de doute : il fallait peindre ce qui comptait pour lui. Il venait d’avoir vingt-trois ans. Il n’y avait rien de plus important que le désir et l’amour. Il fallait contourner l’interdit, la représentation en images comme Witman et Cafarty l’avaient mis en mots. Personne ne pouvait l’y autoriser – aucun professeur, aucun autre artiste. Cela devait être sa décision, sa création, l’exercice de sa liberté.
Moment décisif où le peintre décide de peindre des paysages, des animaux ou les gens qui font partie de sa vie en un temps où tout ce qui était figuratif était considéré comme has been. Au fil des années cela donne une autobiographie visuelle aux couleurs éclatantes correspondant à l’optimisme et à la force de vie du peintre.
Tout s’imbrique très naturellement dans cet ouvrage : la vie intime et sexuelle du peintre est étroitement liée à sa création. Nombre de passages sont très crus, les pratiques homosexuelles y sont décrites sans fioritures : désir mis à nu, concrétisation aussi naturelle que le fait de se brosser les dents. Une nécessité biologique. L’amour est très présent dans le texte et la vie du peintre, l’amour aussi déchirant parfois que la sexualité est sans entraves. Tout est admirablement décrit, au plus près de la documentation biographique accumulée sur la vie du peintre dont l’existence se confond avec sa peinture :
Il venait de renaître. Cette couleur déclarait son identité gay – son moi le plus vrai, le plus intime – et en même temps c’était un artifice, un masque, un mensonge. La nature et l’artifice n’étaient donc pas opposés, pas plus que la figure et l’abstraction, la poésie et les graffitis, la citation et l’originalité, le jeu et la réalité. On pouvait tout combiner. La vie, comme la peinture, était une scène sur laquelle on jouait.
Est-ce un livre sur la vie du peintre ou une réflexion sur l’art, la vie, la mort ? Tout est intimement lié dans ce livre à l’écriture transparente qui ajoute encore au plaisir de la réflexion et aux découvertes que l’on fait sur le peintre que l’on croyait connaître.
La vie avance, avec son lot d’amis fauchés par le Sida, les douleurs inévitables pour qui est encore là pour les éprouver. David Hockney est-il aussi positif devant les épreuves que l’auteure nous le montre ?
Il avait soixante-dix ans, bientôt soixante et onze, et se sentait plus vivant que jamais. « Si l’on nettoyait les portes de la perception, l’Univers apparaîtrait à l’homme tel qu’il est : infini », écrivait le poète William Blake. La vieillesse était l’âge du grand nettoyage, l’âge auquel on avait pour désir d’arracher à l’oubli la beauté, qu’on ne voyait jamais mieux que lorsqu’on en avait fini avec le désir sexuel et l’ambition sociale. Les Chinois disaient que la peinture était l’âge des hommes âgés, parce que leur expérience – de la peinture, de l’observation, de la vie – s’était accumulée tout au long de leur existence et rejaillissait dans leur œuvre.
Sa vitalité est intacte, sa peinture aussi lumineuse, même si l’échéance se rapproche :
Peut-être que la mort n’était pas une tragédie, qu’il n’y avait pas lieu de la craindre. Elle faisait partie de la vie. Il était inutile de la combattre. Il fallait l’embrasser. Et créer des œuvres qui mettaient de la joie dans le cœur des gens. Ce que pensaient les critiques n’avaient aucune importance. […] L’art, comme la religion, ne devrait exclure personne. Il devrait être universel.
Je me sens pleine d’admiration devant l’analyse d’un célèbre tableau peint en 1972, après sa rupture avec Peter :
C’était son plus beau tableau, plus beau que le Portrait de Christopher et Don, plus beau que le Parc des sources. Auréolé de la lumière qui baignait sa veste rose vif, son visage et ses cheveux châtains, Peter regardant le nageur dans l’eau transparente ressemblait à un ange, mais un ange avec un corps réel qui projetait sur la margelle de la piscine derrière lui une ombre puissante. On y retrouvait à la fois les fortes diagonales et la perspective verte du Parc des sources, et le bleu intense, attirant du portrait de Christopher et Don. Cette peinture reflétait la force de son amour pour Peter.
Tout se mêle dans ce roman (je viens d’écrire roman ?) qui possède la fluidité de la vie, la vitalité et la créativité du peintre, la réflexion sur l’art et la mort. C’est un vrai roman puisque Catherine Cusset crée et recrée un monde qui ne lui appartient pas.

« Ce que tu devrais peindre, lui dit Ron un jour, c’est ce qui compte pour toi. Tu n’as pas besoin de t’inquiéter »
Je pense que dans la créativité, il n’est peut être pas aisé de trouver un style, on est souvent influencé par ce qui se fait déjà par d’autres, du moins, inconsciemment on s’en inspire. Il me semble que ce conseil donné par Ron à David est une piste à suivre et à approfondir au plus profond de soi pour trouver son propre style et déterminer ce que l’on veut véritablement transmettre…
J’ajouterai que nos blessures peuvent donner aussi un espace à la création et qui mieux que nous mêmes sommes capables de leur donner une forme d’expression…
La créativité et la création sont deux notions si proches qu’on les confond souvent. On est créatif lorsqu’on peut faire quelque chose avec ce que l’on a à sa disposition, c’est bien une création! Mais la création d’un artiste atteint un autre niveau je crois. Quelque chose d’universel qui va éveiller dans les consciences certains niveaux enfouis. Chacun à notre niveau nous pouvons faire quelque chose de ce que la vie nous a donné: fragilités et douleurs, forces et faiblesses. Tout se conjugue pour donner ce que nous sommes capables de créer et de transmettre.
Merci pour votre beau et profond message, Eric.
Merci pour votre éclairage Nicole.