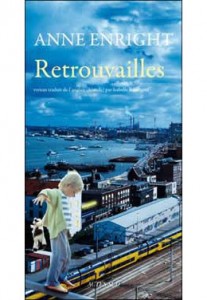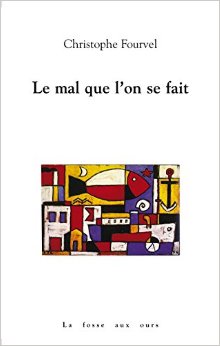 Dans le cadre de Lettres Frontière 2015 qui réunit la région suisse romande et la région Rhônes-Alpes dans le cadre d’un même concours littéraire, j’ai lu Le mal que l’on se fait de Christophe Fourvel aux éditions La fosse aux ours.
Dans le cadre de Lettres Frontière 2015 qui réunit la région suisse romande et la région Rhônes-Alpes dans le cadre d’un même concours littéraire, j’ai lu Le mal que l’on se fait de Christophe Fourvel aux éditions La fosse aux ours.
L’argument est mince : un homme fait deux séjours de trois mois hors de France, le premier dans une ville qui ressemble à Buenos Aires, le deuxième sans doute à Istanbul. Multiplication de noms de rues, de cafés, de pâtisseries et d’expressions locales, histoire de bien faire comprendre au lecteur que le narrateur se trouve en pays étranger, littéralement dépaysé.
Ce narrateur a fui un drame, et sans être vraiment futé le lecteur comprend que ses deux enfants sont morts et sa femme aussi, peut-être, on nous donnera la solution à la fin du court roman. Roman ?
La première partie utilise le pronom qui n’a rien de personnel dans le cas présent « il » pour une nécessaire mise à distance dans le temps et l’espace. La deuxième utilise le pronom un peu plus personnel et agressif « tu » pour indiquer le rapprochement spatial et temporel. À noter que l’auteur a sans doute hésité à changer de pronom, page 107 un changement oublié semble l’attester : « Il avait emmené une ou deux fois ta mère marcher sur les plages portugaises auxquelles il avait rêvé enfant, mais c’était avant que sa sœur et toi soient là ».
Des miettes biographiques : le narrateur a une sœur, il a eu des enfants, une femme, il a fait la guerre au Liban.
L’écriture est belle, très léchée, parfois un peu trop :
Le goutte à goutte de ton désespoir.
Ton cœur porte le tanin de cette musique.
Tu es revenu tard dans ta vie. Un homme ne peut pas aller vite sur ce chemin-là. Il accomplit de petits pas.
La troisième partie nous explique les raisons de ces voyages, mais la noirceur désespérée, Le mal que l’on se fait et qu’on fait aux autres par bêtise et préjugés, ne suffisent pas à faire un livre que l’on aurait envie de conseiller. L’intention est louable : qui regarde au fond de soi, trouve de ces attitudes inconscientes et perverses qui peuvent gâcher la vie de nos proches, mais j’avoue que ce livre m’a laissée froide sinon ennuyée.