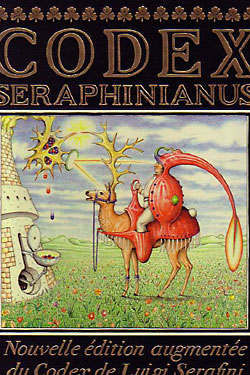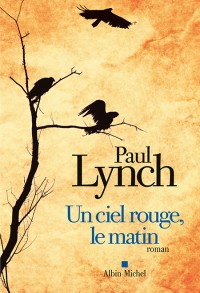 D’abord il n’y a que du noir dans le ciel, et ensuite vient le sang, la brèche de lumière matinale à l’extrémité du monde. Cette rougeur qui se répand fait pâlir la clarté des étoiles, les collines émergent de l’ombre et les nuages prennent consistance. La première averse de la journée descend d’un ciel taciturne et tire une mélodie de la terre.
D’abord il n’y a que du noir dans le ciel, et ensuite vient le sang, la brèche de lumière matinale à l’extrémité du monde. Cette rougeur qui se répand fait pâlir la clarté des étoiles, les collines émergent de l’ombre et les nuages prennent consistance. La première averse de la journée descend d’un ciel taciturne et tire une mélodie de la terre.
Bienvenue en Irlande et dans la noire poésie de ce stupéfiant premier roman d’un Irlandais de 37 ans, Paul Lynch.
Un premier roman ce diamant noir aux arêtes polies ? Un premier roman ce texte lyrique, cruel, implacable comme une tragédie grecque ? Un premier roman cette narration qui vous emprisonne, vous subjugue et vous laisse pantois ?
Il y a très longtemps que je n’ai pas lu un roman dont mon esprit critique affûté ne me souffle pas « Ici c’est trop long, ce dialogue est inutile, mal construit », etc. Je me suis trouvée dans un sentiment d’urgence et d’étouffement, de sidération et d’admiration devant la progression implacable de la narration, de la richesse du vocabulaire et de la splendeur visuelle des images. Entre parenthèses, coup de chapeau à la traductrice, Marina Boraso.
L’histoire est très simple : en Irlande, au milieu du XIXe siècle, un jeune métayer vient d’apprendre par le fils du propriétaire que lui et sa famille seront expulsés. Il veut une explication mais la dispute tourne mal, Hamilton se tue accidentellement. Coll Coyle doit fuir pour éviter la pendaison. A sa poursuite, pendant tout le roman, Faller, le régisseur du domaine, peut-être le père biologique d’Hamilton, avec certitude l’incarnation du Mal. Nous suivrons la traque du jeune homme du Donegal à la Pennsylvanie où Coyle est devenu ouvrier du chemin de fer.
Une tension contracte tout son être et Coyle refuse d’admettre qu’il a peur. Pendant des heures il a contemplé avec effroi la lente éclosion du jour.
Première page du roman. Cette peur ne quittera plus Coyle, et nous non plus.
L’intensité de la traque, ce mélange étonnant de poésie et de cruauté, d’horreurs entrecoupées de descriptions lyriques de paysages ou de ciel, tout bouscule le lecteur dans ce roman. La peur et la mort rythment la narration, obsédantes. La mort ancienne du père, la mort douce du mouton que saigne Coyle pour se nourrir, la mort des malades du typhus sur le bateau ou dans le camp, les innombrables meurtres de Faller, le poursuivant.
Ce dernier est vraiment l’incarnation de la mort, un cavalier de l’Apocalypse de Saint Jean : Et j’ai vu, et voici un cheval blême ; et celui qui était assis dessus avait pour nom la Mort. Et l’Hadès le suivait de près. Faller est implacable, Coyle essaie de lui échapper avec courage et désespoir, porté par le souvenir de sa famille qu’il espère retrouver un jour : il a emporté un ruban de sa petite fille dans sa poche. Lorsqu’il perdra le ruban, nous saurons que le roman va se dénouer.
Nous suivons Coyle dans sa fuite, nous y participons avec intensité. Lorsqu’il s’embarque pour l’Amérique sur la Murmod avec Cutter, un compagnon de rencontre, nous découvrons les terribles conditions de la traversée pour les émigrants irlandais. Même à bord du bateau, croyant avoir échappé à Faller, Coyle ne peut être tranquille. Il est poursuivi par la haine du Muet qui essaie de le tuer. Le Muet est le relais temporaire de Faller dans la narration, un moyen de ne pas laisser retomber la tension. Cutter – un des rares personnages rassurants de ce roman – sauve la vie de Coyle, c’est son ange gardien en quelque sorte. Il l’appelle Inishowen, d’après le nom de l’endroit d’où il vient puisqu’il ne sait rien de lui.
Traversée hallucinante, typhus, partage sauvage des possessions des morts par les vivants et enfin l’arrivée en Amérique. Coyle et Cutter se font embaucher pour la construction du chemin de fer en Pennsylvanie. Condition de quasi esclaves. Faller a lui aussi traversé l’océan et la traque reprend.
Toutes ces fadaises qui prétendent qu’on est maître de son destin. Quelle étroitesse de vue. Chaque homme, chaque peuple est convaincu de contrôler un monde qui ne fait que les jeter aux quatre vents déclare Faller.
Le roman se termine par une sorte de superbe choral antique :
Le jour s’achève sous un ciel muet. Le forgeron lève les yeux vers les rougeurs du couchant. À l’ouest une estampe d’ombres sur le ciel, et les nuages embusqués, avec leur provision de pluie. Le vent exhale de longs soupirs, les feuilles tiennent fermement aux branches, seul l’automne les décrochera. Le monde s’enfonce dans la nuit, les oiseaux enfouissent la tête sous leur aile. Il règne un grand silence jusqu’à ce que les nuages crèvent, et un déluge descend sur la terre impassible, la vielle terre tremblante qui tourne le dos au soleil déclinant.
Comment un tel roman de la désespérance peut-il être aussi lumineux ? Je ne suis pas encore revenue de ma surprise. Voilà un très grand talent, amis lecteurs, ne le ratez surtout pas.