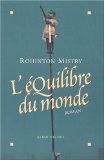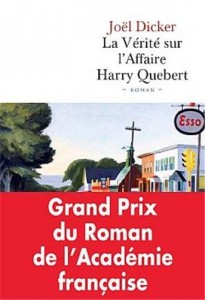Voici une petite mise en bouche : le début du premier chapitre de l’Anthogrammate qui, comme chacun sait, est un spécialiste du langage des fleurs.
Le livre paraîtra en juillet, je vous donnerai plus de détails dans quelques semaines. Bonne lecture !
Marguerite
Dans l’absolu je suppose que quarante ans d’Éducation Nationale ne prédisposent pas une institutrice à la retraite à devenir la reine de l’arnaque.
Quoique…
Combien de fois ai-je pris un air mystérieux, les yeux brillants comme si j’allais leur révéler un trésor, avant d’affirmer à mes élèves : « Nous allons faire maintenant quelque chose que vous allez adorer une fois que vous aurez compris comment cela fonctionne, et votre science étonnera vos parents ! », tout cela pour introduire les accords des participes passés avec avoir ou la règle de trois ? Je m’interroge. Non, non, il est ridicule de penser que tous ces petits mensonges nécessaires pour faire passer les pilules du savoir m’ont aidée à devenir ce que je suis. Vous connaissez beaucoup d’enfants se précipitant avec des hurlements de joie sur les tables de multiplication ?
Aucun rapport avec mes filouteries actuelles.
Arnaque, filouteries : comme j’ai changé, moi qui ai fait la chasse au terme familier, ou pire, populaire pendant des décennies, convaincue que si mes élèves apprenaient le « bon français » une place au paradis des bonnes situations les attendrait certainement. Je m’efforçais de n’employer que des termes simples mais choisis, reprenant en douceur, sans jamais me lasser, les petits qui ramenaient leur quotidien à l’école.
— M’dame, hier les keufs ont embarqué Bibi, vous savez, le mec qu’est allé à l’école avec vous ! Il avait de la blanche planquée dans ses WC, un gros paquet !
— Merci de cette information, Malika. Je suis désolée d’apprendre qu’hier la police a emmené un de mes anciens élèves parce que celui-ci trafiquait de l’héroïne. J’espère que cela n’arrivera avec aucun d’entre vous, j’en suis sûre, et vous aussi, n’est-ce pas ?
— Sûrs, maîtresse !
Ils hochaient vigoureusement la tête mais manquaient de conviction : les moyens de survivre n’étaient pas si nombreux, et moi non plus je n’étais pas sûre de ce que j’avançais mais je faisais semblant. Je refusais l’intrusion de la cité dans ma salle de classe. Ce n’était pas du passéisme mais de la résistance : j’avais une théorie que mes collègues ne partageaient pas, ils me regardaient d’un drôle d’air lorsque la chose transpirait, ce qui arrivait dans la première semaine de la rentrée :
— Alors comme ça, Marguerite, il paraît que dans ta classe on ne parle que le français ?
Je hochais la tête, attendant le mauvais coup.
— Et ils comprennent ?
Là-dessus mes jeunes collègues pouffaient de rire. Eux-mêmes employaient un langage fort proche de celui de nos élèves et se gaussaient du mien. Je m’entêtais : dans ma classe on ne parlait pas l’argot des cités, on s’essayait au français, langue étrangère inlassablement ressassée. Lorsque j’y pense, cela frôlait le ridicule. Heureusement, j’étais sauvée par le samedi matin.
Le samedi matin donc, je ramenais un livre de ma bibliothèque, Le merveilleux voyage de Nils Olgerson, un superbe volume doré sur tranche qui impressionnait beaucoup les gamins. Ils s’installaient comme ils voulaient, sur les tables, dessous, par terre, ils amenaient à manger, des coussins, n’importe quoi à part des cigarettes et de l’alcool. C’était le moment privilégié, j’allais leur lire une histoire extraordinaire, magique, un croisement entre Harry Potter et les livres dont vous êtes le héros.
Je faisais à l’instinct, Selma n’aurait pas reconnu le voyage en Suède de son héros mais elle aurait approuvé, je suis sûre, la trahison de son texte. Les yeux brillants, perdus dans leur propre rêve comme Nils Olgerson, le petit chenapan du départ, mes petits du cours moyen étaient transportés dans un autre monde, ils prenaient de la hauteur par rapport aux vicissitudes de l’existence. J’ai toujours eu le don de l’improvisation et le samedi matin je l’exploitais au maximum, utilisant les éléments de la semaine pour rassurer mes graines de misère aux grands yeux noirs : bien sûr qu’ils allaient triompher de ce monde infâme, c’était écrit dans mon beau livre, alors, comment pourrait-il en être autrement ?
C’était ma force, les histoires du samedi matin, la carotte nécessaire pour les obliger à entrer dans une culture qui leur était étrangère : pas d’insultes en arabe ou en portugais, pas de verlan, seulement du français et c’était exotique. Jamais ils ne se sont révoltés contre ce diktat : dans ma classe on parlait français, j’annonçais la couleur dès le premier cours. J’allais les transformer en Français plus blancs que blancs, avec des tournures correctes à se faire pâmer de jalousie ceux qui étaient là depuis Vercingétorix.
— Qui c’est, Vercingétorix ?
— Un ami d’Obélix.
Je prenais quelques libertés avec l’histoire, avec toutes les histoires, en fait, maintenant que j’y pense, mais c’était pour la bonne cause. L’orthographe, le calcul, j’ai dû parfois faire face à des frondes ou des mouvements de résistance larvée, mais jamais contre le français. Tous mes collègues ne pouvaient pas en dire autant.
Mes histoires du samedi matin étaient pour beaucoup dans cette soumission. Même malades ils étaient tous là, le regard perdu dans des horizons lumineux, et ma voix s’égrenait dans la salle, des échos nous parvenaient des autres classes, des chahuts parfois, rien ne les arrêtait. Ils étaient partis dans un univers de lumière où l’amitié et le courage triomphaient de tous les obstacles. Ils étaient des héros, ils étaient extraordinaires et leur vie serait belle. « Et alors Nils prit son vilain beau-père à la gorge et l’envoya dix mètres plus loin. Tous les autres enfants le félicitèrent : jamais plus Nils ne fut ennuyé par le deuxième mari de sa mère. Il avait osé s’opposer, surmonter sa peur, montrer qu’il existait ». Parfois un petit futé s’interrogeait :
— C’est bizarre, ce livre, c’est comme des histoires de par ici et pourtant sur les images on voit des forêts, pas des cités…
Il inclinait la tête, à moitié convaincu. Celui-là s’en sortirait, j’en étais sûre, quand on se méfie, on a une longueur d’avance. Il y avait tant de requins autour, prêts à manger mes petits élèves, la mer était grise, le bateau salvateur n’arrivait pas, l’oie magique leur permettant de s’élever au-dessus de la mêlée non plus. Alors on faisait ce que l’on savait faire, petits ou gros trafics, histoire d’avoir une vie. Et moi je continuais à raconter des histoires, à leur fabriquer une mythologie sur mesure.
Pendant quarante ans j’ai menti comme je respirais, entassant inventions et contrevérités avec la conscience nette et le regard franc du pédagogue pur et dur.