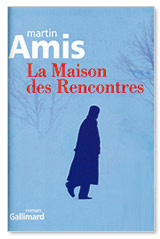Trois soldats allemands dans l’hiver polonais n’en peuvent plus des exécutions. Ils demandent à leur commandant de partir à la chasse.
Trois soldats allemands dans l’hiver polonais n’en peuvent plus des exécutions. Ils demandent à leur commandant de partir à la chasse.
« Ce soir, nous avions à dire des choses autrement importantes, et notre commandant nous comprenait et parfois hochait la tête. Nous lui expliquions que nous préférions la chasse aux fusillades, que les fusillades, nous ne les aimions pas, qu’elles nous déprimaient à présent, et la nuit, nous en rêvions. Le matin nous avions le cafard dès que nous y pensions, et nous allions finir par ne plus les supporter du tout, et alors, tout bien considéré, une fois malades pour de bon, nous ne servirions plus à rien. A un autre commandant que lui, nous n’aurions pas parlé ainsi, franchement et de bon cœur. C’était un réserviste comme nous, et lui aussi dormait sur un lit de camp. Mais les tueries l’avaient vieilli plus que nous autres ».
Ils trouveront un très jeune Juif terré dans une forêt, un chasseur Polonais avec son chien et une masure inhabitée où ils feront cuire leur repas en brûlant dans le poêle tout ce qui peut servir de combustible, ne laissant que l’essentiel, la table.
« Bauer donna le signal, il puisa une rondelle de saucisson dans la casserole et l’accompagna d’une bouchée de pain doré. Chacun y alla ensuite.
Ainsi commença le repas le plus étrange que nous fîmes en Pologne.
Dehors, par la fenêtre, la lumière était toute pâle et s’en allait encore. Les flammes dans la cuisinière nous éclairaient par derrière, nous mangions et nos ombres nous accompagnaient en dansant sur la table ».
Ce repas en hiver est une sorte d’anti-Sainte Cène. Le dernier repas de ce Juif sacrifié, le « fils de l’homme » (le plus âgé et le plus tourmenté des soldats pense à son propre fils en le voyant), ne ressemble à nul autre. La férocité antisémite du Polonais, la haine qui sourd de son échange avec un des soldats, la lassitude et la tristesse du dernier homme.
Quel tour de force que ce roman tout en ellipse où triomphent la faim, la lassitude, le froid et la mort ! Et l’humanité aussi, avec le soutien fragile et maladroit des deux premiers soldats par rapport au troisième qui s’inquiète pour son fils, cet homme tourmenté dont on sait dès le départ qu’il va mourir au printemps.
Une histoire improbable et implacable, un déroulement de tragédie grecque si parfaitement orchestré que l’on peine à respirer dans cet univers clos où les phrases sont comme les pierres roulées par les glaciers ; pas une aspérité, seulement une densité écrasante, un huis-clos dont on ressort un peu groggy mais fasciné.
 Fusion. Tendresse, apaisement.
Fusion. Tendresse, apaisement.