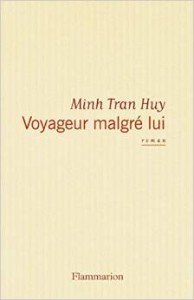Ce matin Augustin Trapenard recevait Fabrice Luchini, le diseur irritant et magnifique, celui dont on a l’impression que, quelle que soit son écrasante et fabuleuse érudition, sa digestion des monuments de la littérature française, sa façon de rendre lumineuse la poésie à un public qui ne l’aurait peut-être jamais approchée, jamais il ne comblera la blessure originelle de ne pas avoir fait d’études.
Aujourd’hui encore il nous a resservi son passé de garçon coiffeur et a débiné le certificat d’études, ce « petit morceau de papier pour les exclus du savoir », quelque chose comme ça.
Je ne peux pas le laisser dire.
J’appartiens à cette génération où le certificat d’études existait encore, mais les gens qui étaient destinés à faire des études ne le passaient pas. Peu de temps après, quand on a prolongé la scolarité au-delà de quatorze ans en France il est tombé en désuétude.
Je viens d’un milieu où, lorsqu’il me surprenait en train de lire, mon père me giflait parce que je ne faisais rien. Ceci explique mon choc lorsque j’ai lu Le Rouge et le Noir au lycée, quand j’ai lu la scène où Julien Sorel est giflé par son père dans la scierie parce qu’il est surpris à lire (§ 8).
J’ai fait des études mais j’ai tenu à passer le seul diplôme que l’on connaissait dans ma famille : le certificat d’études. Il est faux de dire comme le fait Fabrice Luchini que ce « petit morceau de papier » n’avait aucune valeur. Il signifiait que l’on savait lire, écrire et compter. C’était un grand diplôme orné de fioritures sur les bords, un diplôme destiné à être encadré avec fierté.
Je n’en ai jamais eu d’aussi beau. Le brevet puis le bac, les certificats de licence, tout rétrécissait comme peau de chagrin, tiré vers l’abstraction. Les diplômes de licence et de maîtrise : tristes fiches cartonnées d’un vilain gris.
Mon certificat a disparu au fil des déménagements mais vous pouvez voir celui de Coluche qui en était fier.

Certificat d’études de Coluche
Fabrice, vous avez prouvé à tout le monde que vous maîtrisiez de l’intérieur ce qui était prémâché pour les autres. Vous avez échappé au Lagarde et Michard expliquant aux lycéens quels auteurs ils devaient admirer, pourquoi et comment. Vous avez échappé au formatage, au conformisme pour conserver la force brute des textes et la restituer à ceux qui vous écoutent ou viennent vous voir.
C’est ainsi que vous êtes grand, laissez tomber le reste s’il vous plaît.