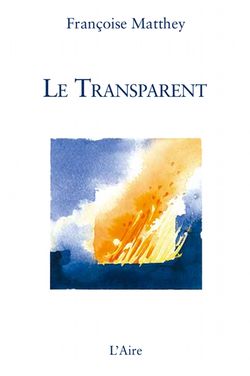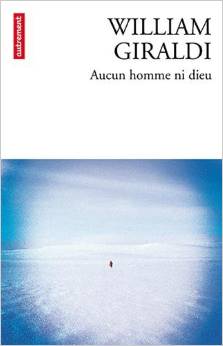Ce repas inoubliable vous rend perplexe, beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’a pris. Hormis les prémisses du printemps réveillant une libido inventive, le bel éphèbe sur lequel se déroulent les agapes de mon texte trouve son origine dans une installation d’une surréaliste suisse injustement oubliée, Meret Oppenheim.
Ce repas inoubliable vous rend perplexe, beaucoup d’entre vous se demandent ce qui m’a pris. Hormis les prémisses du printemps réveillant une libido inventive, le bel éphèbe sur lequel se déroulent les agapes de mon texte trouve son origine dans une installation d’une surréaliste suisse injustement oubliée, Meret Oppenheim.
Une petite mise en perspective ne fait pas de mal, surtout lorsqu’elle concerne le mouvement surréaliste dont on pense que ses membres étaient de grands révolutionnaires qui ont libéré l’imagination et décuplé les possibles. Las, ne rêvez pas mesdames. Il en est des révolutionnaires en art comme en politique : les grandes idées fusent au salon pendant que les femmes font la vaisselle. On s’échange les femmes, on se passionne pour le marquis de Sade, on désarticule des poupées comme Hans Bellmer, on met un petit buste de femme au niveau des parties masculines comme dans Le Grand Masturbateur de Dali.
Bref la libération de l’imaginaire masculin passe par l’asservissement de la femme, rien de bien révolutionnaire sous le soleil. Quant à la libération sexuelle de la femme, pas de gros mots je vous prie.
Mais… mais un grain de sable grippe la machine en 1959 : la surréaliste suisse Meret Oppenheim. Pour la Fête du printemps, elle présente à Berne une installation qu’elle intitule « Le Festin » : sur le corps d’une femme nue dont le visage est doré comme celui d’une sculpture, elle a posé la nourriture du buffet. André Breton, expert en récupérations, lui demande de refaire l‘installation en décembre pour l’Exposition internationale du Surréalisme à la galerie Cordier. Le propriétaire, Daniel Cordier, grand Résistant, était l’ancien secrétaire de Jean Moulin qui a unifié la Résistance.
Meret reprend le thème ; cette fois ce n’est pas une femme vivante qu’elle pose sur la table du festin mais un mannequin troublant, un peu mou. Regardez les photos, cela fait presque plus d’effet qu’avec la femme en chair et en os, comme si, à force de traiter les femmes en objet, elles en avaient perdu l’énergie vitale.
Cela m’a donné l’envie d’inverser les choses, et voilà le bel Allan allongé sur la table chez Anatole. Pas de masque doré pour échapper à la concupiscence des femmes en manque d’hommes qui l’entourent, mais un clin d’oeil à la galerie se trouve dans le texte, quant aux phantasmes des hommes de l’époque ils se verront retournés comme un gant par les femmes de celle-ci. Que l’histoire littéraire me pardonne !