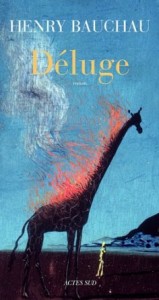L’argument du Grand Roman indien semble très simple : le vieux Ved Vyas dit V.V. dicte ses mémoires à son secrétaire au physique éléphantesque, qui s’appelle d’ailleurs Ganapati (autre nom de Ganesh, le dieu éléphant). Il va raconter au jeune homme l’histoire politique de son pays, l’organisation par Gandhi de la résistance non-violente, la partition du grand pays entre l’Inde et le Pakistan, les soubresauts politiques et les luttes sanglantes.
L’argument du Grand Roman indien semble très simple : le vieux Ved Vyas dit V.V. dicte ses mémoires à son secrétaire au physique éléphantesque, qui s’appelle d’ailleurs Ganapati (autre nom de Ganesh, le dieu éléphant). Il va raconter au jeune homme l’histoire politique de son pays, l’organisation par Gandhi de la résistance non-violente, la partition du grand pays entre l’Inde et le Pakistan, les soubresauts politiques et les luttes sanglantes.
« Ils me disent que l’Inde est un pays sous-développé. Ils assistent à des séminaires, se produisent à la télévision, viennent même me voir, accrochés à leurs attachés-cases de plastique moulé, froissant leurs costumes à huit cents roupies, pour annoncer sur un ton infiniment entendu que l’Inde n’est pas encore développée. Foutaises. »
Un livre d’histoire de plus, me direz-vous, à la structure bateau rabâchée depuis des siècles… Pas du tout ! Un torrent de rire et de sang, de fureur et de sensualité, une parodie étonnante, un conte à tiroirs, à double, à triple entrée où nous nous perdons plus encore que nous le supposons. Quant à la structure qui nous semble si banale, elle est calquée sur le texte parodié, le plus ancien texte de la mythologie hindoue, le Mahabharata qui signifie « la grande Guerre ». Dans celui-ci, Vyâsa, raconte au dernier des membres de la famille l’histoire de la guerre qui a détruit le clan. Vyâsa, Vyas, c’est transparent, tout comme la structure de la narration.
L’auteur du Grand Roman indien reprend l’immense poème fondateur, pour nous conter l’histoire de l’Inde moderne à grand renfort de poèmes, histoires coquines et roublardes, personnages hauts en couleurs dont l’incroyable Gangaji, Gandhi. Les Pandava et les Kaurava, les cousins du mythe, vont partir à la conquête du pays. Et l’histoire de l’Inde défile, avec ses Anglais pleins de morgue et d’ignorance, leur exploitation systématique du pays, la façon désastreuse dont ils ont géré l’accès de l’Inde à l’indépendance. Mais aussi la soif de pouvoir des nouveaux dirigeants, l’échec de la non-violence, les torrents de victimes, et là on ne rit plus :
« C’est la fuite qui rend les gens vulnérables, c’est la fuite qui les rend violents ; c’est la perte de ce précieux contact avec son monde et sa terre, l’arrachement aux racines, aux amitiés et aux souvenirs qui crée la dangereuse instabilité d’identité et fait des hommes la proie des autres, de leurs propres peurs et de leurs propres haines. C’est souvent l’être qui a tout perdu qui est aussi la cible la plus commode, car il est sans visage, sans maison, sans lieu, et son manque d’identité invite et semble pardonner l’attaque. Après tout, personne ne pleure un rien du tout ».
Ce paragraphe pourrait s’appliquer à toutes les victimes des guerres modernes, en Asie ou en Afrique. Mais bien vite l’auteur revient à plus de légèreté et conclut son énorme roman (plus de 500 pages) par une pirouette :
« Tes sourcils et ton nez, Ganapathi, se tordent en un point d’interrogation éléphantesque. Etes-vous arrivé, sembles-tu demander, à la fin de votre histoire ? Comme tu as peu de mémoire ! Pas plus tard que l’autre jour, je te disais que les histoires ne finissent jamais, elles se continuent simplement ailleurs. Dans les montagnes et dans les plaines, dans les cœurs et les foyers de l’Inde.
Mais mon dernier rêve, Ganapathi, me laisse avec un problème beaucoup plus grave. S’il possède une signification, une signification quelconque, c’est que j’ai raconté jusqu’ici mon histoire d’un point de vue complètement erroné. J’y ai réfléchi, Ganapathi, et je me rends compte que je n’ai pas le choix. Il me faut la raconter de nouveau.
Je vois la consternation se peindre sur ton visage. Je suis navré, Ganapathi. J’en toucherai un mot demain à mon ami Brahm. Entre-temps, reprenons au commencement.
Ils me disent que l’Inde est un pays sous-développé… »
Sashi Tharoor, fin connaisseur de la littérature et de l’histoire de son pays, nous livre avec cette histoire chantournée et mythique, un récit d’une richesse et d’une verve exceptionnelles.