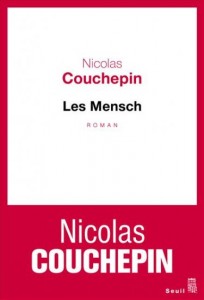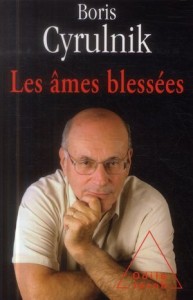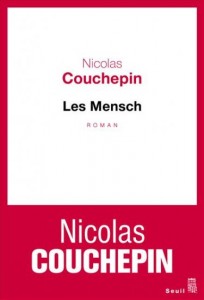 Si vous désirez vous plonger dans une cave, dans les tréfonds d’une maison qui réagit aux humeurs de ses propriétaires et si vous n’avez pas peur d’étouffer plongez-vous dans ce mille-feuille envoûtant et oppressant de Nicolas Couchepin, Les Mensch.
Si vous désirez vous plonger dans une cave, dans les tréfonds d’une maison qui réagit aux humeurs de ses propriétaires et si vous n’avez pas peur d’étouffer plongez-vous dans ce mille-feuille envoûtant et oppressant de Nicolas Couchepin, Les Mensch.
Les Mensch, ce sont les hommes en allemand mais aussi les bonnes personnes en yiddish. Les bonnes personnes, vraiment ? Qu’ont-elles fait de si extraordinaire et de si courageux ? Cette famille d’apparence banale, le père Théo, la mère Muriel, la fille adolescente Marie et le fils mongolien âgé de dix ans Simon n’a rien qui suscite l’admiration. Ils vivent dans une belle maison, famille ordinaire malgré le handicap de Simon et pourtant tout bascule, toute référence à la normalité est niée dès la première page du roman.
(…) Quand on apprit, par les journaux, ce qu’avait fait la famille Mensch, ce fut l’incrédulité.
Le monde entier – plus précisément, la petite communauté de la banlieue où vivait la famille Mensch – se demanda (avec émoi, incompréhension, et peut-être une condescendance mêlée de crainte obscure) ce qui avait bien pu pousser cette famille à partir en exil. Pourquoi des gens en apparence normaux s’étaient-ils engagés dans ce voyage excentrique d’où il n’était pas possible de revenir indemne ?
Tout l’art du roman se devine dans ces quelques phrases. Tout d’abord démarrer un roman comme s’il était déjà commencé c’est très fort. Je vous passe toutes les raisons supposées de la folie des Mensch, l’inexplicable autorisant les hypothèses les plus folles.
J’ai immédiatement pensé à Raymond Roussel : aventures irréelles sinon irréalistes, exercices complexes aussi déroutants et envoûtants que ceux de Roussel, palimpseste organique et vertigineux.
Cette famille au nom si lourd de significations n’est pas le véritable sujet de cette histoire. En fait la véritable héroïne est la cave de la maison. Le reste de la maison, ce qui se montre, les habitants, les belles pièces, c’est de la poudre aux yeux sociale.
Quatre personnes vont tenter de reconstruire cette histoire, et chacune utilisera l’écrit à sa façon : le père, Théo, avec des coupures de presse de l’agende Dériva (!!!) concernant des étrangetés ou monstruosités de nature humaine, la mère, Muriel, avec des listes obsessionnelles soigneusement numérotées, la fille, Marie, avec son journal et la vieille voisine, Lucie (la lumière !) avec une lettre qu’elle écrit à son fils Nicolas dans ses moments de conscience.
Seul Simon, être lumineux qui mange de la terre, ne s’exprime pas.
La maison vit au rythme des habitants, rétrécissant selon l’angoisse du père, devenant immense comme la vie qui attend Marie, pleine de tremblements et de secousses pour la mère.
Ce livre à la structure complexe confine souvent à l’asphyxie : on s’enfonce dans le passé des habitants et de la maison, on s’englue dans l’impression diffuse qu’il faudrait se sauver loin de cet univers oppressant où l’air et la lumière ne pénètrent pas.
Un livre sur le handicap ? Sur la façon dont un enfant trisomique capte toute l’attention sur lui au détriment du reste de la famille ? Un livre sur nos névroses à tous et la façon dont nous relayons nos propres folies « à la cave », dans l’obscurité de l’intime ? Tout est menaçant, depuis ce petit lit aux pieds griffus comme ceux du diable qui suit la famille Mensch depuis toujours, aux renards et aux papillons qui se multiplient jusqu’à envahir tout l’espace.
L’écriture de Nicolas Couchepin c’est un peu comme un serpent qui vous enroule dans ses anneaux pour vous étouffer même si vous ne croyez pas à son histoire parce qu’il n’y a pas vraiment d’histoire, seulement un faisceau de menaces et de faits étranges. J’ai été un peu gênée par ce qui m’a semblé devenir un système confinant à la préciosité. Autant la façon dont la mère était dévorée par son enfant différent me semblait admirablement montrée, autant les histoires de Marie et de Lucie m’ont semblé artificielles. Je crois que je vais relire Impressions d’Afrique…
 Le vendredi 18 décembre 2014 l’écrivain suisse Nicolas Couchepin est venu à la bibliothèque d’Annemasse confronter les grilles de lecture de son roman Les Mensch avec ses lecteurs français dans le cadre de Lettres Frontière 2014.
Le vendredi 18 décembre 2014 l’écrivain suisse Nicolas Couchepin est venu à la bibliothèque d’Annemasse confronter les grilles de lecture de son roman Les Mensch avec ses lecteurs français dans le cadre de Lettres Frontière 2014.
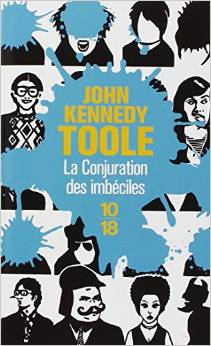
![ceridwen [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons](/wp-content/uploads/Miss_Perkins_takes_a_class_-_geograph.org_.uk_-_1526335-300x225.jpg)