Les cicatrices sont comme les années, elles s’accumulent petit à petit, et tout ça finit par faire un être humain.
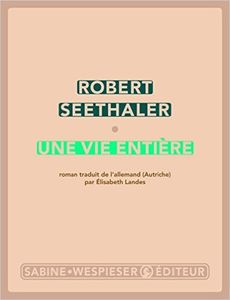
Une vie entière
Les cicatrices viennent après la blessure, après les coups physiques et les coups du sort, ceux qui font chanceler l’être humain avant de faire partie de son histoire. Andreas Egger appartient au monde des obscurs, des petites gens si admirablement décrits par Flaubert dans Un Cœur simple dont la trame de départ ressemble à celle du livre de Robert Seethaler : même début de vie pour Félicité et Andreas, tous deux recueillis par un paysan qui les bat, tous deux cœurs simples sans amertume et amoureux du travail bien fait.
Il y a une longue filiation de ces descriptions de vie exemptes de romanesque, de Flaubert à Pierre Michon ou Marie-Hélène Lafon. Dans la littérature contemporaine, ces vies s’inscrivent dans l’histoire et l’évolution de la société. Chez Robert Seethaler, Le Tabac Tresniek parlait déjà des changements en Autriche pendant la seconde guerre mondiale, et le héros était un jeune garçon modeste. La comparaison avec Une vie entière s’arrête là tant l’envergure du deuxième roman surprend par son ampleur.
On suit Andreas Egger de son arrivée dans ce village de montagne au pied des Alpes au début du vingtième siècle à sa mort dans une cabane au-dessus du village presque quatre-vingts ans plus tard :
Enfant, Andreas Egger n’avait jamais crié de joie, voire crié tout court. Jusqu’à sa première année d’école, il n’avait même pas vraiment parlé. Il s’était constitué non sans peine un petit pécule de mots qu’il se disait tout haut en de rares moments et assemblait au hasard. Parler voulait dire attirer l’attention, ce qui pour le coup ne présageait rien de bon. Quand, un beau jour de l’été dix-neuf cent deux, on l’avait hissé hors de la voiture qui l’amenait d’une ville située au-delà des montagnes, le petit garçon était resté coi, levant de grands yeux étonnés sur les cimes d’un blanc irisé. Il pouvait avoir environ quatre ans alors, peut-être un peu moins, ou un peu plus. Personne ne le savait exactement, personne n’en avait cure, et c’était bien le cadet des soucis du fermier Hubert Kranzstocker qui réceptionna le petit Egger à contre-cœur (…).
Durant cette existence difficile si admirablement décrite, on suit l’évolution de la vie dans les Alpes Autrichiennes : l’installation des téléphériques, le nazisme, la guerre, la transformation de l’agriculture de montagne en activité touristique… D’autres encore comme l’arrivée de l’électricité, de la télévision, le spectacle des hommes qui marchent sur la lune…
La population du village avait triplé depuis la guerre et le nombre de lits presque décuplé, ce qui amena la commune à entreprendre, outre la construction d’un centre de vacances, avec piscine couverte et jardin thermal, l’agrandissement du bâtiment scolaire qui s’imposait depuis longtemps.
Robert Seethaler parle également d’un épisode habituellement passé sous silence, à savoir le fait que des soldats allemands sont restés prisonniers en U.R.S.S. jusqu’en 1951.
Egger, rendu boiteux à la suite des sévices du paysan Kranzstocker, possède une grande force physique et ne connaît pas le vertige ; il participe à l’installation puis à l’entretien des pylônes des téléphériques. Dans la dernière partie de sa vie il deviendra guide de montagne pour les touristes.
Manifestement, les gens venaient chercher dans les montagnes quelque chose qu’ils croyaient avoir perdu ils ne savaient quand, longtemps auparavant. Il ne comprit jamais de quoi il s’agissait exactement, mais, les années passant, il acquit la certitude qu’au fond ce n’était pas lui que les touristes suivaient de leur pas mal assuré, mais quelque insatiable nostalgie inconnue.
Cette nostalgie n’envahit pas que les touristes. Elle submerge le lecteur, ébloui par l’extraordinaire et spectaculaire demande en mariage de Egger à Marie la servante de l’auberge, et bouleversé par la fin tragique de l’éclaircie dans la vie d’Andreas Egger. Car on s’attache très vite à ce taiseux, comme on s’était attaché par exemple au Joseph de Marie-Hélène Lafon, même si les deux livres se situent aux antipodes l’un de l’autre tant le style de leur auteur respectif est différent.
La vie fracassée dès le départ du petit Andreas, cette vie d’orphelin vouée à l’exploitation, nous bouleverse pour d’autres raisons que cette version moderne des Misérables. Parce qu’elle est universelle. Parce que, au-delà du cas particulier du petit autrichien du début du vingtième siècle, c’est notre propre vie que nous apercevons en filigrane, cette vie qui nous échappe au milieu des évolutions technologiques qui vont de plus en plus vite.
Comme tous les êtres humains, il avait, lui aussi, nourri en son for intérieur, pendant sa vie, des idées et des rêves. Il en avait assouvi certains, d’autres lui avaient été offerts. Beaucoup de choses étaient restées inaccessibles ou lui avaient été arrachées à peine obtenues. Mais il était toujours là. Et dans les jours qui suivaient la première fonte des neiges, quand il traversait le matin le pré humide de rosée devant sa cabane et s’étendait sur une des dalles rocheuses qui le parsemaient, avec dans son dos la fraîcheur de la pierre et sur le visage les premiers chauds rayons de soleil, il avait l’impression qu’il ne s’en était tout de même pas si mal tiré.
Lisez cette Vie entière, avec émotion, avec respect, et admiration.
Robert Seethaler
traduit de l’allemand (Autriche) par Élisabeth Landes
Sabine Wespieser, octobre 2015, 160 p., 18,00 €
ISBN : 978-2-84805-194-9

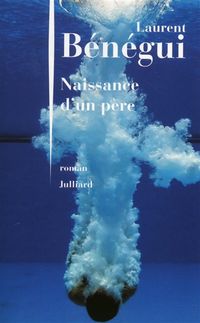 Naissance d’un père de Laurent Bénégui vient interrompre la succession de livres drolatiques à l’activité effrénée où un personnage apparemment normal se trouve confronté à des situations invraisemblables qui suscitent l’hilarité du lecteur. Jusque-là le héros d’un roman de Bénégui s’exprimait à la première personne, et ce « je » pourtant opérait une mise à distance du lecteur, comme l’impression de se trouver au cinéma en train de regarder le héros se dépatouiller avec la pagaille qu’il a suscité. Avec Naissance d’un père, c’est tout l’inverse. Le héros de l’histoire est mis à distance du narrateur et pourtant ce « il » est terriblement intime, renvoie le lecteur à sa propre histoire, supprime la distance.
Naissance d’un père de Laurent Bénégui vient interrompre la succession de livres drolatiques à l’activité effrénée où un personnage apparemment normal se trouve confronté à des situations invraisemblables qui suscitent l’hilarité du lecteur. Jusque-là le héros d’un roman de Bénégui s’exprimait à la première personne, et ce « je » pourtant opérait une mise à distance du lecteur, comme l’impression de se trouver au cinéma en train de regarder le héros se dépatouiller avec la pagaille qu’il a suscité. Avec Naissance d’un père, c’est tout l’inverse. Le héros de l’histoire est mis à distance du narrateur et pourtant ce « il » est terriblement intime, renvoie le lecteur à sa propre histoire, supprime la distance.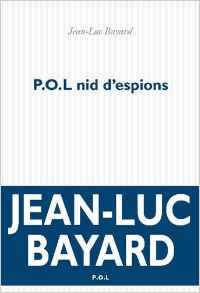

 La passion interdite se paie par le sang et par la mort de ceux que l’on aime le plus, c’est-à-dire ses enfants, dans une réserve indienne d’Amérique du Nord comme dans les drames antiques.
La passion interdite se paie par le sang et par la mort de ceux que l’on aime le plus, c’est-à-dire ses enfants, dans une réserve indienne d’Amérique du Nord comme dans les drames antiques.