Il est habituel dans les milieux littéraires, de dire ou d’écrire que les lecteurs sont toujours déçus par le deuxième roman d’un auteur, que celui-ci ferait mieux d’enjamber cet obstacle et de sortir directement le troisième. Domovoï est le deuxième roman de Julie Moulin, et il est magnifique.
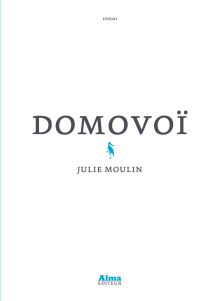 Le domovoï qui donne son titre au livre est l’esprit protecteur de la famille et du foyer russes, (domoï c’est la maison en russe), mais ce petit génie ne se montre pas toujours sympathique, il peut jouer des tours cruels s’il estime que l’on ne s’est pas assez bien occupé de lui. C’est
Le domovoï qui donne son titre au livre est l’esprit protecteur de la famille et du foyer russes, (domoï c’est la maison en russe), mais ce petit génie ne se montre pas toujours sympathique, il peut jouer des tours cruels s’il estime que l’on ne s’est pas assez bien occupé de lui. C’est
Une sorte de nain barbu, griffu, au regard oblique dont la reproduction sur d’anciens livres en cyrillique me gardait éveillée jusque tard dans la nuit. J’espérais à ne jamais le rencontrer pour de vrai.
Anne, la mère de Clarisse, la narratrice du roman, l’a ramené de Russie avant la naissance de cette dernière. Anne est morte depuis dix ans. La jeune fille habite Paris avec son père, elle étudie à Sciences Po : amis, amours au stade velléitaire, difficultés à trouver sa place. De sa mère disparue, Clarisse garde le souvenir d’une femme fantasque, habitée par la Russie, au regard souvent éteint. Lorsqu’elle découvre une photo de groupe où sa mère a l’air si heureuse, la jeune fille décide d’effectuer son stage de Science Po en Russie. Devant son obstination, son père s’incline mais s’arrange pour lui baliser le parcours, lui qui a connu sa femme lors d’un stage à l’ambassade de France à Moscou. Veut-il offrir à sa fille l’occasion de découvrir par elle-même un pan de l’histoire familiale qu’elle ignore ? Veut-il l’aider à grandir ?
Le roman se construit alors en strates historiques et romanesques alternées : un chapitre pour le Moscou de 1993, lorsque Anne débarque dans un pays qui sort à peine du communisme ; un autre pour le Moscou de 2015 quand sa fille découvre la ville à son tour. D’un côté magouilles pour survivre et fossé qui se creuse entre les affairistes de l’économie de marché et ceux qui restent au bord de l’histoire, avec la rudesse des gens en réponse à la dureté des temps. Anne a débarqué, elle attend longuement que deux babouchkas lui rendent son passeport :
Elle est en Russie. Elle touche au but. Il faut juste attendre le retour des deux Russes. Les voici justement, assurées sur leurs chaussures de mauvaise confection, fortes de tenir en main le destin d’une passagère parisienne. Elles aimeraient sans doute pouvoir s’y rendre, à Paris, arpenter les Champs-Élysées dans de meilleurs souliers. À défaut de pouvoir s’évader, elles usent et abusent du pouvoir de tamponner ; en Russie, il suffit parfois d’avoir de l’encre et un bon coup de main pour régner et posséder.
Cette expérience, Anne la fera plusieurs fois, tant, face à la pénurie permanente, l’appétit pour la richesse supposée de la jeune occidentale s’aiguise. Continuer la lecture →
DomovoïJulie Moulin
Alma Éditeur, septembre 2019, 304 p., 18 €
ISBN : 978-2-36279-420-9
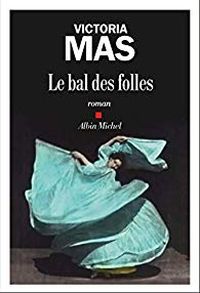 Pour son premier roman, Victoria Mas a choisi la Salpêtrière au temps où l’immense hôpital était peuplé d’aliénées, au temps du docteur Charcot et de ses célèbres expériences sur les malades. Cela rappelle beaucoup La salle de bal d’Anna Hope, même époque, même oppression des faibles, même façon d’interner ceux qui dérangent. Plus troublant encore : la salle de bal… S’agit-il de la même façon de traiter la folie ?
Pour son premier roman, Victoria Mas a choisi la Salpêtrière au temps où l’immense hôpital était peuplé d’aliénées, au temps du docteur Charcot et de ses célèbres expériences sur les malades. Cela rappelle beaucoup La salle de bal d’Anna Hope, même époque, même oppression des faibles, même façon d’interner ceux qui dérangent. Plus troublant encore : la salle de bal… S’agit-il de la même façon de traiter la folie ?
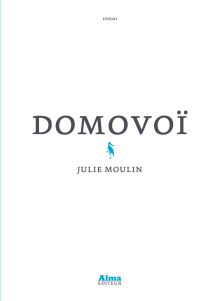 Le domovoï qui donne son titre au livre est l’esprit protecteur de la famille et du foyer russes, (domoï c’est la maison en russe), mais ce petit génie ne se montre pas toujours sympathique, il peut jouer des tours cruels s’il estime que l’on ne s’est pas assez bien occupé de lui. C’est
Le domovoï qui donne son titre au livre est l’esprit protecteur de la famille et du foyer russes, (domoï c’est la maison en russe), mais ce petit génie ne se montre pas toujours sympathique, il peut jouer des tours cruels s’il estime que l’on ne s’est pas assez bien occupé de lui. C’est Cette fois Brigitte Giraud aborde le problème de l’homosexualité chez les adolescents à travers le personnage de Livio qui va avoir le courage de révéler son orientation sexuelle à sa classe lors d’un exposé sur Magnus Hirschfeld durant un cours d’histoire.
Cette fois Brigitte Giraud aborde le problème de l’homosexualité chez les adolescents à travers le personnage de Livio qui va avoir le courage de révéler son orientation sexuelle à sa classe lors d’un exposé sur Magnus Hirschfeld durant un cours d’histoire. Comme je vous admire, ô vous, les champions de la dédicace, les marathoniens qui passez de librairie en librairie, sautez de train en train et parcourez la France avec l’allégresse du vainqueur, celui qui, toujours aussi frais malgré le rythme épuisant, affiche le sourire éblouissant de celui qui semble découvrir son premier lecteur.
Comme je vous admire, ô vous, les champions de la dédicace, les marathoniens qui passez de librairie en librairie, sautez de train en train et parcourez la France avec l’allégresse du vainqueur, celui qui, toujours aussi frais malgré le rythme épuisant, affiche le sourire éblouissant de celui qui semble découvrir son premier lecteur. Depuis un mois tout juste, le roman est paru et je commence à avoir de très beaux retours de lecteurs. Pour quelle raison se sent-on concerné par un roman ? Qu’est-ce qui va nous décider à l’acheter ? C’est toujours un peu mystérieux… Dans le cas précis, le roman doit son existence à une catastrophe aérienne survenue sur le mont Blanc en janvier 1966 où beaucoup d’Indiens ont péri. Quand on connait la région, que l’on a peut-être crapahuté sur le glacier des Bossons, on comprend tout de suite ce dont je parle dans certaines pages.
Depuis un mois tout juste, le roman est paru et je commence à avoir de très beaux retours de lecteurs. Pour quelle raison se sent-on concerné par un roman ? Qu’est-ce qui va nous décider à l’acheter ? C’est toujours un peu mystérieux… Dans le cas précis, le roman doit son existence à une catastrophe aérienne survenue sur le mont Blanc en janvier 1966 où beaucoup d’Indiens ont péri. Quand on connait la région, que l’on a peut-être crapahuté sur le glacier des Bossons, on comprend tout de suite ce dont je parle dans certaines pages. 