Que voilà une magnifique saga ! Un superbe roman qui vous emporte en Arabie Saoudite, pays que l’auteur connaît fort bien pour y avoir vécu de très nombreuses années, et cela se voit dans ses descriptions des rouages de la vie quotidienne saoudienne, cela se sent dans son portait des gynécées, cela se comprend dans les mentalités. Une plongée dans un pays que l’on ne connaît qu’à travers reportages et sinistre actualité, mais surtout un roman palpitant qu’on lâche difficilement !
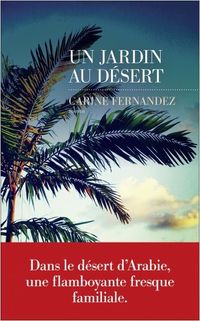 Le patriarche de la famille Bahahmar, Talal, se distingue du reste de la famille par sa tendance à l’érémitisme. Il possède bien sûr un palais, il en a fait construire pour chacune de ses femmes, d’ailleurs, car Talal a la passion de la monogamie : une seule femme à la fois, avant une répudiation très facile ; une seule, à l’exception de sa première épouse, Mama Aïcha, qu’il n’a jamais répudiée et qui s’occupe de sa mère, Sitt Fatma. Talal ne se sent jamais mieux que dans la ferme de sa palmeraie, à arroser son jardin ; un lieu spartiate sans électricité ni internet où il a la paix, loin des tracas de sa nombreuse famille.
Le patriarche de la famille Bahahmar, Talal, se distingue du reste de la famille par sa tendance à l’érémitisme. Il possède bien sûr un palais, il en a fait construire pour chacune de ses femmes, d’ailleurs, car Talal a la passion de la monogamie : une seule femme à la fois, avant une répudiation très facile ; une seule, à l’exception de sa première épouse, Mama Aïcha, qu’il n’a jamais répudiée et qui s’occupe de sa mère, Sitt Fatma. Talal ne se sent jamais mieux que dans la ferme de sa palmeraie, à arroser son jardin ; un lieu spartiate sans électricité ni internet où il a la paix, loin des tracas de sa nombreuse famille.
Un jour il rencontre le jardinier égyptien qui s’occupe de son jardin et dont la beauté le frappe ; très vite une relation se noue entre les deux hommes malgré l’abîme social qui les sépare.
Quant à moi, je m’appelle Rezak et, comme vous me l’avez judicieusement rappelé, je suis égyptien. Oui, fils de la vallée du Nil, inutile de jouer les modestes : mon père avait une excellente situation, il était pharaon. (p. 29)
Très vite le jeune homme va prendre beaucoup de place dans la vie de Talal et dans celle de sa famille. Rezak est venu gagner de l’argent en Arabie Saoudite après la mort de son père qui a détruit ses rêves universitaires. Une mort honteuse dont il peine à se remettre, et Talal prend vite la place de ce père méprisé. Quant à Rezak, sa beauté, son intelligence et son intégrité comblent les frustrations de père de Talal : aucun de ses fils ne possède toutes ces qualités. Rezak s’installe dans la vie et les affaires compliquées de Talal, découvre la vie des Saoudiens.
Sur le parvis du tribunal encombré par les vendeurs d’eau, accroupis au milieu de leurs pyramides de bouteilles, régnait le tumulte océanique des marchés. Un va-et-vient continuel, une excitation tangible qui montait de tous ces conflits, ces rancœurs, ces offenses, comme une marée, sans cesse recommencée. La grève de marbre blanc où venaient s’échouer les épaves de la société civile. Des Bédouins aux yeux de fauves, soulignés de khôl, se grattant nerveusement la verge à travers l’étoffe du thob, dédaigneux des usages de la capitale, des Américains cramoisis comme des dindons, le col étranglé par la cravate, en dépit des cinquante degrés de l’été. Business : un mot universel, qui ne se traduisait plus, que le vent du désert soufflait en continu sur le royaume, et que les Bédouins, venus dans leurs pick-up réclamer les zones de pâtures confisquées par un prince promoteur, prononçaient à lèvres serrées, comme un sifflement de vipère. De telles sommes se brassaient dans ce creuset de marbre qu’on croyait entendre la rumeur des millions, comme ces coquillages qu’on applique sur l’oreille pour écouter la mer. (p. 124-125)
Cet extrait vous donne un aperçu de la connaissance intime de l’auteure de l’Arabie Saoudite. La description de la vie quotidienne, du pouvoir des femmes et de la faiblesse des hommes, de l’absence de droits des femmes et de la domination des hommes, tout est admirablement montré. Mais sans ostentation, sans didactisme ; la puissance même du roman lorsqu’il nous fait entrer à l’intérieur des personnages et ne se contente pas de montrer.
Talal craint sa dernière jeune épouse, Loulwa qui le poursuit de ses attentes sexuelles tant elle craint d’être répudiée. Dahlia, la petite-fille de Talal, vit avec celui-ci et Mama Aïcha, la vieille épouse dans la maison de Talal : gardienne des secrets. (p. 219)
Dahlia est la fille de Khaled et de Sylvia, l’épouse anglaise qui s’est enfuie lorsqu’elle était enceinte. Talal a enlevé la petite lorsqu’elle avait neuf ans, et interdit tout contact avec la mère. Dahlia mène une vie d’enfant gâtée, mais elle est soumise elle aussi aux lois islamiques. Vie compliquée dans les palais silencieux où ne résonne aucune musique mais où la télévision marche tout le temps, obligation de sortir avec un chauffeur mais virées dans le désert en 4/4 avec les copines : sans cesse le grand écart.
Les personnages sont nombreux dans cette superbe fresque où l’Arabie Saoudite est plus qu’un décor, un personnage, où le sens des affaires n’exclut pas le fanatisme religieux, où les quasi esclaves du pétrodollar construisent les édifices d’hommes aux ambitions démesurées.
Tout est là dans ce texte haut en couleurs, balayé par le vent brûlant du désert et les passions, un Autant en emporte le vent du Moyen-Orient sans aucun temps mort, où tous les éléments s’imbriquent les uns aux autres pour constituer une brillante mosaïque.
Et quel style !
Les grands-mères étaient reparties faire la sieste dans leurs chambres, appuyées l’une sur l’autre, comme deux fleurs défraîchies dans un vase, flageolantes, la tête baissée, humble courbette à la mort. (p. 213)
Ou Mama Aïcha faisant sa prière :
Debout, mains aux oreilles, puis mains aux genoux, dos incliné, et plus bas encore, front au tapis, pour, au final, se relever d’un coup de jarret avec une souplesse qu’on n’eût pas soupçonnée chez une femme aussi grasse. Des gestes immémoriaux, inconscients, mécaniques. On aurait dit un poussin dodu, piochant à petits coups saccadés son ver de terre dans les carrés fleuris du tapis persan. (p. 215-216)
L’évocation des éléments naturels surprend par sa force :
L’été était arrivé avec la force d’une bombe incendiaire, dévastant tout sur son passage. Le vent de sable chargé de feu. Après les nuages de poussière du khamsin qui avaient déferlé en horde sauvage, cavaliers de l’apocalypse, aux capes enflées comme des voiles, aux turbans déchiquetés, noyant la ville dans un halo rougeâtre, le mois de juin débuta sous un ciel de craie et une température qui avoisinait les 50 degrés. (p. 269-270).
Attention, ne vous méprenez pas : Carine Fernandez peut vous surprendre, n’attendez pas un joyeux ronronnement stylistique. D’un seul coup l’expression populaire vient vous réveiller, ou mieux encore le mélange incongru d’un terme argotique et d’un mot datant du Moyen-Âge inconnu de votre petit Larousse ou de votre petit Robert !
Par exemple la pétoche breneuse : pétoche, aucun problème, mais breneuse ? Je l’ai trouvé à la fois dans le Littré ( « Sali de bran, de matière fécale », suivi d’une citation du XIVe siècle) et dans le grand Larousse illustré de 1901 de l’arrière-grand-père de mon mari (« Breneux : sali de matière fécale ») .
Vous l’aurez compris, notre auteure ne dédaigne pas un peu de scatologie rabelaisienne ou le terme relégué depuis fort longtemps aux oubliettes, comme le verbe girer, « changer la direction dans la route d’un navire » qui était déjà décrit comme vieux dans l’encyclopédie de l’arrière-grand-père, mais qui est si évocateur, quand Talal dit que Le monde gire dans un mouvement incessant. Elle manie aussi le néologisme à l’occasion « Il n’avait pas déplu » pour arrêter de pleuvoir. La marque des grands écrivains qui brassent tous les mots pour obtenir ce qu’ils veulent.
Le roman de Carine Fernandez vient de paraître aux éditions Les Escales. Pour ceux que les coquilles et fautes oubliées – même dans les plus grandes maisons – irritent à juste titre, il faut saluer l’attention des correcteurs pour la perfection du texte et de la typographie.
Un très grand plaisir de lecture, donc, avec héros magnifiques, exotisme, érotisme, humour, éclairages sur un pays encore obscur pour beaucoup d’entre nous, écriture somptueuse… Impossible de vous dire autre chose que « Précipitez-vous chez votre libraire ! »
P.S. : N’oubliez pas Mille ans après la guerre, cette plongée dans l’Espagne contemporaine qui n’a pas encore pansé les blessures de la guerre d’Espagne, ou les autres romans ou recueils de nouvelles de Carine Fernandez, comme La Servante abyssine qui l’a fait connaître, ou le recueil de nouvelles Le châtiment des goyaves. C’est chaque fois un bonheur de lecture.

Je sens que je ne résiste pas 🙂 Au secouuuuurs. Mais c’est trop tentant! Merci
Ne résiste surtout pas! Un grand plaisir de lecture en perspective, je t’assure…
Hier, je laisse un petit mot sur Contact pour vous dire tout le bien que je pense de Mille après la guerre découvert grâce à votre blog.
Ce matin, nouvel article sur un livre de Carine Fernandez, auteur du livre tant aimé.
C’est un signe, sûrement. De quoi, je ne sais pas. Peut-être que ce livre me plaira aussi beaucoup. Je vais attendre un peu et chercher les plus anciens dont vous parlez.
Merci beaucoup.
Merci Chantal de laisser un petit mot de nouveau. Tous les livres de Carine Fernandez valent la peine, je vous assure. Un grand écrivain qui mérite une large audience, et je suis ravie de participer à élargir celle-ci. Je crois que mes articles donnent vraiment le contenu des livres, je ne suis sponsorisée par aucun éditeur (je refuse les envois), ce qui me donne beaucoup de liberté.
Bonne lecture, chère Chantal, quel que soit le livre que vous choisirez de lire.
Cordialement,
Nicole.