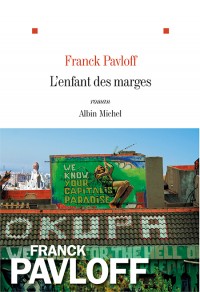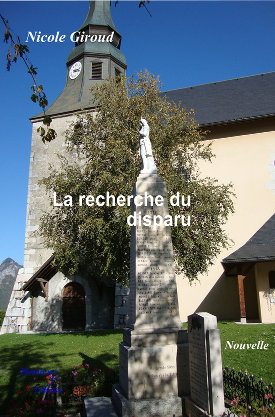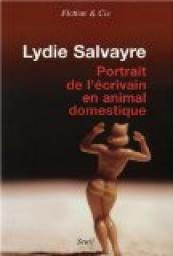 L’écrivain, jeune femme qui approche la quarantaine et dont nous ne saurons jamais le nom, a mis sa plume au service de l’empereur du burger, Jim Tobold, pour écrire son Évangile, quelque chose entre l’hagiographie sacrilège et la promotion d’un capitalisme écrasant.
L’écrivain, jeune femme qui approche la quarantaine et dont nous ne saurons jamais le nom, a mis sa plume au service de l’empereur du burger, Jim Tobold, pour écrire son Évangile, quelque chose entre l’hagiographie sacrilège et la promotion d’un capitalisme écrasant.
L’écrivain ne se présente pas vraiment à son avantage : velléitaire, lâche, révoltée en pensées mais jamais en actes. Une belle plume cultivée qui se met au service d’une machine à broyer dans le but de la glorifier. Le luxe et l’argent, la grossièreté des puissants, notre intellectuelle avale beaucoup de couleuvres : spectatrice d’un monde qu’elle abomine mais qui très vite la fascine et la contamine, elle n’a plus beaucoup d’illusions sur son statut de pur esprit voué à la littérature.
Lydie Salvayre nous présente un beau portrait de self made man brut de décoffrage, ogre cynique et vulgaire, colosse aux pieds d’argile jamais consolé de ses souffrances et humiliations d’enfant pauvre. L’écrivain(e) n’est pas mal non plus, en créature coincée entre un individu trop fort pour elle, avec ses louvoiements et ses ruses, ses révoltes avortées et ses nombreux accommodements avec la morale.
Le début du roman est tout simplement éblouissant.
« J’avais le cou meurtri à cause de la laisse, et l’esprit fatigué de l’entendre me dire C’est noté ? Vingt fois par jour C’est noté ? Sur le ton qu’il réservait au personnel de service C’est noté ? Car je devais me rendre à l’évidence, j’étais à son service. Tenue de lui obéir, de l’admirer, de pousser des Oh, des Ah et des C’est merveilleux. Et j’avais beau me prétendre écrivain, j’avais beau me flatter de consacrer ma vie à la littérature, j’avais beau me convaincre du caractère romanesque de la besogne que j’avais acceptée, inconsidérément, il n’en demeurait pas moins que j’étais à la botte d’un patron promu par la revue Challenge leader le plus influent de la planète, lequel m’avait chargée d’écrire son évangile (c’était le mot dont il avait usé mi-amusé mi-sérieux), d’écrire son évangile contre rétribution, et la somme qu’il m’avait offerte était telle que je n’avais pas eu le cœur de la refuser ».
Tobold est marié avec Cindy mais parle surtout à son chien Dow Jones. Il règne sur la planète comme un char de combat, s’exerçant de temps à autre au machiavélisme :
« Je n’en ferai qu’une bouchée, se réjouit-il en se frottant les mains. Mais je ne sus s’il parlait de Cindy (son épouse), de Ronald (son rival), des États-Unis (son pays d’adoption), ou tout bonnement de la planète entière. Et lorsqu’on lui annonça l’arrivée du nonce apostolique, je le vis se concentrer quelques secondes, changer complètement d’expression pour se composer le visage qu’il appelait sa gueule d’entubeur, puis d’une voix soudain pleine de miel, Ayez la bonté de vous asseoir, dit-il au nonce avec une sorte de gourmandise, car il aimait s’exercer, par pur plaisir, aux manières courtoises qu’il avait révisées récemment (selon les confidences de sa secrétaire) lors d’un cours particulier d‘excess-conviviality ».
Cela retombe un peu au milieu du roman, difficile de faire très fort sur une si longue distance: les atermoiements de notre biographe s’éternisent, la sauce s’allonge, la fin cahote, bancale, entre prudences excessives et reprises artificielles mais qu’importe, je n’ai pas boudé mon plaisir avec ce roman drôlatique et cruel bien dans notre époque. Quant aux questions morales que l’auteur pose concernant la puissance de corruption de l’argent et ses accommodements avec le Charity business, le contrôle des masses laborieuses et leur exploitation, si elles ne font rire personne, elles sont magnifiquement montrées.