J’ai mis du temps à rendre compte de Mémoire de fille d’Annie Ernaux, parce que ce livre d’à peine 150 pages m’a mise KO debout par sa violence, son âpreté et sa puissance.
 On sait que l’auteur poursuit depuis maintenant plus de quarante ans le même sillon autobiographique, loin des complaisances de certain(e)s, loin de tout sentimentalisme, loin de tout pittoresque. Une série de faits, de constats, d’immersion au plus près de la vérité de l’être. Une femme qui restitue avec une force d’évocation sidérante les étapes importantes de sa vie. Une femme qui marche, si proche de l’homme de Giacometti, si universelle. Bouleversante. Choquante. Quoi, si peu d’affection pour cette jeune fille naïve et perdue ? Quoi, une loupe d’entomologiste pour restituer ses humiliations, son entêtement, sa bêtise même ? Quoi, si peu de dignité pour révéler l’étendue du mépris dont elle a été victime ?
On sait que l’auteur poursuit depuis maintenant plus de quarante ans le même sillon autobiographique, loin des complaisances de certain(e)s, loin de tout sentimentalisme, loin de tout pittoresque. Une série de faits, de constats, d’immersion au plus près de la vérité de l’être. Une femme qui restitue avec une force d’évocation sidérante les étapes importantes de sa vie. Une femme qui marche, si proche de l’homme de Giacometti, si universelle. Bouleversante. Choquante. Quoi, si peu d’affection pour cette jeune fille naïve et perdue ? Quoi, une loupe d’entomologiste pour restituer ses humiliations, son entêtement, sa bêtise même ? Quoi, si peu de dignité pour révéler l’étendue du mépris dont elle a été victime ?
J’ai voulu l’oublier cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus avoir envie d’écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n’y suis jamais parvenue.
L’été 1958, celle qui s’appelle encore Annie Duchêne part comme monitrice en colonie de vacances. C’est la première fois qu’elle sort de chez elle et elle va connaître sa première expérience sexuelle, une nuit avec le moniteur-chef de la colonie.
Il y a une expression pour dire exactement la force et la stupeur de l’événement. Au sens exact du terme, je n’en suis jamais revenue, je ne me suis jamais relevée de ce lit (2005, dans L’Usage de la photo).
Un mois d’excitation et de honte, pendant lequel Annie est pour les autres moniteurs un « objet de mépris et de dérision », mais un mois de bravade aussi :
Il a été écrit, sans minoration, sur la glace du lavabo de ma chambre, en grosses lettres rouges avec mon dentifrice : Vive les putains. (Formulation qui avait déclenché la rage de ma coturne – une sage, qui n’a eu qu’un seul flirt – et suscité de ma part la remarque ironique : c’est le pluriel qui te gêne ?)
Cette fille dont tout le monde se moque et qui sera refusée à la colonie l’année suivante, vit une honte de fille à laquelle s’ajoutera la honte de la transgression sociale ; elle n’est pas encore l’écrivain que nous connaissons, mais le matériau est là, l’origine violente de ce travail si particulier est là.
L’avenir d’une acquisition est imprévisible.
Annie Ernaux raconte les deux années qui ont suivi : le lycée Jeanne d’Arc où elle est déjà déclassée, le séjour en Angleterre, l’erreur de l’école normale qui rendait son père si fier, ses débuts de jeune-épouse-mère-de-famille :
Cette mémoire-là aussi est implacable.
Les fondations de l’œuvre sont là, dans ces pages dont la rédaction a été différée pendant des décennies :
La grande mémoire de la honte, plus minutieuse, plus intraitable que n’importe quelle autre. Cette mémoire qui est en somme le don spécial de la honte.
Aller jusqu’au bout de 1958, c’est accepter la pulvérisation des interprétations accumulées au cours des années. Ne rien lisser.
Ressusciter cette ignorance absolue et cette attente. L’absence de signification de ce qui arrive.
On peine à comprendre l’absolue soumission de cette jeune fille qui se couche quand on le lui demande, qui obéit
à une loi indiscutable, universelle, celle d’une sauvagerie masculine qu’un jour ou l’autre, il lui aurait bien fallu subir.
Les femmes actuelles sont très loin de cette fille de 1958, elles ont connu pour la plupart de tout autres premières expériences sexuelles. D’où vient alors la force de ce livre ? D’où vient que cette fille marionnette un peu bécasse, cette fille comme un papillon maladroit qui se cogne à la vitre nous touche tellement ? Personnellement je ne peux pas me reconnaître, malgré l’universalité du propos de l’auteur, dans cette fille soumise, mai 68 et la conscience féministe sont passés par là. Mais la façon dont Annie Ernaux réussit à
Explorer le gouffre entre l’effarante réalité de ce qui est arrivé, au moment où ça arrive et l’étrange irréalité que revêt, des années après, ce qui est arrivé
me sidère.
Une femme qui marche. Qui butte sur un caillou, s’enfonce dans la boue et se redresse. Une femme qui se souvient et restitue la force brute de ce qui l’a enfoncée, salie, et lui a donné paradoxalement les matériaux de son œuvre. Après ce livre, je me demande ce qu’Annie Ernaux va pouvoir écrire.

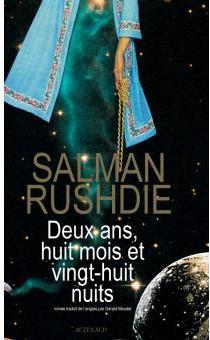 Il existe de mauvaises raisons de lire un roman ; le suivi moutonnier suite au matraquage médiatique, les prix littéraires et… le conformisme moral. Je n’avais jamais lu les Versets sataniques, ni les autres romans de Salman Rushdie, et je trouvais que je devais lire quelque chose d’un homme condamné à mort par une fatwa de l’ayatollah Khomeiny pour avoir écrit un roman. J’ai été punie, c’est bien fait pour moi : le conformisme en littérature comme ailleurs, est une faute, une malhonnêteté intellectuelle.
Il existe de mauvaises raisons de lire un roman ; le suivi moutonnier suite au matraquage médiatique, les prix littéraires et… le conformisme moral. Je n’avais jamais lu les Versets sataniques, ni les autres romans de Salman Rushdie, et je trouvais que je devais lire quelque chose d’un homme condamné à mort par une fatwa de l’ayatollah Khomeiny pour avoir écrit un roman. J’ai été punie, c’est bien fait pour moi : le conformisme en littérature comme ailleurs, est une faute, une malhonnêteté intellectuelle.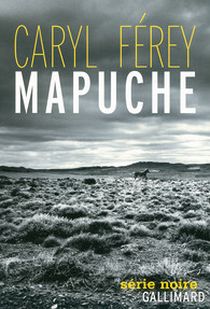 Caryl Férey écrit des thrillers, mot anglais familier passé dans le langage courant, mot désormais absolument nécessaire dans la littérature, et pas seulement policière. Thriller signifie au départ roman et film à sensation. To thrill signifie faire frissonner.
Caryl Férey écrit des thrillers, mot anglais familier passé dans le langage courant, mot désormais absolument nécessaire dans la littérature, et pas seulement policière. Thriller signifie au départ roman et film à sensation. To thrill signifie faire frissonner.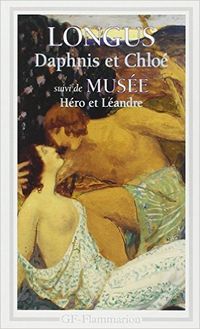 Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…
Deux enfants s’aiment dans ce monde idyllique : Daphnis le beau chevrier et Chloé la non moins belle bergère. Idyllique, vraiment ? Tous les deux sont des enfants trouvés, ou plutôt exposés, selon la cruelle tradition antique ; lorsqu’on voulait se débarrasser d’un nouveau-né, on l’abandonnait dans un bois ou une clairière avec des objets permettant de les reconnaître, au cas où…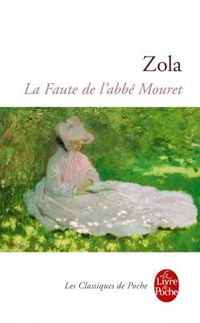
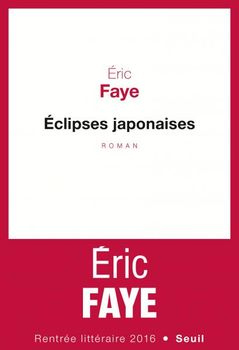 Ainsi commence le magnifique roman d’Eric Faye paru en août 2016 aux éditions du Seuil. Ces « éclipses » ne sont pas seulement japonaises, elles concernent des Américains ou des Coréens du Sud, mais aussi des gens du monde entier à qui l’on a trouvé à un moment donné une utilité pour le pays le plus fermé de la planète. La Corée du Nord est en guerre contre pratiquement le reste du monde, elle forme des espions qui doivent passer absolument pour des Japonais ou s’infiltrer chez le frère ennemi du Sud sans déclencher le doute. La Corée du Nord ne se contente pas de rodomontades, elle est dangereuse, la preuve : l’explosion en plein vol d’un vol de ligne de la Korean Airlines en 1987.
Ainsi commence le magnifique roman d’Eric Faye paru en août 2016 aux éditions du Seuil. Ces « éclipses » ne sont pas seulement japonaises, elles concernent des Américains ou des Coréens du Sud, mais aussi des gens du monde entier à qui l’on a trouvé à un moment donné une utilité pour le pays le plus fermé de la planète. La Corée du Nord est en guerre contre pratiquement le reste du monde, elle forme des espions qui doivent passer absolument pour des Japonais ou s’infiltrer chez le frère ennemi du Sud sans déclencher le doute. La Corée du Nord ne se contente pas de rodomontades, elle est dangereuse, la preuve : l’explosion en plein vol d’un vol de ligne de la Korean Airlines en 1987.